Les attaques de Jaffar Express, Pahalgam et Khuzdar, qui ont eu lieu en 2025 en Asie du Sud, ont suscité plusieurs réponses mondiales et régionales de la part des États et des acteurs de la diaspora qui appellent à agir contre le terrorisme transfrontalier. La réponse a été paradoxale : des États autoritaires comme la Chine et la Russie se sont joints à l’Inde et au Pakistan pour façonner une réponse mondiale au terrorisme, présentée comme un ordre international « démocratique » à travers la Déclaration de Tianjin de l’Organisation de coopération de Shanghai. Dans le même temps, les mobilisations des diasporas sud-asiatiques au Canada, au Royaume-Uni et en Australie ont démontré comment la participation démocratique à l’étranger peut à la fois promouvoir la solidarité contre le terrorisme et approfondir la polarisation entre les éléments nationalistes qui font écho aux griefs de leur patrie.
Cet article soutient que les attentats terroristes de 2025, en particulier celui de Pahalgam, ont non seulement déclenché une initiative géopolitique contre le terrorisme, telle que la Déclaration de Tianjin, mais ont également suscité des réactions mitigées au sein des diasporas sud-asiatiques à travers le monde. C’est particulièrement le cas au Canada, qui abrite 2,3 millions de personnes d’origine sud-asiatique, où la confrontation diplomatique avec l’Inde en 2023 et la désescalade qui a suivi ont conduit à une approche prudente face aux questions sensibles, telles que la réponse diasporique aux attentats terroristes en Asie du Sud.
Les attentats de 2025 et bref contexte historique
Le 11 mars, le Jaffar Express, transportant 440 passagers de Quetta à Peshawar, a été attaqué et détourné par des militants de l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA). Les otages ont ensuite été secourus par les forces de sécurité pakistanaises lors d’une opération de sauvetage d’une durée de deux jours. Le 21 mai, une explosion de bombe visant un bus scolaire près de Zero Point, à Khuzdar, le long de l’autoroute Quetta–Karachi, a tué dix enfants et blessé plus de trente-quatre autres. Les responsables de la sécurité pakistanaise ont déclaré que l’attaque avait été menée par des mandataires indiens. Le 22 avril 2025, cinq membres du The Resistant Front (TRF) une branche du Lashkar-e-Taiba (LeT) basé au Pakistan ont tué 26 personnes à Pahalgam, lors d’une excursion dans la vallée de Baisaran, au Cachemire. Bien que l’attaque ait été revendiquée par le TRF, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a accusé l’Inde, qualifiant l’attentat d’ « opération sous faux drapeau », ajoutant : « Nous pensons qu’il s’agissait d’une attaque mise en scène, une opération sous faux drapeau visant à en accuser une autre partie. » De son côté, l’Agence nationale d’investigation indienne (NIA) a affirmé que l’Inter-Services Intelligence (ISI) du Pakistan et le LeT étaient les véritables responsables de l’attentat.
Après les attentats, les tensions diplomatiques entre le Pakistan et l’Inde se sont rapidement intensifiées. New Delhi a déclaré les diplomates militaires pakistanais personae non gratae, réduit le personnel de la Haute Commission du Pakistan et annulé le régime d’exemption de visa de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (SAARC) pour les ressortissants pakistanais. L’Inde a également fermé la frontière d’Attari-Wagah entre les deux pays et suspendu le Traité des eaux de l’Indus. Tous les services postaux et les navires battant pavillon pakistanais ont aussi été interdits d’accès aux ports indiens. Alors que le ministère pakistanais des Affaires étrangères a présenté ses condoléances à la suite des attaques, il a adopté des mesures de rétorsion en annulant les visas pour les ressortissants indiens, en fermant son espace aérien et en suspendant les échanges commerciaux. Les forces armées indiennes ont lancé l’opération Sindoor, attaquant neuf camps terroristes situés au Pakistan et dans le Cachemire , tuant plus de cent militants liés au Jaish-e-Mohammed (JeM), Hizbul Mjuahideen (HM) et au Lashkar-e-Taiba (LeT). Les forces indiennes ont neutralisé ces sites, qui étaient soupçonnés d’être des camps d’entraînement de ces trois groupes terroristes considérés comme une organisation djihadiste visant à libérer le Cachemire de l’occupation indienne. Le Pakistan a répliqué par des frappes contre des bases militaires indiennes, ce qui a entraîné de nouvelles attaques de missiles et de drones de la part de l’Inde, jusqu’à ce que les deux pays conviennent d’une désescalade le 10 mai 2025.
La région du Jammu-et-Cachemire demeure une source de discorde entre l’Inde et le Pakistan depuis la partition de l’Inde en 1947. La Ligne de contrôle (LoC), l’une des frontières les plus militarisées au monde, a été formalisée par l’Accord de Simla en 1972, lorsque les gouvernements indien et pakistanais ont délimité leurs zones administratives respectives du Jammu-et-Cachemire. Depuis lors, l’article 370 de la Constitution indienne accordait à cette région un certain degré d’autonomie pour gérer ses propres affaires. En 2019, le gouvernement du Premier ministre Modi a révoqué ce statut autonome, plaçant la région sous le contrôle du gouvernement central, avec l’intention de la réorganiser en un Cachemire à majorité musulmane, un Jammu à majorité hindoue et un Ladakh à majorité bouddhiste (ce dernier partageant des frontières avec le Tibet et le Gilgit-Baltistan administré par le Pakistan). Les organisations terroristes opérant dans cette région sont profondément motivées par le ressentiment historique suscité par les politiques du gouvernement indien.
Les répliques mondiales et la déclaration de Tianjin
Les trois attaques ont déclenché des réactions géopolitiques, notamment l’adoption de la Déclaration de Tianjin en septembre 2025, en Chine, par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Celle-ci a affirmé que les pays devaient agir sans « deux poids, deux mesures » pour prévenir le terrorisme transfrontalier, en faisant référence aux attentats de Pahalgam, du Jaffar Express et de Khuzdar. La déclaration a été parrainée par la Chine, la Russie, l’Inde et le Pakistan, marquant un rare moment de coopération internationale. L’OCS, qui trouve son origine dans le groupe des « Cinq de Shanghai » en 2001, a été fondée par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. Depuis, elle s’est élargie pour inclure le Bélarus, l’Inde, l’Iran et le Pakistan comme États membres ; l’Afghanistan et la Mongolie comme États observateurs ; et l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Bahreïn, l’Égypte, le Cambodge, le Qatar, le Koweït, les Maldives, le Myanmar, le Népal, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Sri Lanka comme partenaires de dialogue. Les objectifs de l’OCS sont de renforcer la confiance et les relations de bon voisinage, d’approfondir la coopération dans de multiples secteurs, de préserver la paix et la sécurité régionales et de promouvoir un ordre international plus juste et plus démocratique.
Bien qu’il puisse paraître ironique que des régimes autoritaires tels que la Russie et la Chine assurent le leadership pour promouvoir un ordre international « démocratique », l’OCS demeure l’une des rares organisations régionales où des nations rivales coopèrent sur une même plateforme. En d’autres termes, elle a réussi à convaincre le Pakistan de reconsidérer le transfert de responsabilité concernant les attentats terroristes de 2025 et de négocier avec l’Inde la réintégration du Traité des eaux de l’Indus. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a également exprimé sa volonté de privilégier la diplomatie plutôt que la confrontation, et même d’apporter son soutien à l’Initiative chinoise pour la gouvernance mondiale (GGI). Cette position pourrait être influencée par la dépendance croissante du Pakistan à l’égard des investissements chinois, tels que le corridor économique sino-pakistanais (CPEC), le port de Gwadar, ainsi que par la pression d’une dette chinoise croissante, qui s’élève à 26,6 milliards de dollars américains. La position du Pakistan reflète également le poids régional croissant de l’Inde, qui a réussi à orienter Islamabad vers une coopération accrue au sein du cadre de l’OCS.
Résonance diasporique
À la suite des attentats de Pahalgam, la diaspora sud-asiatique a organisé des manifestations à Londres, Copenhague, Melbourne, Katmandou, Toronto et Vancouver. Des protestations ont également éclaté en France, en Finlande, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis. Le 25 avril à Londres, des manifestants pro-indiens rassemblés devant le Haut-Commissariat de l’Inde ont scandé des slogans en faveur de l’Inde, exhortant les gouvernements à déclarer le Pakistan comme un État soutenant le terrorisme. Des manifestants britanniques d’origine pakistanaise se sont, quant à eux, mobilisés en soutien aux Cachemiris. Une forte présence policière a été déployée pour prévenir tout affrontement violent. Des débats polarisés ont également émergé sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une photo d’un responsable pakistanais tenant une affiche du pilote de l’armée de l’air indienne Varthaman, tout en faisant un geste d’égorgement. Cet incident, qui a provoqué une vague d’indignation, a conduit un porte-parole de la Friends of India Society International UK à appeler le gouvernement britannique à soutenir l’Inde et à reconsidérer sa politique envers le Pakistan.
La diaspora indienne a organisé une manifestation devant le consulat du Pakistan à Toronto, au Canada, sous l’égide du Hindu Forum Canada, rejointe par l’Indo-Canadian Kashmir Forum, le Baloch Human Rights Council Canada, les Canadians for Human Rights Watch, le Canada India Global Forum et Nimittekam Canada. En raison des émotions intenses suscitées par les attentats terroristes, de nombreux manifestants nationalistes scandaient « Pakistan Murdabad (mort au Pakistan ». À Federation Square, dans la ville de Melbourne, des milliers de personnes appartenant à la communauté indienne ont manifesté en scandant « Hindu Lives Matter » et « Pakistan Army Terrorist Army », exprimant des sentiments nationalistes similaires. Cependant, à Toronto, la même semaine, des membres de la communauté indienne, rejoints par des Hindous, des Juifs, des Baloutches, des Iraniens et d’autres Canadiens, ont également organisé une veillée aux chandelles à la mémoire des victimes des attaques. À Londres également, la communauté indienne a organisé une veillée aux chandelles à Piccadilly Circus.
La diaspora canadienne est l’une des plus importantes au monde parmi les immigrants d’origine sud-asiatique et se mobilise fréquemment autour des enjeux touchant leur pays d’origine. En 2022, la communauté pakistanaise a manifesté à Montréal en soutien à l’ancien Premier ministre Imran Khan, lorsqu’il a été évincé par une motion de censure. En 2024, des manifestants se sont rassemblés à Mississauga, au Canada, pour soutenir l’incarcération de l’ancien Premier ministre Imran Khan. Ainsi, les responsables gouvernementaux canadiens et les acteurs non gouvernementaux demeurent prudents, craignant que les conflits survenant dans le sous-continent indien n’affectent la cohésion sociale au sein de leur diaspora. Par mesure réflexive, le Premier ministre Mark Carney a condamné l’attentat terroriste de Pahalgam, tout en publiant une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du G7 formulée ainsi : « Nous appelons à une désescalade immédiate et encourageons les deux pays à engager un dialogue direct en vue d’une issue pacifique. » Des déclarations de la Pakistan-Canada Association et de la Vedic Hindu Cultural Society de Colombie-Britannique ont plaidé pour des relations pacifiques au sein de la communauté au Canada. La Hindu Canadian Society a également publié des lignes directrices destinées aux Canadiens hindous afin d’éviter les agressions et de favoriser une vie harmonieuse.
De plus, à la suite des audiences de la Commission sur les ingérences étrangères, qui ont examiné les opérations d’influence présumées de la Chine, de l’Inde, de la Russie et d’autres États, Ottawa doit adopter une stratégie proactive d’engagement auprès des diasporas afin de protéger leurs communautés contre toute manipulation étrangère. Les nominations de ministres comme Anita Anand aux Affaires étrangères et Gary Anandasangaree à la Sécurité publique, qui entretiennent des liens étroits avec les communautés sud-asiatiques et la politique de leur pays d’origine, représentent donc des avancées positives dans ce sens. Cela est particulièrement important après la crise diplomatique entre le Canada et l’Inde en 2023, à la suite de l’assassinat du citoyen canadien sikh Hardeep Singh Nijjar. Les autorités canadiennes ont non seulement accusé les services de renseignement indiens d’avoir organisé ce meurtre, mais aussi évoqué la présence d’agents indiens liés au gang criminel Bishnoi, soupçonné d’avoir visé la communauté sud-asiatique au Canada.
Conclusion
La récente vague d’attentats terroristes en Asie du Sud a provoqué des ondes de choc à l’échelle mondiale, suscitant des réactions de la diaspora, des veillées de solidarité ainsi qu’une réponse géopolitique plus large. La Déclaration de Tianjin de l’OCS illustre les conséquences profondes du terrorisme lié au Pakistan et l’influence diplomatique de l’Inde dans la région. Alors que les attaques de Pahalgam ont ravivé les tensions entre l’Inde et le Pakistan, entraînant une escalade diplomatique et des émotions négatives au sein de la diaspora indienne mondiale, elles ont également mis en lumière la nécessité de solidarité entre les communautés face au terrorisme. Les manifestations de la diaspora mondiale ont par ailleurs démontré la profondeur des liens transnationaux qui relient les immigrants d’origine sud-asiatique aux enjeux touchant leur pays d’origine. Le Canada, qui abrite une importante diaspora sud-asiatique, devrait donc se positionner comme un acteur à la fois équilibré et vigilant, en continuant de renforcer son engagement auprès de cette communauté et en encourageant sa représentation dans la politique étrangère afin de servir les intérêts canadiens — notamment en protégeant ses institutions démocratiques contre toute ingérence étrangère.
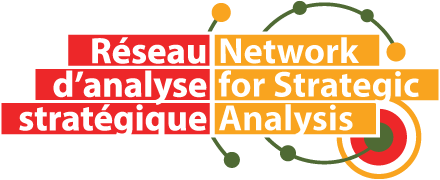



Les commentaires sont fermés.