Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a progressivement accru son aide militaire au gouvernement ukrainien, mais celle-ci demeure modeste en comparaison de celle fournie par ses principaux alliés occidentaux. Cet article avance deux arguments principaux. D’abord, la contribution limitée d’Ottawa reflète une perception d’une menace indirecte que représenterait la Russie pour ses intérêts nationaux. Le gouvernement canadien tend à cadrer le conflit comme une atteinte à l’ordre international fondé sur des règles plutôt que comme un risque immédiat pour sa propre sécurité. Cette lecture contraste nettement avec celle des États d’Europe de l’Est, pour lesquels la guerre constitue une menace existentielle nécessitant un engagement militaire substantiel.
Notre second argument met en lumière une lacune stratégique persistante : le Canada n’a pas anticipé les défis d’une éventuelle transition vers la paix, notamment le rôle que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et ses membres, dont le Canada, pourraient être appelés à jouer dans la stabilisation post-conflit. Or, la capacité du Canada à contribuer de manière significative à cet effort est limitée par ses ressources militaires actuelles. Il risque ainsi, une fois de plus, d’être pris de court par les exigences liées à la défense de la sécurité européenne face à une Russie résurgente.
Cet article propose une série de recommandations afin de remédier aux déficits structurels qui entravent l’adaptation de la posture de défense du Canada. Alors que le pays pourrait être appelé à jouer un rôle accru dans la région euro-atlantique, de nouvelles mesures sont nécessaires pour améliorer sa préparation opérationnelle et renforcer sa posture stratégique. Cela apparaît d’autant plus important dans un contexte de potentiel désengagement américain de l’architecture sécuritaire européenne.
***
Pour poursuivre la lecture, rendez-vous sur le site du Rubicon.
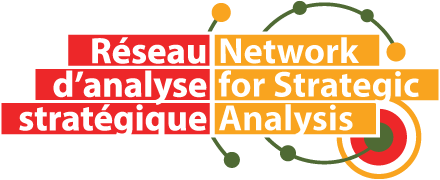


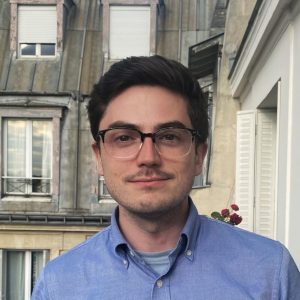


Les commentaires sont fermés.