Au cours des derniers mois, les menaces du président américain Donald Trump d’en faire le « 51e État » ont ravivé un sentiment d’insécurité nationale au Canada et suscité un cri de ralliement patriotique au sein de sa population. Par conséquent, de nombreux politiciens et experts canadiens réclament la fin de sa dépendance envers les États-Unis et la recherche d’une nouvelle étoile à laquelle s’accrocher. Si la diversification doit effectivement être poursuivie, ceux qui suggèrent que le Canada devrait couper les ponts avec les États-Unis (et peut-être adhérer à l’UE) ont besoin d’un retour à la réalité. Toute évaluation sérieuse du rôle du Canada dans le monde doit arriver à la conclusion que son partenariat avec les États-Unis demeure son plus grand atout.
Si avoir une discussion honnête sur les intérêts canadiens est l’objectif, il ne faut pas laisser l’orgueil et l’insécurité l’empêcher. Forger une identité et trouver la « place du Canada sur la scène mondiale » devrait commencer par accroître son rapport de force avec son partenaire indispensable (les États-Unis). À cette fin, le Canada devrait investir davantage dans ses capacités de défense afin d’obtenir ce que la plupart des Canadiens recherchent : 1) un plus grand pouvoir de pression auprès des États-Unis ; et 2) une plus grande capacité d’agir indépendamment des États-Unis, si nécessaire. Autrement dit, investir dans la défense du Canada, c’est investir dans son indépendance.
Les actes de Trump en disent plus que ses mots
Pour éviter d’être accusé d’être excessivement sympathique à l’égard du président américain actuel, permettez-moi d’être clair dès le départ : Trump représente une menace sans précédent pour la sécurité et la prospérité du Canada. Cependant, le partenariat étroit du Canada avec les États-Unis doit perdurer. En effet, aucun des deux pays ne peut survivre sans l’autre. S’il est nécessaire de se méfier des menaces impérialistes de Trump, il faut être encore plus attentif quant à ses actions, ou dans certains cas, à son inaction.
De son propre aveu, l’idée que Donald Trump ordonne une invasion militaire du Canada demeure extrêmement improbable. Son souhait d’intégrer le Canada au patrimoine immobilier américain est davantage ancré dans son flair à la P.T. Barnum et ses tactiques de négociation explosives que dans un programme réaliste. Tout comme Barnum, le célèbre showman qui captivait le public avec ses spectacles exagérés, Trump lance fréquemment des idées incendiaires sans les concrétiser, comme sa promesse non tenue de 2016 de construire un mur entièrement financé par le Mexique. Plutôt que de se laisser tromper par ses menaces constantes, bâtir un Canada plus résilient demeure la meilleure méthode pour protéger le pays.
L’indépendance commence chez soi
Pour assurer la sécurité et l’indépendance à long terme du Canada, la logique nous dicte d’investir dans notre infrastructure de sécurité nationale. Cela présente plusieurs avantages : protéger le Canada, faire de nous un allié plus fiable pour tous nos partenaires et bâtir une nouvelle identité nationale en tant que protecteur de notre pays et défenseur de nos alliés, et non en tant que suppliant ou acolyte ayant besoin d’un protecteur pour le protéger en cas de problème.
Un bon point de départ serait d’investir davantage dans la Marine et la Garde côtière canadiennes afin d’aider le Canada à affirmer sa souveraineté sur le plus long littoral du monde et d’apporter une aide précieuse à ses alliés pour sécuriser les voies de navigation maritime, contribuer aux patrouilles contre les activités illégales et dissuader les embargos maritimes, les points de congestion, les blocus et autres points chauds potentiels. De plus, alors que nous cherchons à intensifier nos relations avec de nouveaux alliés, le Canada doit se rapprocher de deux pays plus que tout autre : le Japon et la Corée du Sud. Une capacité navale plus forte permettrait au Canada de participer à des missions en Asie-Pacifique afin de consolider de nouvelles alliances. La majeure partie de la croissance commerciale du Canada et la majeure partie des risques politiques mondiaux se situent dans la région Indo-pacifique. La stratégie canadienne pour la région indopacifique, lancée sous Justin Trudeau en 2022, contenait des recommandations politiques similaires ; il suffit de les mettre en œuvre.
Des moyens navals accrus permettraient également de mieux protéger l’Arctique canadien. La Chine continue de cartographier clandestinement les fonds marins du Canada et de construire des brise-glaces équipés d’un submersible à plongée profonde qui pourrait mettre en péril les câbles sous-marins. Le Canada a franchi une étape importante dans son engagement à construire de nouveaux sous-marins et navires, mais il reste encore beaucoup à faire. Des systèmes maritimes autonomes, comme des véhicules sous-marins, une capacité anti-drone et des capteurs à déploiement rapide, doivent contribuer à la construction d’une nouvelle identité indépendante. Une forte présence maritime sur les côtes canadiennes et dans l’Arctique envoie un message fort aux États-Unis et au public canadien : son identité et sa défense ne dépendent pas uniquement de l’Amérique.
Mark Carney a annoncé une « nouvelle ère, » mais les choses ont-elles vraiment changé ?
La trame narrative du gouvernement Carney lors de sa campagne électorale concernant les relations canado-américaines était on ne peut plus clair : les États-Unis sont devenus un partenaire peu fiable et il est temps d’examiner des options alternatives. Dans son annonce concernant le renouvellement de l’armée canadienne, il a expressément mentionné que le Canada devait réduire sa dépendance envers les États-Unis et a promis des milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans une stratégie de défense industrielle canadienne ainsi que la participation à ReArm Europe, afin de diversifier les dépenses en défense. Aussi pures que soient ses intentions de se distancer des États-Unis, les actions de Mark Carney (jusqu’à présent) révèlent une tout autre réalité.
En matière d’acquisitions de matériel de défense, nous continuons d’acheter des produits américains pour le moment. Malgré de nombreuses suggestions selon lesquelles le Canada devrait cesser d’acheter des avions de chasse F-35 américains et confier le contrat à une compagnie basée en Europe, la vérité est que trouver un autre fournisseur à ce stade serait non seulement prohibitif en termes de prix, mais retarderait également un processus de remplacement entamé à la fin des années 1990 et censé avoir livré son dernier avion il y a 15 ans. La cheffe d’état-major de la défense du Canada, Jennie Carignan, a récemment exprimé son aversion pour le remplacement des F-35, affirmant que l’achat d’un avion européen ne ferait qu’augmenter les coûts.
En réalité, l’idée de se tourner vers l’Europe pour ses achats de défense repose également sur une évaluation très optimiste des possibilités réalistes pour le Canada en matière de développement industriel avec ses alliés transatlantiques. Si l’adhésion récente du Canada à un partenariat stratégique de défense et de sécurité avec l’Union européenne a donné l’impression que le secteur canadien de la défense peut désormais concourir pour des contrats en Europe, la dure réalité demeure : les marchés européens de la défense restent très protégés, les leaders industriels étant réticents à céder du terrain et étant eux-mêmes aux prises avec des pénuries d’équipement et des goulots d’étranglement de la production face à une demande renouvelée.
Même le Royaume-Uni doit aujourd’hui payer un prix d’entrée substantiel pour participer au programme de réarmement de l’UE et, malgré les nombreux discours de l’UE sur la nécessité de compter sur elle-même pour sa défense, il vient de promettre d’acheter jusqu’à 600 milliards de dollars d’équipement militaire américain dans le cadre de son accord commercial avec Washington. Le Canada peut s’attendre à des exigences similaires de la part de Trump, et nous y acquiescerons probablement. La dure réalité est que les entrepreneurs canadiens du secteur de la défense sont profondément ancrés dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines, tant sur le plan financier que technique et logistique. Ils ne peuvent pas simplement plier bagage et se réorienter vers un écosystème entièrement différent sans coûts, perturbations et incertitudes considérables.
En ce qui concerne la sécurisation du périmètre canadien, M. Carney semble se rapprocher de plus en plus des États-Unis, indiquant une ouverture au « Dôme doré » américain, soit au système de défense antimissile multicouche proposé par Trump pour les États-Unis. Si le Canada devait rejoindre le Dôme doré, Carney serait un pionnier de la défense du Canada : aucun premier ministre canadien – de Pearson à Mulroney, en passant par Justin Trudeau – n’a jamais officiellement conclu de partenariat avec les États-Unis en matière de défense antimissile. Une participation à la défense antimissile marquerait non seulement un tournant historique dans la politique de défense canadienne, mais renforcerait également le NORAD, la plus importante alliance de sécurité du Canada et le seul partenariat militaire que les États-Unis se soient engagés à honorer ad vitam æternam.
Sur le plan économique, le premier ministre Carney continue de forger ce qui pourrait bien être le partenariat canado-américain le plus étroit depuis une génération. Au cœur de cet effort se trouve son ambitieux projet de nouvel accord bilatéral de sécurité et de commerce – une initiative qui, selon Carney, est le fruit de discussions directes et continues (et de textos) avec le président Donald Trump lui-même. L’objectif : assurer la stabilité du marché à long terme et lever ou atténuer les tarifs douaniers qui menacent certains secteurs de l’économie canadienne. Pourtant, même sous le poids de tarifs punitifs, le Canada demeure le partenaire commercial le plus privilégié des États-Unis, bénéficiant d’un accès au marché plus large que tout autre pays. Ces développements contredisent fortement toute idée selon laquelle le Canada s’éloignerait de Washington ; en réalité, les données indiquent un partenariat qui se renforce – sur les plans économique, diplomatique et stratégique.
Condamné à réussir
Peu importe la tournure que prendront les relations entre le Canada et les États-Unis, nous resterons le principal partenaire de l’autre en matière de sécurité et de défense. Ceux qui réclament que le Canada abandonne les États-Unis et élabore un partenariat avec une nouvelle grande puissance (par exemple, l’UE) oublient sa position géographique unique et font preuve d’un optimisme excessif par rapport à ce que d’autres partenaires et alliés potentiels peuvent offrir. Si nous souhaitons véritablement l’indépendance canadienne, nous avons le pouvoir de nous porter sauver nous-mêmes en investissant dans notre défense et notre sécurité. Agir ainsi rendra le Canada plus résilient face aux pressions américaines. Pour ces raisons, une augmentation des dépenses de défense demeure le meilleur moyen de consolider les intérêts canadiens et de lui donner la force et l’indépendance nécessaires pour négocier avec les États-Unis en tant que partenaire, et non en tant que mendiant.
À propos de l’auteur
Ross O’Connor était auparavant conseiller aux affaires étrangères et à la sécurité nationale auprès du premier ministre Stephen Harper et conseiller politique principal auprès des ministres des Affaires étrangères et de la Défense.
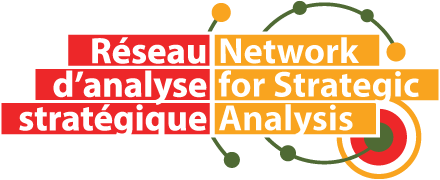



Les commentaires sont fermés.