Ce document illustre comment une perspective de sécurité écologique peut apporter un éclairage nouveau sur les liens entre le changement climatique, la sécurité et les relations entre les nations autochtones et les structures gouvernementales canadiennes. Le changement climatique menace la sécurité des individus, des communautés et des industries à travers le Canada et dans le monde entier. Une approche, celle du cadre de sécurité écologique, suggère que pour faire face aux menaces posées par le changement climatique, nous devons nous concentrer sur les processus écologiques eux-mêmes et les protéger. Je me penche ici sur le partenariat entre les gardiens marins Kitasoo/Xai’xais et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Cette analyse montre comment les programmes IMGP offrent une occasion pratique et coopérative d’œuvrer en faveur de la sécurité écologique au Canada, et suggère aux gouvernements fédéral et provinciaux d’investir dans les programmes de gardiens afin de soutenir à la fois la sécurité climatique et le leadership autochtone.
Introduction
Alors que les effets du réchauffement climatique dû à la dépendance continue aux combustibles fossiles deviennent de plus en plus pressants, les institutions et organisations nationales et internationales continuent de proposer des solutions hautement hiérarchisées visant à atténuer les effets du changement climatique tout en maintenant la stabilité nationale et internationale. En cette période de changements rapides, des débats ont surgi autour du concept même de « sécurité », avec des questions telles que « la sécurité pour qui ? » ou « la sécurité contre quoi ? », générant de multiples perspectives quant à une stratégie efficace pour traiter les questions climatiques et énergétiques. Une approche, le cadre de sécurité écologique, suggère que la sécurité doit être orientée vers la biosphère elle-même, les communautés vulnérables et les générations futures. Une approche de sécurité écologique exige des observateurs qu’ils reconsidèrent nos systèmes sociaux, économiques et politiques existants à la lumière de la menace existentielle que représente le changement climatique et qu’ils regardent au-delà des efforts institutionnels ou descendants étroits pour assurer la sécurité.
Dans le contexte canadien, une perspective de sécurité écologique peut apporter un éclairage nouveau sur les intersections entre le changement climatique, l’industrie extractive et les relations entre les structures de gouvernance autochtones et canadiennes. Étant donné que les changements de température, les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles touchent déjà de manière disproportionnée les communautés nordiques et autochtones, les discussions sérieuses sur la sécurité climatique au Canada doivent intégrer et prendre au sérieux les besoins des peuples autochtones. À bien des égards, le cadre de sécurité écologique offre une perspective plus accommodante dans laquelle explorer les options permettant de répondre aux besoins des peuples autochtones et des environnements locaux. Dans cette note, je présente une vue d’ensemble du cadre de sécurité écologique et soutiens que cette approche peut révéler des voies pratiques et viables pour des pratiques de sécurité non conventionnelles et intersectionnelles.
Plus précisément, le partenariat entre les gardiens maritimes Kitasoo/Xai’xais et BC Parks offre un exemple de cadre de sécurité écologique intersectionnel en pratique. Le chevauchement et la contestation des revendications d’autorité entre les gouvernements fédéral, provincial et autochtone illustrés par ce cas suggèrent que le concept de sécurité doit être examiné de manière critique dans un contexte écologique et que l’éventail des acteurs susceptibles d’assurer la sécurité doit être élargi.
Changement climatique, menaces environnementales et sécurité écologique
À ce jour, les principales instances chargées d’analyser et de relever les défis posés par les changements climatiques sont les institutions et les organisations nationales et internationales. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements nationaux, notamment au Canada et aux États-Unis, intègrent les changements climatiques dans leurs stratégies de sécurité nationale à des degrés divers. La dernière politique de défense du Canada, intitulée Notre Nord, fort et libre, intègre plus que jamais les implications des changements climatiques dans la planification de la défense canadienne. Des études récentes suggèrent qu’une grande majorité des États dans le monde ont également reconnu les liens entre le changement climatique et les défis liés à la sécurité nationale, et que beaucoup ont intégré des mesures telles que la réduction des émissions de GES, l’augmentation des fonds alloués aux secours en cas de catastrophe et une plus grande coopération entre les militaires et les civils sur les questions climatiques dans leurs plans et documents de sécurité nationale. En fait, 73 % de tous les documents stratégiques sur la sécurité nationale publiés entre 2008 et 2020 faisaient référence au changement climatique et aux effets des changements environnementaux sur la défense nationale. Au niveau international, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) organise depuis 2007 des débats sur le thème du changement climatique et de ses impacts. Une résolution présentée en 2021, qui a ensuite été bloquée, visait à formaliser le rôle de l’ONU dans la lutte contre les menaces liées au climat. En 2024, le Canada a parrainé l’ouverture du Centre d’excellence de l’OTAN sur le changement climatique et la sécurité, qui soutient la capacité des alliés à relever les défis liés à la sécurité climatique, à s’y adapter et à partager leurs connaissances en la matière.
Malgré cet intérêt et cette reconnaissance croissants, la définition de la relation entre le changement climatique et la sécurité, ainsi que les réponses jugées appropriées, font l’objet de vives controverses. Les institutions nationales et internationales ont tendance à considérer la sécurité climatique comme une menace pour la stabilité nationale et mondiale en raison, entre autres, de l’augmentation des migrations induites par le climat, de l’évolution des conditions météorologiques et de la raréfaction des ressources. Une certaine attention a également été accordée aux impacts du changement climatique sur les individus et les communautés, en particulier à travers les discours sur la sécurité humaine qui mettent en évidence les inégalités et les vulnérabilités structurelles, notamment les dynamiques liées au genre, à la race et au Nord-Sud.
Si la prise de conscience croissante et le mouvement général visant à lutter contre les implications du changement climatique sur la sécurité sont notables, certains chercheurs suggèrent que les analyses existantes négligent des aspects importants de la sécurité. À cet égard, le concept de sécurité écologique redéfinit la relation entre le changement climatique et la sécurité en réfléchissant de manière critique à cette intersection dans une perspective éclairée par les domaines de l’écologie politique, de l’économie politique internationale, de l’environnement et de l’éthique. La sécurité écologique met en avant la relation complexe et interdépendante entre les communautés et les processus écologiques eux-mêmes comme référence principale de la sécurité. Contrairement aux cadres conventionnels de la sécurité climatique, la sécurité écologique se concentre principalement sur la stabilité et la longévité des systèmes écologiques, plutôt que sur des objets de référence tels que les frontières nationales ou les systèmes internationaux. Les approches conventionnelles de la sécurité climatique considèrent généralement les gouvernements nationaux ou les institutions internationales comme les « acteurs » responsables de la sécurité, mais l’approche élargie de la sécurité écologique reconnaît le rôle des communautés locales dans la création de conditions de sécurité accrues.
Ce changement d’orientation nécessite une gamme différente de réponses et d’approches, les chercheurs suggérant un élargissement simultané de ce qui constitue la « sécurité » et un regain d’intérêt pour la refonte des systèmes socio-économiques existants, notamment la dépendance aux combustibles fossiles, les systèmes agricoles et le capitalisme mondial. Sans surprise, cette position a suscité de vives critiques de la part des décideurs politiques, des chercheurs et des observateurs, qui affirment que la « sécurité » dans ce sens est utopique, irréaliste et offre peu de solutions concrètes. Malgré cela, les travaux récents de Matt McDonald suggèrent que la sécurité écologique gagne du terrain sur le plan institutionnel, même si les progrès restent lents. Je suggère ici qu’une approche de la sécurité écologique existe déjà dans la pratique et n’est pas hors de portée, comme le suggèrent certains critiques. Plus précisément, nous voyons un cas de sécurité écologique mis en œuvre par les programmes autochtones de protection marine (IMGP) en Colombie-Britannique (C.-B.), qui donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un cadre de sécurité écologique en action.
Programmes autochtones de protection marine : le programme IMGP et le projet pilote Kitasoo/Xai’xais
Les programmes de gardiens marins autochtones (IMGP) sont des programmes professionnels mis en place par une Première Nation ou une coalition de nations afin de mener diverses activités environnementales, éducatives, culturelles et coercitives au sens large. Les IMGP ont pour objectif de mobiliser les connaissances autochtones et de développer une voie significative permettant aux peuples autochtones d’atteindre une plus grande autonomie dans la gestion de leurs territoires traditionnels. Les gardiens mènent des activités de surveillance, d’observation et d’application de la loi ; des activités liées à la recherche, telles que la collecte, l’analyse et la communication de données ; et des activités de sensibilisation, notamment des activités éducatives et culturelles, ainsi que la collaboration avec d’autres nations ou autorités locales et régionales. Ces programmes contribuent souvent à protéger les populations animales locales contre la chasse ou la pêche illégales, à recueillir des données sur les projets industriels proposés et à fournir des informations aux différents niveaux de gouvernement sur l’aménagement du territoire. Les IMGP sont reconnus comme des affirmations actives des droits autochtones, car ils offrent aux nations des moyens d’exercer leur autorité et leur autodétermination sur leurs territoires.
Les IMGP sont couramment intégrés dans la littérature universitaire et les espaces politiques sous l’angle de la conservation, car les gardiens sont considérés comme des protecteurs de l’environnement, des détenteurs de connaissances et des membres de la communauté investis dans la préservation de leur environnement. Cependant, reléguer ces programmes à la sphère technique de la gestion des terres ou des études environnementales peut conduire à négliger les dimensions sociales, politiques et même sécuritaires des IMGP. Pour de nombreux peuples autochtones, la santé et la survie de leurs territoires traditionnels, y compris la terre, l’air, l’eau et les animaux non humains, sont profondément liées à la sécurité de la nation et de son peuple. Comme les IMGP sont activement engagés dans la protection des territoires traditionnels, ils peuvent être considérés comme la mise en œuvre des principes de sécurité écologique. En termes simples, les gardiens autochtones agissent pour protéger leur écosystème local contre les menaces extérieures, assurer la survie à long terme de l’environnement et des personnes qui en dépendent, et incarner une politique de résistance et de renaissance en assumant des responsabilités en matière de réglementation, d’application et de gouvernance.
Les gardiens côtiers Kitasoo/Xai’xais sont l’un de ces IMGP, situé sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. En juin 2022, les nations Kitasoo/Xai’xais et Nuxalk ont signé un protocole d’accord avec BC Parks pour lancer le projet pilote Guardian Shared Compliance and Enforcement (Guardian Shared Compliance and Enforcement Pilot Project). Ce projet a donné lieu à un partenariat entre les nations et BC Parks, dans le cadre duquel 11 gardiens individuels des deux nations ont suivi une formation et se sont vu attribuer les mêmes pouvoirs légaux que les gardes forestiers de BC Park. Il est intéressant de noter que, bien que la nation Kitasoo/Xai’xais se soit associée aux autorités provinciales de la Colombie-Britannique pour le programme pilote, elle s’est en même temps publiquement opposée aux projets du gouvernement fédéral visant à établir une installation de GNL et une route d’exportation dans les eaux de Kitasoo/Xai’xais, déclarant unilatéralement la baie de Kitasu zone marine protégée en 2023 en vertu du droit autochtone. Par conséquent, s’il peut être tentant de considérer le partenariat entre les Watchmen et BC Parks comme un pas vers un rapprochement entre les autorités fédérales, provinciales et autochtones, la nation Kitasoo/Xai’xais n’a pas adopté une politique de coopération aveugle. Au contraire, ce cas met en évidence les relations complexes et controversées entre les autorités autochtones, provinciales et fédérales.
Discussion : contestation, coopération et sécurité
Le programme des gardiens côtiers Kitasoo/Xai’xias, associé à d’autres initiatives environnementales menées par les peuples autochtones, soulève des questions intéressantes sur la sécurité écologique dans la pratique et sur l’impact de la délégation de pouvoirs entre les gouvernements coloniaux et les gouvernements des Premières Nations sur ces initiatives.
J’ai déjà fait valoir ailleurs que les actions directes et les efforts de désobéissance civile, tels que la résistance des Wet’suwet’en et d’autres Premières Nations à la construction de nouveaux pipelines de pétrole et de gaz en Colombie-Britannique, constituent des exemples de sécurité écologique en action. Étant donné que ces mouvements sont menés par des communautés locales qui s’attachent à empêcher directement la poursuite des projets d’extraction, ils incarnent le cadre de la sécurité écologique en ce sens qu’ils considèrent l’environnement lui-même comme l’objet de la sécurité et qu’ils remettent sérieusement en question les systèmes socio-économiques actuels. À l’instar d’autres mouvements menés par des Autochtones contre des projets d’extraction, tels que ceux contre les pipelines Keystone XL et Dakota Access aux États-Unis, les Premières Nations pratiquent un « refus génératif » en mettant en œuvre une manière différente d’aborder l’environnement, tout en affirmant l’autorité et la légitimité des formes de gouvernance autochtones par le biais de manifestations.
De tels exemples de désobéissance civile mettent souvent en évidence les liens entre les luttes des Premières Nations contre l’autorité fédérale ou provinciale, la résistance à la dégradation de l’environnement et à l’industrie extractive, et la mise en œuvre de la sécurité écologique par l’action directe. La « sécurité » a une signification différente pour les communautés confrontées à l’oppression structurelle des autorités étatiques et qui subissent des menaces en temps réel sur leurs terres, leurs eaux et leurs écosystèmes. Will Greaves a fait valoir que les revendications des peuples autochtones du Canada en matière de sécurité sont souvent ignorées par les autorités fédérales et provinciales en raison du défi que représentent les revendications autochtones d’autodétermination pour les sociétés coloniales elles-mêmes. Étant donné que les revendications des nations autochtones en matière de légitimité et d’autorité menacent la souveraineté sous-jacente de la gouvernance canadienne, la sécurité des peuples autochtones ne peut être prise au sérieux par l’État. Tout comme la sécurité de l’environnement lui-même ne peut être prise en compte de manière adéquate sans remettre en question la domination des relations socio-économiques capitalistes, la sécurité des peuples autochtones nécessite de s’attaquer aux idées historiquement ancrées sur la légitimité et l’autorité de la gouvernance fédérale. Bien que cela puisse sembler être un problème insoluble, je propose que le partenariat entre les Kitasoo/Xai’xias et BC Parks représente une voie possible pour envisager la mise en œuvre d’une sécurité écologique intersectionnelle.
Comme indiqué ci-dessus, les gardiens Kitasoo/Xai’xais assurent la sécurité de leur écosystème et de leur communauté locale par leurs actions en tant que gardiens, avant même leur implication auprès du gouvernement provincial. Les gardiens eux-mêmes décrivent leurs activités de conservation et de surveillance comme l’incarnation de leur vision du monde, profondément liée à leur identité en tant que nation. Cependant, depuis leur partenariat avec BC Parks, l’autorité réelle et perçue des gardiens s’est accrue, car ils sont désormais en mesure de dresser des contraventions, d’infliger des amendes et d’appliquer la loi sur les parcs de manière indépendante. Il s’agit à la fois d’un renforcement de la capacité pratique des gardiens à assurer la sécurité de leur territoire et de leur communauté, et d’un changement important dans la capacité du gouvernement canadien à soutenir la sécurité des peuples autochtones eux-mêmes. En déléguant cette autorité à l’IMGP, la province de Colombie-Britannique contribue à renforcer la sécurité de la nation Kitasoo/Xai’xais, à la fois en soutenant l’autodétermination et l’autonomie de la nation et en renforçant la capacité des gardes à assurer la sécurité écologique sur leurs territoires.
Conclusion & Recommandations
Cette brève discussion vise à susciter une réflexion critique sur la notion de sécurité dans le contexte du changement climatique et des relations entre l’État canadien et les nations autochtones. Le cas des IMGP et des gardiens marins Kitasoo/Xai’xais nous incite à réfléchir à la manière dont la sécurité face au changement climatique peut nécessiter une approche multiforme et intersectionnelle, telle que celles qui aident les communautés locales et autochtones à assurer la sécurité à petite échelle, mais de manière significative. La sécurité écologique nous rappelle que tous les systèmes sont liés et que, par conséquent, les solutions doivent également couvrir différents lieux sociaux et niveaux de gouvernance.
Je suggère que les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada examinent sérieusement les possibilités de collaboration significative offertes par les IMGP et des programmes tels que le projet pilote de conformité et d’application partagées en Colombie-Britannique, et étudient les possibilités de collaboration avec les nations et les IMGP à travers le pays. Cette collaboration pourrait prendre la forme d’un réseau national de programmes de gardiens, soutenant et élargissant les 30 programmes de gardiens existants à travers le pays. Le programme australien des gardes forestiers autochtones pourrait servir d’exemple au gouvernement fédéral canadien à cet égard. D’un point de vue traditionnel de la défense, le gouvernement fédéral pourrait envisager d’élargir le rôle des peuples autochtones au sein des Rangers canadiens et d’intégrer des éléments des IMGP et de la gouvernance autochtone au sein des Rangers. En fin de compte, les gouvernements fédéral et provinciaux devraient s’efforcer d’adopter une perspective de sécurité écologique alors que le Canada s’enfonce davantage dans la crise climatique. Cela ne signifie pas nécessairement des changements immédiats et radicaux dans notre paysage politique et économique, mais peut être considéré comme une invitation à faire participer davantage de parties prenantes au débat sur la sécurité climatique et à reconnaître le potentiel du leadership autochtone à travers le pays.
À propos de l’autrice
Aly Tkachenko est doctorante en relations internationales et politique canadienne à l’Université de Victoria. Ses recherches portent sur les études critiques en matière de sécurité, le changement climatique, la sécurité océanique et la désobéissance civile. Aly est chercheuse au sein du Réseau nord-américain et arctique de défense et de sécurité (NAADSN) et bénéficiaire d’une bourse 2024 de l’Association canadienne pour la sécurité climatique (CSAC). Ses travaux à l’Université de Victoria sont supervisés par le Dr Will Greaves.
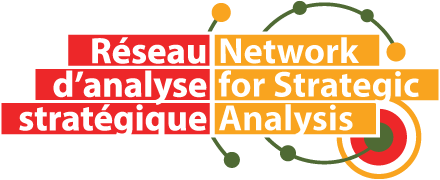



Les commentaires sont fermés.