Avant même que Donald Trump ne prenne ses fonctions il y a quatre ans, les médias prophétisaient une rupture majeure dans les relations avec l’Iran. Depuis des mois, advenant une victoire démocrate aux élections présidentielles de 2020, ces mêmes médias nous promettent un autre virage à 180 degrés. Et pourtant, les résultats de la prochaine élection présidentielle américaine ont peu de chances de modifier en profondeur la relation irano-américaine. Quelle que soit l’issue des urnes, il ne faut pas s’attendre à une « révolution » dans la politique de Washington vis-à-vis de la République islamique d’Iran. Rien pour l’heure n’indique que Donald Trump envisage de revenir sur sa stratégie de « pression maximale » dans l’éventualité d’un second mandat. S’il venait à le remplacer à la présidence des États-Unis, Joe Biden promet d’adopter une approche plus modérée – sans pour autant remettre en cause les postulats fondamentaux qui sous-tendent la politique iranienne de ses prédécesseurs. Oscillante à la surface, cette politique peut effectivement donner le sentiment d’incessantes ruptures et contradictions. Mais une analyse plus approfondie montre que, au-delà des différences de styles et de moyens, elle demeure étonnamment constante – guidée par des facteurs structurels qui dépassent les inflexions que lui donnent les locataires successifs de la Maison-Blanche. Revenons ici sur les raisons de cette continuité et sur quelques-unes de ses implications potentielles.
La première raison, sans doute la plus importante du côté américain, tient aux paramètres géopolitiques permanents qui fixent invariablement l’axe de la politique de Washington vis-à-vis de l’Iran. Pour s’en rendre compte, il faut prendre du recul historique, adopter une perspective « macro » et regarder la ligne directrice tracée par cette politique au cours des quatre dernières décennies. Depuis la révolution islamique et le fracassant divorce de 1979, Washington est en mode « récupération » – ce qui se traduit par un jeu à double vitesse. D’un côté, il s’agit de réengager la République islamique à travers le dialogue et une certaine forme de marchandage économique, diplomatique et militaire. De l’autre, il s’agit de limiter la capacité de nuisance du régime iranien sur la scène régionale et continentale. Malgré les périodes de chaud et de froid, les différentes administrations américaines ont toutes composé autour de cette partition géopolitique et sa logique binaire. Seule change la manière : les démocrates favorisent généralement la négociation, la concertation internationale et les approches multilatérales – sans toutefois abandonner l’usage de la contrainte. Quant à eux, les républicains privilégient l’unilatéralisme, l’interventionnisme, la force et l’intimidation sans jamais renoncer à ramener les Iraniens à la table des négociations. Au-delà des variations formelles de style et de ton, toutes les administrations ont pratiqué avec l’Iran cette politique de « fermeté-ouverture » et de « négociation-neutralisation ». Cette approche à deux vitesses se retrouve sous des formes variées dans la doctrine Carter, dans la posture plus ou moins intransigeante de Reagan et des Bush père et fils, dans le Dual Containment de Clinton ou dans l’option de la Main tendue d’Obama – mais en fin de compte elle obéit toujours à la même logique sous-jacente dictée par d’immuables facteurs d’ordre structurel.
Adepte de ce qu’il appelle lui-même « the art of the deal », Trump n’a fait que substituer une technique de vente agressive aux marchandages feutrés de ceux qui l’ont devancé dans le bureau ovale. Une approche frontale, voire brutale, qui, pourtant, n’est pas fondamentalement différente de la politique de « fermeté-transaction » de ses prédécesseurs dans la mesure où elle vise également à ramener les Iraniens à la table des pourparlers. Comme le souligne Dombrowski et Reich, « [a]u point d’être alarmant pour ses partisans et rassurant pour ses détracteurs, tout jusqu’ici suggère que le président Trump […] a lui aussi adopté, et continuera d’adopter, ce que le président Obama avait appelé avec ironie le ‘Washington Playbook’ ». Au terme du premier mandat Trump et malgré ces revirements spectaculaires, les experts tendent à relativiser la thèse d’une « révolution ». À leurs yeux, si le trumpisme imprime indéniablement un nouveau ton à la diplomatie américaine, il n’en continue pas moins de renforcer des tendances préexistantes. Certains soulignent que les changements observables au niveau tactique et caractérisés par l’utilisation de nouveaux « moyens » ne doivent pas être confondus avec des modifications d’ordre structurel ayant trait aux « finalités » de la politique étrangère américaine qui, elles, demeurent essentiellement pérennes. D’autres concluent que, derrière les accents de rupture, la politique iranienne de l’administration Trump s’inscrit dans la continuité de celle de l’administration Obama en ce qui concerne ses principes directeurs, à savoir diminuer l’influence régionale de la République islamique tout en l’empêchant de tomber dans l’escarcelle des grandes puissances eurasiatiques.
Quant à Joe Biden, s’il condamne irrévocablement la « pression maximale » de Trump, il fait totalement siens les fondements de la politique de « fermeté-transaction » de ses autres prédécesseurs. À la surface, tout dans la rhétorique du candidat démocrate laisse présager un revirement majeur dans la politique iranienne de Washington. « We urgently need to change course » a-t-il notamment déclaré lors d’une entrevue donnée à CNN, ajoutant notamment que : « By any objective measure, Trump’s « maximum pressure » has been a boon to the regime in Iran and a bust for America’s interests. » Pourtant, une lecture attentive de ce discours fait apparaître que ces désaccords affichés avec la doctrine Trump se situent davantage au niveau de la forme qu’au niveau du fond. Dans la même entrevue, Joe Biden précise: « there is a smart way to be tough on Iran, and there is Trump’s way. » S’il préconise de reconsidérer les moyens utilisés au cours des quatre dernières années, il demeure extrêmement conventionnel, voire conservateur, en ce qui concerne les objectifs poursuivis. Non seulement il s’agit d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme atomique, mais aussi de ramener ses dirigeants à la table des négociations pour obtenir – qui plus est – un accord plus englobant et plus contraignant que le JCPOA signé en 2015 – un accord élargi à la cessation des « activités déstabilisatrices » des gardiens de la révolution dans la région et à la suspension de l’ambitieux programme de missiles balistiques iraniens. Autant de clauses d’un nouvel accord que le candidat démocrate entend imposer à Téhéran et qui touchent à des aspects essentiels de la souveraineté iranienne tout en faisant écho à la politique de « fermeté-ouverture » et de « négociation-neutralisation » pratiquée par Washington au cours des quatre dernières décennies.
L’autre raison majeure pour laquelle le résultat des élections présidentielles américaines ne risque pas de modifier en profondeur les relations irano-américaines est que, à Téhéran, les dirigeants islamiques n’en attendent pas grand-chose et que, pour tout dire, ils affichent même le plus grand scepticisme. Une victoire démocrate permettrait certes au régime iranien de reprendre son souffle et d’espérer un relâchement de l’effort de strangulation politique, économique et militaire subie depuis bientôt quatre ans. Mais, exercée de manière plus diplomatique, ils savent pertinemment que la pression américaine ne cesserait pas pour autant. Surtout, la « doctrine Biden » continuerait, malgré tout, de menacer les impératifs stratégiques vitaux de l’Iran – des impératifs qui, même abordées avec la plus grande courtoisie, demeureront non-négociables aux yeux des Iraniens. En effet, la mise sous tutelle des programmes nucléaires et balistiques ajoutée à la diminution significative des activités régionales de Téhéran présente l’inconvénient de toucher des points cruciaux sur lesquels les Iraniens ne peuvent céder simultanément (se priver de l’assurance-vie nucléaire et, en même temps, de la sphère d’influence protectrice) sans risquer d’affaiblir la souveraineté interne et externe du régime. Autant dire des lignes rouges. Comme l’explique Richard Nephew, chercheur principal au Center on Global Energy Policy de l’Université Columbia et ancien fonctionnaire du département d’État, les exigences précédemment formulées par les occidentaux et désormais reprises par Biden « are beyond Iran’s willingness to even discuss ». S’ajoute à cela une raison supplémentaire pour laquelle il serait naïf de penser qu’un mandat démocrate se traduirait automatiquement par une amélioration des relations irano-américaines : les dernières années se sont accompagnées d’un renforcement majeur des “hardliners” qui, déjà donnés gagnants aux prochaines élections iraniennes, sont plus que jamais réticents à faire de nouvelles concessions envers Washington.
Une dernière raison, et pas des moindres, pour laquelle il est désormais peu probable que l’Iran décide malgré tout d’accepter les nouvelles conditions que lui proposerait un nouveau président américain tient aux orientations stratégiques adoptées par Téhéran au cours des dernières années – dont certaines avant même l’élection de Donald Trump. Parmi ces orientations stratégiques la plus importante est sans aucun doute le rapprochement majeur opéré avec les membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au premier rang desquels la Russie et la Chine. Des puissances eurasiatiques qui, en plus de promouvoir un ordre mondial plus multipolaire, partagent avec l’Iran une posture farouchement westphalienne ne souffrant aucune remise en cause des principes de souveraineté et de non-ingérence – y compris dans le domaine des droits humains. En témoignent la candidature iranienne à l’OCS et le nouveau partenariat stratégique de 25 ans que négocient actuellement Téhéran et Pékin. Certes, les dirigeants iraniens, éminemment pragmatiques et opportunistes, ne bouderaient pas la possibilité d’engranger quelques gains économiques ou diplomatiques si les Occidentaux leur en offraient la chance, mais ils le feraient avec précaution et retenue tant le régime se méfie désormais de cet Occident dans lequel, pour reprendre les mots employés par le ministre des affaires étrangères iranien, l’Iran « n’a jamais eu vraiment d’espoir ». Dans la même entrevue, ce même Zarif, pourtant du camp des modérés, déclarait déjà en 2019, que l’Iran s’est résolument tourné vers le « bloc eurasiatique » et que « the future of our foreign policy lies in that way ». De sorte qu’au-delà des changements politiques et des décisions ponctuelles auxquelles son évolution est souvent reliée à tort, la relation irano-américaine, bien moins fluctuante qu’elle n’y paraît, obéit avant tout aux forces profondes du jeu des grandes puissances et à son inexorable logique géopolitique.
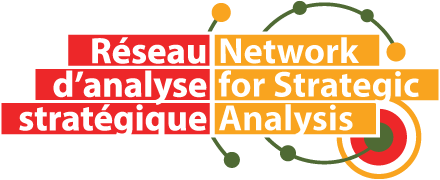




Les commentaires sont fermés.