Avec la chute de Kaboul, le Canada, les États-Unis et leurs alliés tentent maintenant de préserver toute la dignité possible de cette véritable débâcle. Par-dessus tout, il est nécessaire de sauver les réfugiés afghans. Et ils seront nombreux. Les talibans font des déclarations rassurantes, et les analystes débattront de la mesure dans laquelle ils ont changé, mais le risque de représailles et de répression est manifestement assez grand pour justifier un effort immédiat et à grande échelle.
Le Canada a certainement repoussé un tel effort trop longtemps. Ses alliés aussi. Lorsque l’administration Biden a annoncé son retrait unilatéral, elle n’avait manifestement aucun plan en place pour la logistique de l’évacuation de ses propres alliés, sans parler des réfugiés en général – et le Canada a été encore plus lent. Maintenant que les Américains contrôlent à eux seuls l’aéroport international Hamid Karzai, les talibans ne rendent pas l’accès facile.
Ce n’est pas par manque d’avertissement. L’idée existe depuis des années. Le Canada a créé un programme spécial pour les interprètes afghans en 2009, aussi inadéquat soit-il. Si la victoire des talibans a aveuglé beaucoup d’Occidentaux, il était évident que les insurgés étaient en pleine ascension : c’était le cas bien avant que l’administration Biden ne confirme le retrait américain.
Cette inaction n’est pas un accident; elle est symptomatique de l’approche occidentale vis-à-vis du conflit. Le transfert systématique des risques hors de l’Occident fait partie intégrale des guerres contemporaines. C’est un concept essentiel pour comprendre la politique à l’égard des réfugiés afghans. Essentiellement, les administrations Trump et Biden ont placé le transfert de risque au premier plan. La priorité de l’administration Biden était de faire sortir son peuple, ce dernier étant défini de manière à inclure le personnel militaire et les civils américains (et même les chiens), mais à reléguer ses alliés locaux et les civils afghans au second plan. Le Canada est parti il y a sept ans, puis a largement ignoré les risques que sa mission avait créés en Afghanistan.
La guerre de transfert de risques s’accompagne d’une distanciation et d’une dépersonnalisation, afin de maintenir ses propres soldats aussi loin que possible du danger tout en continuant à faire la guerre. Les drones en sont une manifestation. Le passage à des missions de renforcement des capacités en est une autre. D’une autre manière, l’embauche de contractants l’est aussi : le rapport établi par un contrat est plus distant que celui créé avec le soldat. Un gouvernement doit à ses soldats en uniforme une pension et des avantages sociaux (tels qu’ils sont), mais il se considère exempt de telles obligations envers les contractants. Souvent, le Canada et les États-Unis ne semblent pas savoir qui a travaillé pour leurs efforts de guerre. C’est à l’employé de le prouver, en faisant appel personnellement au service des ressources humaines de son entreprise.
La dépersonnalisation, cependant, a ses limites, comme l’affirme Kristian Kristensen dans le cas du Danemark. Ce n’est pas un hasard si, dans tout l’Occident, la question des réfugiés afghans commence par les interprètes. Pendant les combats actifs, ils ont tissé des liens profonds avec les soldats canadiens, américains et des autres pays membres de l’OTAN, qui dépendaient d’eux pour rester en vie et accomplir leurs missions. C’est avec une grande douleur que les soldats de l’OTAN contemplent le sort de leurs camarades.
Ces liens tissés sur le champ de bataille ont donné aux interprètes une légitimité morale sans faille, en plus de fournir des alliés dynamiques et influents à l’Occident, et même cela n’a pas suffi pour que des mesures soient prises en temps utile. Mais les pays de l’OTAN ont des obligations éthiques beaucoup plus larges, notamment envers des milliers d’Afghans qui n’ont jamais fait partie d’une bande de camarades avec les troupes occidentales, mais qui ont travaillé pour ou avec des forces extérieures et qui sont menacés pour cette raison. Les talibans s’en sont pris à des entrepreneurs qui construisaient des routes pour les forces extérieures, ainsi qu’à des fonctionnaires locaux qui soutenaient les missions des Américains et de l’OTAN sans jamais être des employés officiels. Bien que tout ancien employé soit éligible au programme de visa canadien et américain, l’élan pour réinstaller les interprètes est le plus fort, et le programme américain les place explicitement en tête de liste (voir p. 5 ici). Reste à savoir si cela se poursuivra dans le chaos de Kaboul.
Plus largement, nous avons l’obligation, comme nous l’avons toujours fait, de secourir tout réfugié ayant besoin d’aide, qu’il ait travaillé pour nous ou non. Les efforts visant à réprimer la migration afghane (comme ceux du président français Emmanuel Macron) sont méprisables. Ils constituent, une fois de plus, un transfert de risques : les risques politiques pour les politiciens occidentaux se traduisent par des risques physiques pour les Afghans. La déclaration de Macron était flagrante, mais la même logique s’applique aux efforts bureaucratiques moins médiatisés visant à limiter les programmes de visa que le Canada, les États-Unis et d’autres pays ont appliqués à l’Afghanistan (en excluant les personnes ayant travaillé moins de douze mois pour une mission, en exigeant que les demandeurs soient en Afghanistan, en incluant les enfants mineurs, mais pas les enfants adultes des contractants, ou – même maintenant – en exigeant des passeports). Plus généralement, cela s’applique au processus de demande de statut de réfugié, dont la lourdeur est un problème chronique.
En bref, les efforts d’évacuation sont essentiels si nous voulons reconnaître où se situent les risques de nos guerres et réduire autant que possible ces risques pour les personnes vulnérables. Les risques liés à l’association avec le Canada méritaient les efforts de notre gouvernement il y a déjà plusieurs années. Ils méritent maintenant toute l’attention d’Ottawa. Le Canada acceptera 20 000 réfugiés d’Afghanistan et ne s’arrêtera pas à ceux qui ont travaillé pour ce pays et c’est une bonne chose. Les Canadiens peuvent aider à la réinstallation. Mais il est difficile d’ignorer l’inattention et le retard. De nombreuses personnes qui ne peuvent se rendre à l’aéroport périront, et même cette option pourrait ne pas subsister longtemps.
Le gouvernement du Canada – la Défense nationale, Affaires mondiales et le ministère de l’Immigration et Citoyenneté surtout – doit également agir bien au-delà de l’Afghanistan : nos opérations militaires à l’étranger reposent sur les populations locales. Si l’accent général mis sur le renforcement des capacités plutôt que sur le combat permet d’ignorer plus facilement les risques, ceux-ci ne disparaissent pas pour autant. Il n’est pas exagéré d’imaginer l’État islamique, les séparatistes en Ukraine ou Al-Qaïda ciblant ceux qui ont travaillé avec ou pour des forces extérieures comme celles du Canada. Nous ne devons pas transférer ces risques à notre guise. Nous devons rapidement évaluer les risques pour nos autres opérations en cours ou récemment terminées. Nous devons assurer un bien meilleur suivi des personnes qui travaillent pour nous. Nous devons prévoir ce que ces personnes pourraient subir, et ce dont elles auront besoin de notre part, pour avoir travaillé aux missions de ce pays. En outre, en tant que pays qui ne mène jamais seul des missions militaires dans des zones de conflit, la protection des alliés locaux et les conditions de retrait doivent constituer une partie importante de la façon dont le Canada négocie les conditions de sa participation avec ses alliés et ses partenaires de coalition.
Ce genre de mesures pratiques, destinées à atténuer le risque des interventions militaires dans les zones de conflit pour les alliés locaux, est nécessaire en raison des opérations canadiennes en cours. Mais le déshonneur serait encore plus grand si l’héritage de l’Afghanistan consistait simplement à trouver de meilleures façons d’éviter l’embarras à la fin de guerres que nous n’aurions jamais dû mener en premier lieu. La leçon la plus importante doit être d’aborder le recours à la force avec la prudence requise, non seulement en raison des risques pour nous, mais aussi en raison des risques pour toutes les personnes concernées. Il faut cesser une fois pour toutes de traiter la vie des populations touchées par les conflits comme si elle était moins importante que la nôtre.
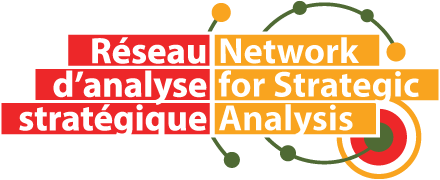




Les commentaires sont fermés.