|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
(La fin de l’ère Assad en Syrie : Entre pressions internationales et défis intérieurs – Gianmarco Fontana)
Après des années d’impasse, la guerre civile syrienne est revenue sur le devant de la scène internationale. Au cours des deux dernières semaines, le pays a été le théâtre d’une série d’événements sans précédent qui ont bouleversé son paysage politique et qui ont abouti à la chute du régime de Bachar el-Assad dans la nuit du dimanche 8 décembre. Profitant de l’instabilité et de l’incertitude, une coalition diversifiée de rebelles a lancé une offensive qui a débuté dans les centres urbains du nord – Idlib et Alep – et a rapidement progressé vers Damas.
L’effondrement rapide du gouvernement de Bachar el-Assad marque la fin de plus de cinq décennies de pouvoir centralisé et coercitif de la famille Assad. Ces développements inattendus s’inscrivent dans un contexte plus large qui englobe des dimensions nationales, régionales et internationales. Une analyse approfondie de ces facteurs est essentielle pour comprendre les implications de ce bouleversement et ce que l’avenir pourrait réserver à la Syrie, qui s’engage dans une transition potentielle vers un nouveau modèle de gouvernance. Ce rapport examine les facteurs géopolitiques et nationaux qui ont conduit à ces événements transformateurs, qui ont interrompu cinquante ans de régime autocratique et plus de 14 ans de conflit. Cette nouvelle voie intérieure pour le pays doit être analysée à travers les questions d’ordre régional et international, car l’imbrication des dimensions nationales et internationales représente le caractère unique du cas syrien.
Du plan intérieur…
Le régime Assad, établi après le coup d’État de Hafiz al-Assad en 1970 et dirigé par Bashar al-Assad depuis 2000, se caractérise à la fois par la continuité et le changement par rapport à son prédécesseur. Ce régime se caractérise par un fort personnalisme, des élites soigneusement sélectionnées et fidèles au président, un vaste appareil de contrôle et de répression, l’exclusion des minorités de la gouvernance et un mépris des droits de l’homme. Les réformes économiques et sociales ont été largement absentes, ce qui a alimenté un mécontentement généralisé dans le pays. L’arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad en 2000 a d’abord suscité des espoirs de réforme. Après trente ans de règne sans partage de Hafiz al-Assad, beaucoup considéraient le jeune Assad, avec son éducation occidentale et son image moderne, comme un catalyseur potentiel de changement. Au début de son mandat, Bachar a réussi à positionner la Syrie entre deux blocs : le « bloc occidental », représenté par la France – l’ancien dirigeant colonial du pays – et les États-Unis, et le « bloc oriental », composé de partenaires de longue date tels que la Russie et l’Iran. Ce jeu d’équilibre diplomatique a été de courte durée, les espoirs de modernisation s’estompant au milieu des années 2000 après le « printemps de Damas ». L’optimisme qui a brièvement émergé pendant le « Printemps de Damas » a cédé la place à une nouvelle frustration publique, préparant le terrain pour les soulèvements de 2011.
Ce mécontentement a atteint un point de basculement en mars 2011, lorsque des manifestations civiles ont éclaté dans le cadre d’une vague plus large de soulèvements dans toute la région. Ce que l’on appelle le « printemps arabe » – une expression souvent rejetée par les spécialistes parce qu’elle simplifie à l’excès et néglige les luttes politiques qui se déroulaient depuis longtemps dans les sociétés arabes bien avant 2011 – a servi de toile de fond aux Syriens pour exiger des réformes.
… aux facteurs internationaux : l’internationalisation du conflit
Les manifestations de 2011 contre le régime Assad, motivées par des griefs généralisés concernant la corruption, la stagnation économique, les divisions sectaires et l’exclusion politique, ont rapidement fait l’objet d’une répression brutale. Cette réaction a fragmenté l’opposition et empêché une mobilisation nationale coordonnée. La stratégie du régime consistant à diviser pour régner s’est avérée essentielle pour étouffer la dissidence.
Dès l’été 2011, des fissures sont apparues au sein des forces de sécurité d’Assad. D’importantes défections au sein de l’armée syrienne ont conduit à la formation de l’Armée syrienne libre (ASL), une coalition de groupes d’opposition armés. Initialement axée sur la protection des civils contre les forces gouvernementales, l’ASL s’est progressivement orientée vers la libération des principaux centres urbains, notamment Homs, Suwayda, Idlib et Alep. Cependant, l’absence d’un leadership unifié et d’une stratégie cohérente a entravé leurs efforts, laissant l’opposition vulnérable aux divisions internes et aux manipulations externes.
L’opposition fragmentée est rapidement devenue un champ de bataille pour les intérêts régionaux et internationaux. Alors que le régime d’Assad recevait un soutien militaire et financier constant de la part de Moscou et de Téhéran, l’opposition a bénéficié de l’appui de toute une série d’acteurs extérieurs. Les États-Unis et les pays européens ont apporté un soutien financier et diplomatique limité, mais ont évité toute implication militaire directe, craignant de répéter les erreurs de l’Afghanistan (2001), de l’Irak (2003) ou de la Libye contemporaine (après 2011). Dans le même temps, les États du Golfe tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar ont soutenu les factions de l’opposition, bien que de manière incohérente en raison de rivalités internes. La Turquie, acteur régional majeur, a profité du conflit pour poursuivre ses intérêts stratégiques, en particulier dans le nord de la Syrie.
L’émergence de l’État islamique (ISIS) entre 2014 et 2019 a ajouté une nouvelle couche de complexité au conflit, incitant une coalition internationale dirigée par les États-Unis à intervenir sous la bannière de la lutte contre le terrorisme. En 2020, un accord ténu entre la Russie et la Turquie a ramené un calme relatif dans le nord de la Syrie. Les efforts de normalisation, y compris la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe en 2023, semblaient indiquer une détente entre les puissances régionales. Toutefois, la flambée de violence d’octobre 2023, provoquée par un regain de tensions entre Israël et les groupes de résistance palestiniens, a ravivé l’instabilité régionale.
Cet environnement instable a détourné l’attention des alliés d’Assad, ce qui a encore affaibli l’emprise de son régime sur le pouvoir. La Russie reste empêtrée dans sa guerre contre l’Ukraine, le Hezbollah a une trêve fragile avec Israël, et l’Iran est préoccupé par son programme régional plus large – principalement axé sur la préservation de la zone d’influence qui le relie à la Syrie, au Liban et au Hezbollah dans un effort pour dissuader le rival israélien. Ces dynamiques changeantes illustrent l’interconnexion profonde entre les bouleversements intérieurs et la géopolitique internationale au Moyen-Orient, où les intérêts et les identités des acteurs étatiques sont inextricablement liés.
L’effet domino : La chute rapide de Bachar el-Assad
Le pic d’instabilité intérieure et l’évolution de la dynamique régionale ont ouvert la voie à une série d’événements décisifs au cours des deux dernières semaines. Des groupes rebelles basés dans les villes d’Alep et d’Idlib, dans le nord du pays, ont lancé une offensive contre l’armée syrienne, affaiblie par des années de conflit et privée du soutien nécessaire de son allié russe. Les insurgés se sont rapidement emparés des principaux centres urbains du nord, notamment Alep et Idlib, avant de progresser vers le sud le long de l’autoroute M5, principal axe routier nord-sud de la Syrie. En quelques jours, ils ont pris le contrôle de Hama et de Homs, avant d’arriver à Damas entre le 7 et le 8 décembre.
La chute rapide de Damas a marqué la fin du règne de Bachar el-Assad. Le président s’est réfugié en Russie, demandant l’asile à son plus puissant allié. Cette évolution dramatique a été facilitée par la Turquie, qui a longtemps maintenu une « zone tampon » dans le nord de la Syrie. Depuis 2020, les cellules antigouvernementales d’Idlib et d’Alep, dont beaucoup sont soutenues par la Turquie, ont établi un contrôle de facto sur la région. Cette proximité avec la frontière turque, combinée aux préoccupations d’Ankara concernant la présence kurde dans le nord-est de la Syrie et le fardeau que représente l’accueil de plus de trois millions de réfugiés syriens, a fait du nord de la Syrie un point central de la politique étrangère de la Turquie.
La composition des forces antigouvernementales souligne la complexité de l’opposition. Bien que le terme « rebelles » soit souvent utilisé comme un descripteur général, ces groupes sont loin d’être homogènes. À Idlib et à Alep, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), un groupe djihadiste anciennement affilié à Al-Qaïda, a joué un rôle de premier plan aux côtés de factions soutenues par la Turquie, telles que l’Armée syrienne libre. Malgré leurs idéologies et leurs objectifs divergents, ces groupes se sont temporairement unis pour atteindre un objectif commun : l’éviction du régime d’Assad.
Après le départ d’Assad, la Syrie est confrontée à une grande incertitude. Alors que les insurgés et les civils ont célébré la chute du régime qui avait régné d’une main de fer pendant plus de cinq décennies, des doutes subsistent quant à la capacité du pays à construire un modèle de gouvernance inclusif et stable. Cherchant à atténuer le risque de chaos, l’ancien premier ministre Mohammad Ghazi al-Jalali et d’autres ministres sont restés en Syrie, assurant au public que les institutions de l’État continueraient à fonctionner pendant la transition. En coordination avec Abu Mohammad al-Julani, le chef du HTS, al-Jalali a nommé Mohammed al-Bashir à la tête d’un gouvernement de transition. M. Al-Bashir, qui a précédemment dirigé le gouvernement de salut syrien à Idlib, est chargé de superviser la transition jusqu’à ce que les conditions permettent la tenue d’élections libres et ouvertes à tous. La trajectoire politique de M. Al-Bashir reste incertaine, tout comme ses liens avec les dirigeants du HTS qui ont mené l’offensive depuis le nord. Auparavant, il occupait un poste de direction au sein de la société d’État Syrian Gas Company, qui fait partie du ministère du pétrole. Toutefois, depuis 2022, il a été ministre du développement, puis premier ministre, au sein de l’administration d’Idlib contrôlée par le HTS.
Aujourd’hui, M. Al-Bashir est confronté au formidable défi que représente l’avenir de la Syrie. Son rôle consiste à favoriser le dialogue non seulement entre les diverses factions nationales du pays, mais aussi avec les acteurs internationaux qui s’investissent dans la trajectoire de la Syrie. Sa capacité à jouer un rôle de médiateur dans ces dynamiques complexes sera déterminante pour les perspectives de stabilité et de reconstruction du pays. L’actuel gouvernement de transition syrien comprend les mêmes ministres qui ont servi au sein du gouvernement de salut syrien (SSG), l’organe directeur de la région nord du pays qui échappe au contrôle du régime Assad depuis plusieurs années. Cette institution est affiliée à Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), le groupe responsable du lancement des récentes opérations spéciales il y a deux semaines. Le gouvernement de transition est chargé de maintenir le fonctionnement des institutions de l’État pendant au moins 18 mois, dont 6 mois pour rédiger une nouvelle constitution, jusqu’à la tenue de nouvelles élections.
Malgré les célébrations généralisées parmi les Syriens dans leur pays et à l’étranger, les défis à venir sont immenses. Le retour de près de six millions de réfugiés sera déterminant pour la gouvernance du pays. La réforme des institutions de l’État, qui ont longtemps été vidées de leur substance pour servir un cercle étroit de pouvoir, nécessitera des réformes visant à favoriser l’inclusion et la représentation. En outre, le démantèlement du sectarisme ancré par des décennies de domination alaouite sera essentiel à l’établissement d’une société unifiée et équitable.
La communauté alaouite, une branche du chiisme, constitue une minorité en Syrie, où environ 70 % de la population est sunnite. D’autres groupes, dont les Druzes, les Kurdes, les chrétiens et les chiites, contribuent également à la diversité du tissu social du pays. La famille Assad, qui fait partie de la communauté alaouite, a toujours tiré parti de son statut de minorité pour échapper à la marginalisation à laquelle ce groupe est généralement confronté dans la hiérarchie sociale syrienne. Depuis la présidence de Hafiz al-Assad, le régime a systématiquement exploité les tactiques sectaires pour fragmenter et affaiblir l’opposition, consolidant ainsi son emprise sur le pouvoir. Cette stratégie n’a toutefois pas eu d’effets bénéfiques pour l’ensemble de la communauté alaouite. Au contraire, le régime Assad a coopté de manière sélective des élites de diverses communautés, y compris des élites économiques sunnites, pour asseoir son autorité. Ces alliances révèlent à quel point les divisions sectaires visaient moins l’autonomisation des communautés que la consolidation pragmatique du pouvoir. La résilience du régime ne reposait pas uniquement sur le favoritisme sectaire, mais sur l’inclusion stratégique d’individus dont l’influence politique ou économique pouvait favoriser sa survie, indépendamment de leur affiliation sectaire. Ainsi, le sectarisme et la cooptation en Syrie ont fonctionné comme deux piliers interdépendants de la stratégie du régime Assad, illustrant comment les politiques identitaires ont été instrumentalisées pour maintenir le pouvoir plutôt que pour promouvoir les intérêts d’une communauté spécifique.
Le chemin vers la reconstruction de la Syrie en tant qu’État cohésif, démocratique et prospère sera ardu, exigeant une navigation prudente dans des divisions politiques, sociales et économiques profondément enracinées.
L’avenir de la Syrie et de la région MENA : L’avenir du contexte géopolitique
Dans les circonstances actuelles, il est impératif d’analyser de manière critique les facteurs qui ont conduit à la fin de l’ère Assad, tout en considérant leurs implications pour la Syrie et le Moyen-Orient au sens large. Bien que les prévisions géopolitiques soient par nature incertaines, l’exploration des conséquences régionales potentielles fournit des indications précieuses.
Parmi les acteurs régionaux, la Turquie semble avoir été l’un des principaux bénéficiaires de la chute d’Assad. Tirant parti de sa position unique de pont entre l’Europe et le Moyen-Orient, Ankara a habilement fait avancer ses objectifs de politique étrangère tout au long du conflit syrien. La création d’une zone tampon dans le nord de la Syrie, l’accueil de plus de trois millions de réfugiés syriens et son opposition au régime d’Assad et aux aspirations kurdes dans le nord-est de la Syrie ont permis à la Turquie de consolider son influence. Cette approche a renforcé le rôle d’Ankara en tant qu’acteur indispensable dans le processus de transition de la Syrie. En outre, l’implication de la Turquie dans la modération de factions telles que le HTS au cours du processus d’Astana met en évidence sa capacité à naviguer dans les complexités du conflit tout en sauvegardant ses intérêts stratégiques. Ces dernières années, la Turquie s’est habilement positionnée entre deux blocs : ses alliés de l’OTAN et les soutiens internationaux d’Assad, la Russie et l’Iran. L’acuité stratégique d’Ankara réside dans sa capacité à faire avancer ses objectifs de politique étrangère en Syrie et dans la région au sens large en capitalisant sur l’indécision et l’ambiguïté de ses alliés occidentaux tout en maintenant simultanément . En participant aux négociations visant à stabiliser la Syrie, la Turquie est parvenue à jouer un rôle de médiateur entre ces acteurs divergents, ce qui met en évidence la complexité de ses motivations et de ses choix en matière de politique étrangère.
Cet équilibre a parfois placé la Turquie en porte-à-faux avec ses alliés de l’OTAN, en particulier lorsque les troupes kurdes ont été soutenues par les États-Unis pour combattre ISIS, ce qui a renforcé les tensions au lieu d’un plan commun pour la stabilité dans la région. En outre, Ankara s’est notamment concentrée (et se concentre toujours) sur l’affaiblissement des forces kurdes dans le nord de la Syrie, qui sont soutenues par les États-Unis en tant que partenaires clés dans la campagne anti-ISIS. Cette divergence met en évidence la priorité accordée par la Turquie à ses préoccupations en matière de sécurité nationale, en particulier en ce qui concerne la question kurde, par rapport à l’alignement sur les objectifs plus larges de l’OTAN.
Le double positionnement de la Turquie a renforcé son rôle d’acteur pivot dans le conflit syrien. L’influence d’Ankara s’étend désormais non seulement à l’élaboration de la dynamique intérieure de la Syrie, mais aussi au maintien des canaux diplomatiques entre les sponsors internationaux d’Assad, ses propres intérêts stratégiques et ceux des alliés de l’OTAN, y compris les États-Unis. Ces derniers restent déterminés à préserver leur présence dans la région pour faire contrepoids à l’influence russe et iranienne.
La situation dans le nord-est de la Syrie représente un défi majeur. Riche en ressources naturelles telles que le pétrole et l’eau, cette région reste sous l’influence des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition à majorité kurde qui a maintenu une gouvernance semi-autonome. Ankara considère l’affiliation des FDS au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), un groupe désigné comme organisation terroriste par la Turquie et plusieurs pays occidentaux, comme une menace directe. La gestion de cette tension sera au cœur de la stratégie régionale de la Turquie.
Au sud, Israël a adopté une position plus affirmée, pénétrant le territoire syrien pour la première fois depuis 1973 (à l’exclusion des hauteurs contestées du Golan). Selon certains médias israéliens, la chute d’Assad constitue un point d’interrogation important pour Tel-Aviv, car « pour le meilleur et pour le pire, Assad était le diable qu’Israël connaissait ». Si la Syrie et Israël entretiennent depuis longtemps des relations tendues, la présidence de Bachar el-Assad a été marquée par des décennies de relative stabilité frontalière.
Son départ présente donc à la fois des opportunités et des risques pour les intérêts stratégiques d’Israël. D’une part, le départ d’Assad pourrait affaiblir les liens entre l’Iran et ses alliés régionaux, notamment la Syrie, l’Irak et le Hezbollah. Ces derniers jours, Israël a mené plus de 300 frappes aériennes visant des installations militaires syriennes afin d’empêcher que des armes ne tombent entre les mains de groupes extrémistes. La chute d’Assad représente donc une opportunité d’affaiblir l’influence régionale de l’Iran, en particulier son soutien au Hezbollah, dans le but de saper ce que l’on appelle « l’axe du mal » – une ligne imaginaire de continuité reliant l’Iran, la Syrie, l’Irak et le Hezbollah dans une zone stratégique influençant la stabilité régionale et internationale. D’autre part, la transition en Syrie pourrait permettre aux factions rebelles islamistes de prendre pied dans la nouvelle structure de gouvernance du pays. Israël n’a cessé d’exprimer ses inquiétudes quant au vide politique en Syrie, considérant cette évolution comme une menace potentielle pour sa sécurité et sa position régionale.
La Russie, alliée de longue date d’Assad, est désormais confrontée au défi de rééquilibrer sa position. Tout en offrant l’asile à Assad, Moscou reste profondément investie dans le maintien de son ancrage stratégique en Syrie, en particulier sa base navale de Tartous – le seul avant-poste de la Russie en Méditerranée – et sa base aérienne de Lattaquié. Le Kremlin a assuré qu’il était prêt à dialoguer avec les nouveaux dirigeants syriens, dans le but de préserver ses implantations militaires et d’empêcher une nouvelle déstabilisation de la région.
Les pays occidentaux ont adopté une approche prudente. Les nations européennes ont exprimé leur soutien au peuple syrien dans ses efforts pour se libérer de la dictature d’Assad, mais leur implication directe reste limitée. Pendant ce temps, le président américain nouvellement élu, Donald Trump, a réitéré une position isolationniste en matière de politique étrangère, soulignant que l’avenir de la Syrie est une question que les Syriens doivent résoudre, tout en reprochant au Kremlin d’avoir abandonné son principal partenaire dans la région. Tout au long de la crise syrienne, les États-Unis ont joué un rôle ambigu et fluctuant. Si leur intervention la plus notable a eu lieu pendant la campagne contre l’État islamique, où ils ont fourni un soutien militaire – y compris des frappes aériennes et des formations – aux milices kurdes, ce soutien a ensuite été réduit pendant la première présidence Trump. La réduction subséquente de l’implication des États-Unis a donné à la Turquie une plus grande marge de manœuvre dans le nord de la Syrie.
Ces derniers jours, coïncidant avec la dernière ligne droite de sa présidence, Joe Biden a fait remarquer que l’approche américaine avait influencé l’équilibre régional, ce qui a incité l’administration à réévaluer son engagement en Syrie. Cependant, il n’existe aucune preuve d’un soutien direct ou d’une coordination entre Washington et les groupes rebelles dirigés par le HTS, responsables de la récente offensive.
Malgré leur prudence, les États-Unis ne sont pas restés passifs. Peu avant les opérations rebelles, Washington a mené des frappes aériennes visant les milices syriennes soutenues par l’Iran en réponse à une attaque contre la base de Shaddadi. En outre, les forces américaines ont mené des opérations spéciales contre les restes de l’État islamique, cherchant à empêcher le groupe d’exploiter le vide créé par la chute d’Assad.
La stratégie américaine semble se situer à mi-chemin entre les politiques de Biden et de Trump. Cette approche vise à affaiblir simultanément l’influence régionale de l’Iran et le positionnement mondial de la Russie, à protéger son allié israélien et à maintenir un certain degré de leadership dans la région.
Conclusion
La situation en Syrie reste extraordinairement complexe. Le pays est aux prises avec les conséquences durables d’un conflit civil qui a duré plus d’une décennie, tout en s’engageant dans une nouvelle phase de reconstruction politique, sociale et économique après plus de cinquante ans de gouvernance par la famille Assad. Au cœur de ce processus se trouve la nécessité de favoriser le dialogue entre les principaux acteurs nationaux, y compris les civils, les diverses factions rebelles et les institutions en place. Dans ce contexte, la réintégration des millions de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays est particulièrement cruciale, car ils constituent une part importante de la population syrienne et doivent être habilités à contribuer à la création d’une société libre et plus inclusive.
Le rôle des acteurs internationaux qui sont intervenus à des degrés divers tout au long du conflit est tout aussi crucial. La poursuite de leur engagement et de leur dialogue est essentielle pour empêcher l’émergence d’un vide de pouvoir, qui pourrait exacerber la radicalisation et menacer la stabilité de l’ensemble de la région. Alors que la Syrie entre dans une nouvelle phase d’incertitude, son avenir reste lié à l’interaction des forces régionales et internationales. Le règlement des griefs de longue date, la promotion d’une gouvernance inclusive et la reconstruction du tissu social nécessiteront un équilibre délicat entre la coopération nationale et étrangère. Pour la région MENA, la chute d’Assad signale non seulement un changement dans la politique syrienne, mais aussi un réalignement potentiel de la dynamique des pouvoirs régionaux, dont les résultats se répercuteront dans les années à venir.
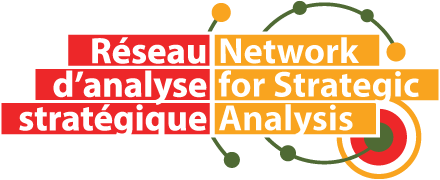




Les commentaires sont fermés.