Résumé
Le Canada est actuellement soumis à une pression intense pour atteindre les 2% du PIB consacrés à la défense et les 20% des dépenses de défense affectés à l’équipement, convenus par l’OTAN. Simultanément, le Canada est confronté à une baisse de productivité. En examinant les dépenses de défense actuelles du Canada, sa politique actuelle et son écosystème de R&D, ce document propose d’utiliser l’augmentation des dépenses de défense pour renforcer la politique d’innovation du Canada afin de faciliter la commercialisation et de l’aligner sur les besoins en matière de défense. Pour ce faire, il suggère 1) de renforcer la capacité de commercialisation du programme IDEaS en s’inspirant du programme DIANA de l’OTAN, 2) de remanier la stratégie canadienne en matière d’IA afin de mettre l’accent sur les partenariats militaires et civils et 3) de moderniser la stratégie du ministère des Transports en matière de drones afin de mettre l’accent sur la technologie des drones à double usage.
Introduction
En 2014, les membres de l’OTAN se sont engagés à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses de défense dans les dix ans à venir. 10 ans plus tard, 23 des 32 membres ont atteint cet objectif. Dans le prolongement de cet engagement, le président Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises les membres de l’alliance pour ne pas avoir atteint cet objectif, allant jusqu’à demander que la barre soit relevée à 5% alors que les États-Unis consacrent actuellement 3,38% de leur PIB à la défense. En réponse, le ministre canadien de la défense a promis d’atteindre l’objectif de 2% dans les deux ans. Il n’y a pas eu de plans clairs sur la manière dont il compte y parvenir, ni de mise à jour officielle du gouvernement, puisque la politique la plus récente, approuvée par les deux principaux candidats au poste de premier ministre, vise à ne pas atteindre cet objectif d’ici à 2032.
Malgré cette incertitude, un domaine semble particulièrement opportun : les dépenses d’équipement. L’une des promesses secondaires de l’objectif des 2% est de consacrer au moins 20% des dépenses de défense aux équipements majeurs, y compris la recherche et le développement (R&D). Le Canada en consacre actuellement 18,6%. Dans le même temps, le Canada prend du retard en matière d’innovation et de productivité, bien qu’il dispose d’une expertise de premier plan dans des industries contemporaines telles que l’intelligence artificielle et l’aérospatiale, ainsi que d’une population très instruite. Une politique recentrée sur les technologies à double usage telles que l’intelligence artificielle (IA) et les drones est l’occasion de faire d’une pierre deux coups : résoudre le problème de la commercialisation de la R&D et respecter les deux engagements de l’OTAN.
Le plan de dépenses actuel
La politique officielle actuelle du Canada, décrite dans la mise à jour de la politique de défense de 2024 intitulée Notre Nord fort et libre, vise à augmenter progressivement les dépenses chaque année jusqu’en 2030 au moins. Les dépenses de la politique mettent l’accent sur l’entretien des navires et des équipements, ainsi que sur la production de munitions. Bien qu’elle ne détaille aucune dépense au-delà de 2030, elle mentionne le souhait d’atteindre l’objectif de 2% d’ici 2032. À cette fin, le Canada a élaboré un plan de modernisation du NORAD, qui prévoit un investissement de près de 40 milliards de dollars sur 20 ans. Conformément à ce plan et en réponse à la proposition du président Trump de créer un système de défense antimissile inspiré du « Dôme de fer » en Amérique du Nord, le Canada a proposé de développer le système de capteurs, un programme qui pourrait encore impliquer davantage de dépenses.
Les futurs plans de dépenses
Alors que le Canada est en pleine campagne électorale, les deux principaux candidats ont des propositions limitées pour actualiser la politique actuelle. Pierre Poilievre, le candidat conservateur, n’a pas donné beaucoup de détails sur son plan pour atteindre l’objectif de l’OTAN. Il a déjà déclaré qu’il maintiendrait la politique actuelle (libérale) en matière de dépenses de défense. Il a également déclaré qu’il réduirait « l’aide étrangère inutile » pour atteindre l’objectif et, plus récemment, il a souligné que l’Arctique serait un élément clé de ses plans de défense. Le nouveau premier ministre et candidat libéral, Mark Carney, a promis d’accélérer le plan actuel de deux ans au cours de la course à la direction. Il a également annoncé un partenariat avec l’Australie pour développer la technologie des radars « Over-the-Horizon » pour l’Arctique. On ne sait pas s’il s’agit d’un nouvel investissement ou d’une partie du plan de dépenses actuel.
Dépenses actuelles du Canada
L’OTAN répartit les dépenses de défense en quatre catégories : Équipement, Personnel, Infrastructure et Autres (opérations). À première vue, les dépenses du Canada en matière d’infrastructure sont conformes à celles des autres membres de l’OTAN, mais les dépenses en matière de personnel et d’opérations sont plus élevées que dans les autres domaines. Les dépenses relativement faibles en matière d’équipement, qui comprennent la recherche et le développement (R&D), suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une voie sous-explorée pour réaliser de nouveaux investissements.
Le personnel
Bien que l’augmentation du personnel augmente directement la capacité, les Forces armées canadiennes (FAC) n’ont pas atteint les objectifs de recrutement au cours des trois dernières années, le personnel militaire disponible étant, au mieux, en stagnation. Néanmoins, les FAC ont récemment mis en œuvre d’importants changements pour faciliter le recrutement, en assouplissant les critères médicaux et en accélérant le processus de recrutement. Elles ont également amélioré les conditions de travail des membres de la force. Le recrutement reste une préoccupation importante, et des initiatives politiques clés ont été prises, mais il est peu probable que les dépenses en personnel augmentent de manière drastique au cours des prochaines années.
Infrastructures
La situation des infrastructures est similaire à celle du personnel. Des investissements supplémentaires seraient théoriquement possibles. Avec seulement 60% de l’infrastructure du ministère de la Défense nationale (MDN) dans un « état convenable », ils sont même nécessaires. Cependant, la nature à long terme de l’investissement dans l’infrastructure et l’approche du « paiement réellement effectué » pour le calcul des dépenses de défense font qu’il n’est guère possible de procéder à un redressement rapide pour atteindre l’objectif de 2%. Bien qu’ils sortent du cadre de cette analyse, les investissements dans les infrastructures doivent figurer dans le plan à moyen et long terme et joueront certainement un rôle important dans le maintien de l’objectif de 2% et dans la garantie d’une capacité durable. En outre, à l’instar de la R&D et comme l’a reconnu la vice-ministre de la Défense nationale, les infrastructures militaires ont souvent un double usage, comme les pistes d’atterrissage dans l’Arctique qui relient les communautés éloignées et les logements pour les FAC qui réduisent les pressions sur le marché commercial.
Opérations (autres)
Les dépenses d’opérations – essentiellement les munitions, le carburant et les réparations – sont peu susceptibles de faire bouger l’aiguille à court terme, car les FAC sont déjà particulièrement actives dans les missions d’entraînement et consacrent une part importante de leur budget aux opérations. Ce problème est aggravé par le fait que les coûts d’exploitation augmentent souvent avec le personnel et, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, il est peu probable qu’ils augmentent à court terme. En outre, les dépenses actuelles, gonflées par les dons à l’Ukraine, pourraient se calmer, puisque des négociations de cessez-le-feu sont en cours.
L’équipement
L’équipement comprend deux composantes principales : l’acquisition et la R&D. Près de la moitié des équipements étant « indisponibles et inutilisables », les dépenses d’acquisition devront constituer une priorité majeure des futurs budgets. Néanmoins, même si le gouvernement canadien voulait dépenser l’argent, il pourrait ne pas être en mesure de le faire avec son approche actuelle. Le directeur parlementaire du budget estime que les dépenses d’équipement sont réduites de 25% en raison des retards constants dans la passation des marchés, ce qui suggère la nécessité d’envisager d’autres possibilités de dépenses, en particulier si le calendrier devient plus serré. Ces retards risquent d’être encore aggravés par le réexamen des marchés publics aux États-Unis et par la pression exercée sur la base industrielle de l’Europe par le réarmement du continent. Ces deux problèmes soulignent la nécessité et l’opportunité de développer une industrie nationale de développement technologique. Le manque de personnel met également en évidence l’importance des dépenses en R&D : avec moins de troupes, l’efficacité devient plus importante. En outre, avec l’une des populations les plus instruites au monde et un certain nombre de centres de recherche et d’universités de haute technologie, le Canada dispose d’un vaste réservoir d’employés potentiels pour les industries lourdes en matière de recherche et de développement.
Un coup d’œil sur les dépenses du Canada par rapport aux autres membres de l’OTAN et sur le contexte géopolitique actuel suggère que l’équipement est une bonne catégorie à cibler pour l’augmentation des dépenses.
Le Canada et la R&D
L’examen des dépenses fournit une raison de mettre l’accent sur la R&D, mais les caractéristiques économiques du Canada ainsi que les tendances récentes en matière de R&D, tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Alliance, plaident en faveur d’une telle orientation. L’OTAN a récemment accordé une grande importance au développement des équipements, le Canada devant accueillir le bureau nord-américain de l’Accélérateur d’innovation pour la défense dans l’Atlantique Nord (DIANA) de l’OTAN.
En accueillant ce bureau, le Canada est bien placé pour contribuer aux investissements de l’OTAN dans la recherche et en tirer profit. L’objectif de DIANA est d’amener les jeunes pousses sur le marché, mais c’est aussi là que le Canada est le plus en retard par rapport à des pays comparables. En effet, le Canada se classe au dernier rang pour ce qui est de la capacité de ses jeunes entreprises à s’adapter et à se lancer sur le marché, ainsi que pour ce qui est du financement moyen par jeune entreprise. L’association du financement de la R&D et des besoins militaires permet de résoudre ces deux problèmes. Le Canada est également toujours moins performant que ses pairs en ce qui concerne l’intensité de la recherche (dépenses de R&D/PIB). L’industrie de la défense étant trois fois plus intensive en recherche (dépenses de R&D en pourcentage des bénéfices) que le secteur manufacturier au sens large, son démarrage pourrait aider le Canada à rattraper son retard. Investir dans l’industrie de la défense est aussi particulièrement intéressant pour son impact sur l’économie canadienne dans son ensemble, car l’industrie maintient 55% des dépenses de sa chaîne d’approvisionnement au Canada.
Investir dans la R&D en matière de défense ouvre également la voie au développement de technologies à double usage qui pourraient renforcer la capacité du Canada à mener des recherches de pointe. L’OTAN donne la priorité à neuf domaines technologiques perturbateurs. Parmi ceux-ci, en 2022, à peine 3% des entreprises canadiennes auront adopté l’intelligence artificielle et un peu plus de 2% la robotique. Cette statistique reflète la baisse du financement réel de la R&D au Canada depuis des décennies. Enfin, l’investissement dans la R&D atténue également un autre problème du Canada : sa population relativement peu nombreuse. Comme le montre la résistance de l’Ukraine à l’agression russe, la technologie agit comme un multiplicateur de force pour les armées. Le Canada ne sera jamais en mesure de fournir un nombre significatif de troupes à l’OTAN, mais il peut néanmoins renforcer l’ensemble de l’organisation en mobilisant son économie forte, sa population hautement qualifiée et son écosystème de recherche intégré.
Principaux domaines d’action
Le Canada dispose actuellement de deux principaux programmes de financement de la recherche en matière de défense : Innovation pour l’excellence et la sécurité en matière de défense (IDEaS) et Mobilisation des connaissances en matière de défense et de sécurité (MINDS). MINDS vise principalement à trouver des solutions en matière de politique et d’information du public, tandis qu’IDEaS a pour objectif de combler les lacunes technologiques de la défense canadienne. Les deux sont considérés comme des dépenses de défense, mais IDEaS s’aligne plus directement sur la partie développement de la R&D, car il fournit un soutien et un financement à toutes les étapes du cycle d’innovation, de la génération d’idées aux essais en conditions réelles.
Malheureusement, depuis son lancement en 2018, IDEaS n’a permis qu’à quatre projets d’atteindre la phase de « test ». Ce fait, ainsi que l’absence d’étapes de post-développement telles que la commercialisation, ont été soulignés comme des faiblesses clés du programme dans son évaluation 2023. Cette évaluation a également souligné que cette étape était considérée comme une « meilleure pratique internationale » par des programmes similaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Toutefois, le problème central est insidieux, car les technologies militaires à usage unique ont un potentiel commercial limité en dehors des armées. Ce défaut souligne la nécessité de concentrer la recherche sur les technologies à double usage, qui peuvent ensuite être commercialisées sur un plus grand marché. Le recentrage du programme IDEaS afin d’encourager le développement de technologies à double usage et d’accroître le financement et le soutien à la phase de commercialisation offrirait ainsi une voie plus ciblée pour le développement de capacités de défense à l’échelle de la production de masse et contribuerait à la mise sur le marché de technologies de rupture canadiennes. Le programme IDEaS devrait donc être complémentaire des nouveaux accélérateurs DIANA de l’OTAN, qui partagent le même objectif mais l’abordent avec une orientation résolument commerciale.
Deux technologies complémentaires méritent d’être soulignées en raison de leur potentiel pour le Canada : l’intelligence artificielle et les drones.
Intelligence artificielle
Le Canada a connu un grand succès dans le développement de la recherche fondamentale en matière d’intelligence artificielle, un universitaire britanno-canadien basé à l’université de Toronto ayant récemment reçu le prix Nobel pour « les découvertes fondamentales qui permettent l’apprentissage automatique ». Le Canada s’est donc distingué en tant qu’acteur précoce dans ce domaine, étant le premier pays à établir une stratégie nationale globale et à élaborer la Charte numérique. Cet avantage s’est légèrement émoussé au cours des dernières années, mais la structure formelle des instituts de recherche et le conseil consultatif restent des acteurs clés de la promotion de l’utilisation éthique de l’IA.
Plus récemment, l’industrie canadienne a éprouvé des difficultés à rendre ses recherches opérationnelles. La stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle a tenté de relever ce défi en confiant la commercialisation à trois instituts. Toutefois, le manque de concentration et d’orientation de la politique a produit des résultats mitigés, notamment en ce qui concerne la propriété et l’adoption de la technologie au niveau national. L’ajout d’un pilier de défense à la stratégie, comprenant des orientations sur les technologies prioritaires, pourrait s’avérer judicieux. Ce pilier pourrait prendre la forme de partenariats militaro-civils, qui résoudraient les deux problèmes en traçant une voie claire entre la recherche et le marché et en alignant les besoins militaires sur la recherche, ce qui garantirait la demande. Cette collaboration, comme le montre le projet Maven des États-Unis, permet au secteur technologique de développer des produits utiles qui correspondent étroitement aux besoins militaires, tout en finançant la recherche sur ces technologies qui peuvent ensuite être commercialisées. Le Canada devrait s’appuyer sur ses forces en matière d’éthique et de développement de l’IA pour s’assurer que son industrie reste au premier rang mondial, non seulement pour ses capacités, mais aussi pour sa fiabilité.
Drones
Bien que l’OTAN ne considère pas les drones comme une « technologie émergente et perturbatrice », leur fabrication se situe en aval de chacune des neuf technologies, à l’exception de l’une d’entre elles. Les drones ont été spécifiquement ciblés dans le défi 2024 de DIANA. Le Canada est déjà un leader mondial de l’industrie aérospatiale civile, se classant parmi les quatre plus grands producteurs de moteurs et d’avions.
Pourtant, l’industrie canadienne des drones est à la traîne. En 2024, la CAF achètera pour la première fois des drones de combat. Ces drones seront entièrement fabriqués par une entreprise américaine basée en Californie. Alors que le Canada reconsidère la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement de défense intégrée avec les États-Unis, il devient impératif que le développement de cette technologie future se fasse, au moins partiellement, au Canada. La nécessité d’une production nationale est encore renforcée par l’importance de la capacité arctique pour le Canada, une capacité qu’aucun drone ne possède actuellement, et par les nouvelles opportunités de marché que le réarmement européen (qui exclut les sociétés américaines) pourrait peut-être créer.
Cette année est également un moment clé pour l’industrie des drones au Canada, car la stratégie en matière de drones, établie en 2021, arrive à échéance cette année. Cette politique est résolument axée sur la gestion civile et la gestion des risques, mais son renouvellement ouvre la voie à une refonte de sa structure. La section 4.4 prévoit actuellement des investissements dans la recherche sur la sécurité et charge le ministère des transports de simplifier l’accès au marché en alignant la certification internationale. Le partenariat entre le ministère des transports et le ministère de la défense, qui figure déjà dans la stratégie, pourrait être renforcé par l’ajout d’un deuxième pilier à cette section. Il s’agirait de fournir des investissements supplémentaires dans les technologies des drones à double usage – en particulier au stade du développement et de la commercialisation – et de garantir l’interopérabilité avec les autres membres de l’OTAN. Cette approche s’aligne sur l’accent mis par le fonds de défense de l’UE sur l’augmentation de l’interopérabilité et l’investissement massif dans le renouvellement technologique rapide pour rattraper la Russie et la Chine.
Conclusion et recommandations
Le Canada est soumis à une pression intense pour atteindre l’objectif de 2% de l’OTAN : les États-Unis menacent de se retirer de l’organisation ou d’imposer des droits de douane, et il fait désormais partie de la faible minorité de membres qui n’a pas atteint le seuil de référence depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine. L’équipement militaire du Canada s’effondre, tandis que son écosystème d’innovation ne parvient pas à fournir des technologies de rupture. La capacité d’innovation du Canada a été entravée par un sous-investissement chronique et sa croissance économique a été freinée par une faible productivité et l’incapacité à commercialiser la population extrêmement éduquée du pays.
Ces défis peuvent être relevés en concentrant les investissements dans la R&D de défense et en alignant la recherche civile et militaire. Bien entendu, le Canada ne sera pas en mesure de remplir la totalité de ses obligations envers l’OTAN en augmentant simplement ses dépenses en R&D. Cependant, cette voie est sans doute la plus prometteuse pour le Canada. Cependant, cette voie est sans doute la plus utile, la plus pratique et la plus évolutive pour augmenter les dépenses de défense, tout en maximisant les avantages pour l’économie canadienne. Le Canada doit exploiter son potentiel en investissant dans des industries clés et en créant des cadres d’orientation, notamment en
- Renforcer le programme IDEaS pour encourager les technologies à double usage et faciliter la commercialisation, conformément aux accélérateurs Diana de l’OTAN ;
- En remaniant la stratégie du Canada en matière d’IA pour lui donner un pilier de défense clair, en alignant les besoins de la défense sur l’utilité civile ;
- Moderniser la stratégie du ministère des transports en matière de drones afin de mettre l’accent sur la recherche et le développement de technologies de drones à double usage.
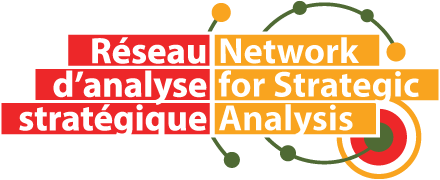




Les commentaires sont fermés.