Dans ce monde qui se referme, les États-Unis endossaient le rôle de puissance stabilisatrice et parfois même de puissance bienveillante. Ils œuvraient à encadrer l’ordre international libéral et à défendre, lorsque cela était jugé possible et souhaitable, le droit international. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser le passé; il est vrai que certaines administrations se sont écartées de ce rôle. L’unilatéralisme de George W. Bush et la violation du droit international lors de l’invasion de l’Irak, ou encore les atrocités commises sous les présidences Johnson et Nixon en Indochine, justifiées par la lutte contre le communisme, sont des exemples évidents. Mais malgré ces dérives, les administrations qui se sont succédé depuis 80 ans ont été guidées par des fondamentaux communs, à savoir : la recherche de stabilité, l’attachement au libéralisme économique et la promotion de la démocratie libérale.
En lieu et place, Donald Trump propose une politique étrangère prédatrice, nationaliste et égocentrée en rupture avec l’idéal qui fut porté par ses treize prédécesseurs, républicains comme démocrates. Dans ce monde qui s’ouvre, Trump remplace l’influence et le pouvoir d’attraction (le soft power), qui ont fait le succès de la puissance américaine depuis Harry Truman, par une approche fondée sur la coercition, le chantage et la force.
Au cours des 100 derniers jours, c’est toute la grammaire de l’action internationale américaine qui a été brutalement transformée. Le respect des frontières internationales fut remis en cause, notamment à travers la volonté de Trump de redessiner unilatéralement la frontière avec le Canada. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes fut ignoré, comme en témoigne le mépris affiché envers les aspirations du peuple ukrainien. Le soutien au développement international fut mis à mal par le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Enfin, la gouvernance multilatérale des grands défis mondiaux fut délaissée, par le retrait d’organisations comme l’OMS ou d’accords internationaux tels que l’accord de Paris sur le climat.
Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est bien plus qu’un simple changement d’orientation : c’est une sorte de révolution de la politique étrangère du pays qui fait voler en éclat le consensus moral et stratégique des 80 dernières années.
Adieu coopération, bonjour coercition
Dans ce monde qui s’ouvre, Donald Trump considère les accords internationaux « gagnant-gagnant » comme des signes de faiblesse de la part des États-Unis. C’est que sa vision du monde repose exclusivement sur une logique de rapports de force, où la puissance américaine doit prévaloir sans compromis. C’est pour cette raison que les actions qu’il a posé au cours des 100 premiers, pensons à l’utilisation de sanctions économiques et de tarifs douaniers, s’inscrivent résolument dans une logique de jeu à somme nulle : une quête obsessionnelle de gains faits sans discernement aux dépens des alliés comme des adversaires, au mépris des relations diplomatiques établies et des principes du droit international.
L’ambition affichée par Trump de s’emparer de territoires stratégiques, comme le Groenland et le canal de Panama, de même que sa volonté d’annexer le Canada par asphyxie économique, illustrent parfaitement cette logique. Trump ne cache pas sa volonté de recourir, si nécessaire, à la force militaire pour atteindre ses objectifs. Lors de son discours sur l’état de l’Union en février dernier, il a affirmé sans détour que les États-Unis prendraient le contrôle du Groenland « d’une manière ou d’une autre ». Puis, la visite récente du vice-président J. D. Vance sur ce territoire autonome danois, riche en ressources naturelles et d’une importance croissante dans l’Arctique, témoigne une fois de plus de cette volonté expansionniste.
Pourquoi cet élan expansionniste ?
Les motivations derrière cette volonté expansionniste sont multiples. Dans le cas du Groenland, Trump semble chercher à s’assurer un accès direct à des ressources stratégiques telles que les minéraux critiques et les métaux rares, éléments indispensables à l’économie et à la défense des États-Unis. Trump semble opérer sous l’impression que les États-Unis accusent un retard sur la Chine dans le contrôle de ces ressources. Comme si un fossé stratégique devait être comblé rapidement dans le domaine.
L’intérêt pour le Groenland et le Canal de Panama révèle également une volonté de renforcer le contrôle stratégique des passages maritimes majeurs. L’annexion de ces points géostratégiques offrirait à Washington un levier militaire et économique dans l’optique d’une rivalité croissante avec la Chine et, dans une moindre mesure, avec la Russie.
Cette rhétorique expansionniste répond aussi au discours ambiant sur le déclin relatif des États-Unis face aux puissances émergentes. L’acquisition de nouveaux territoires est perçue comme un moyen de renforcer le statut de superpuissance américaine, en consolidant une « forteresse » américaine capable de rivaliser avantageusement avec les puissances en émergence.
Au cours de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a rompu radicalement avec les principes qui ont guidé la politique étrangère américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Par sa rhétorique belliqueuse et ses actions unilatérales, il s’impose déjà comme l’un des présidents américains ayant le plus contribué à banaliser le recours à la force pour atteindre ses objectifs. Son approche agressive légitime, de facto, les stratégies de coercition territoriale de dirigeants autoritaires comme Xi Jinping, concernant Taïwan, et Vladimir Poutine, en l’Ukraine.
Implications pour la politique étrangère du Canada
Le renversement radical de la politique étrangère américaine depuis le 20 janvier dernier ne signifie pas pour autant l’effondrement des piliers de la politique étrangère canadienne. Le Canada demeure un États résolument libre-échangiste, profondément engagé envers l’OTAN et attaché au multilatéralisme. En témoignent les efforts actuels du gouvernent Carney pour renforcer ses échanges économiques avec des partenaires européens et asiatiques, avec lesquels le Canada a déjà conclu des accords de libre-échange.
Lors de la campagne électorale fédérale, le premier ministre Carney déclarait d’ailleurs que si l’administration Trump refusait d’assumer son rôle de leader mondial, le Canada, pour sa part, était prêt à prendre le relais. Bien qu’il s’agisse d’une déclaration électorale visant à mobiliser la fibre nationaliste canadienne plutôt que d’un engagement fondé sur les capacités réelles du pays à occuper une telle position, elle traduisait néanmoins l’état d’esprit du nouveau premier ministre. Elle réaffirmait la volonté du Canada de préserver les fondements de sa politique étrangère, même dans un contexte international marqué par l’instabilité et la coercition américaine.
Implications pour la souveraineté et la défense du Canada
Là où les choses se compliquent dangereusement pour le Canada, c’est au niveau de sa politique de défense. Les déclarations de l’administration Trump sur l’asphyxie économique du pays pour mieux nous annexer comme 51e État, ou encore sa volonté de redessiner la frontière canado-américaine représentent les menaces les plus sérieuses à la sécurité et à la souveraineté canadienne depuis la fondation du pays il y a 158 ans. L’heure n’est plus à l’incrédulité, mais bien aux plans de contingence.
De telles prises de position appellent une conclusion claire : bien plus que la Chine ou la Russie, c’est l’administration américaine actuelle qui représente la plus grande menace pour le Canada car elle s’attaque de manière intentionnelle et persistante à nos intérêts vitaux. Tout cela dans un contexte où le mouvement nationaliste et protectionniste sur lequel elle s’appuie semble désormais s’inscrire dans la durée.
Même si Trump venait à modérer ses propos à l’égard du Canada, le mal est déjà fait. Ses déclarations provocatrices ont contribué à ancrer, au sein de la droite radicale américaine, l’idée qu’une annexion du Canada pourrait être non seulement possible, mais aussi souhaitable, voire nécessaire. Dans un contexte marqué par l’accélération des changements climatiques, la raréfaction de l’eau douce et l’intérêt grandissant pour les métaux stratégiques et autres ressources naturelles, les vastes richesses canadiennes suscitent une convoitise croissante. Si Trump ne cherche pas à s’en emparer activement cette fois-ci, il est fort possible que l’un de ses héritiers politiques envisage cette possibilité avec davantage de sérieux dans l’avenir.
Le Canada est seul
Dans ce contexte, atteindre l’objectif des 2 % du PIB consacré à la défense pourrait certes valoir au Canada une reconnaissance accrue au sein de l’OTAN, mais ne modifiera en rien l’asymétrie de puissance entre le Canada et les États-Unis. De même, un rapprochement stratégique avec la France ou le Royaume-Uni, ne saurait atténuer de manière significative notre immense vulnérabilité stratégique face à Washington. En cas d’agression américaine, un resserrement des liens avec l’Europe resterait essentiellement symbolique car aucun partenaire européen ne risquerait une confrontation directe avec la première puissance militaire mondiale pour défendre le Canada.
D’ailleurs, la réaction molle des alliés européens, tout comme celle, embarrassée, du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, face aux visées expansionnistes de Donald Trump sur le Groenland et aux menaces répétées à l’endroit du Canada, est révélatrice. En somme, tant que les États-Unis respectent notre souveraineté et se comportent en partenaires responsables, le Canada peut compter sur un large éventail d’alliés. Mais dès qu’une administration américaine adopte une posture hostile, c’est le silence radio. Le Canada se retrouve alors seul, entièrement tributaire de la volonté de Washington.
Ce constat brutal appelle une réflexion stratégique articulée à la fois sur le court et le long terme. À court terme, il est essentiel de maintenir les meilleures relations possibles avec les États-Unis, car, quoi qu’on en dise, ils demeureront notre principal partenaire économique. En parallèle, il est impératif de réduire notre exposition aux risques économiques causés par notre dépendance excessive au marché américain. Il nous faut donc « dérisquer » notre sécurité économique en diversifiant activement nos partenariats à l’échelle mondiale et en renforçant notre résilience nationale, notamment par une croissance soutenue du commerce interprovincial.
Sur le plan de notre autonomie stratégique, Shimooka, Lanoszka et Devlen ont raison de souligner que le désir d’un rapprochement avec l’Europe repose en partie sur une réaction émotive à l’égard de Trump. Cette dimension affective tend à brouiller le jugement et à occulter les limites concrètes, voire les effets contre-productifs, qu’une telle orientation pourrait entraîner pour le Canada. Des obstacles importants à l’accès de l’industrie canadienne à l’écosystème européen de la défense existent : protectionnisme persistant, inadéquation des équipements européens aux besoins spécifiques canadiens, et saturation des capacités industrielles européennes en raison de l’effort de guerre en Ukraine. Sans pour autant écarter l’option européenne du revers de la main, il est essentiel d’adopter une approche réaliste et sélective dans le choix de nos partenariats militaires et technologiques en Europe.
La capacité de dissuasion du Canada
À plus long terme, et puisque le Canada se retrouve isolé, il devient indispensable d’ouvrir un débat lucide et responsable sur notre capacité réelle de dissuasion. Aujourd’hui, notre seul et unique levier face à l’administration Trump réside dans l’imposition de tarifs douaniers sur certains produits américains, un outil bien mince face à une économie dix fois plus puissante que la nôtre, et totalement inefficace face à des ambitions territoriales clairement affichées. Si Trump ou l’un de ses successeurs devait adopter une posture plus agressive, le Canada serait dépourvu de moyens de défense crédibles.
Il nous incombe donc collectivement de réévaluer, sans tabous, les instruments de notre souveraineté et d’explorer de nouveaux leviers de dissuasion. Au-delà des mesures tarifaires s’ouvrent un éventail de possibilités qui mérite d’être examiné avec rigueur, même si cela suppose de remettre en question certaines valeurs que nous avons portées depuis des décennies.
Parmi ces options figurent le développement de capacités crédibles de dissuasion cybernétique, le renforcement de nos forces armées conventionnelles, et, de manière controversée mais nécessaire, l’examen de la pertinence et de la faisabilité de moyens nucléaires tactiques.
Dans le monde qui s’ouvre, la survie même du Canada pourrait bien dépendre de sa capacité à dissuader les puissances prédatrices, c’est-à-dire à les convaincre que le coût stratégique de leurs ambitions surpasserait les gains escomptés.
Chose certaine, en rompant avec les conventions diplomatiques, en affichant un mépris flagrant pour le droit international et en ayant des visées expansionnistes, Trump est un acteur central de l’érosion des fondements de la stabilité mondiale sur lesquels reposait le monde qui se referme. Cette transformation de la diplomatie américaine, privilégiant la coercition au détriment de la coopération, engendre une instabilité accrue et ouvre la voie à un monde où seuls les rapports de force dicteront la marche à suivre. Face à cette reconfiguration de l’environnement stratégique, le Canada ne peut rester passif : il lui faut impérativement tirer les leçons stratégiques qui s’imposent.
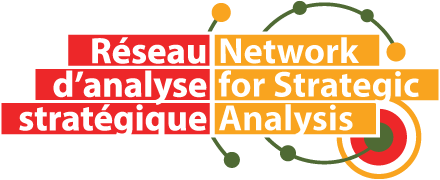




Les commentaires sont fermés.