Policy Forum Politique est un format de publication qui vise à stimuler le débat en présentant un large éventail d’opinions d’experts sur un sujet important pour la sécurité nationale du Canada. Pour cette troisième édition, nous avons demandé à quatre experts leur point de vue sur la nouvelle stratégie canadienne pour l’Afrique.
 Nadège Compaoré | Université de Toronto
Nadège Compaoré | Université de Toronto
Le Canada est le plus grand investisseur étranger dans le secteur minier africain, avec plus de 37 milliards de dollars d’actifs miniers sur le continent. La stratégie du Canada sur l’Afrique devrait repenser les termes actuels des partenariats avec les pays africains riches en minerais, notamment dans des régions telles que le Sahel, et aller au-delà des considérations économiques en abordant les questions de paix et de sécurité. Compte tenu de l’importance croissante des réserves minérales essentielles de l’Afrique pour les énergies renouvelables, des pays comme la République démocratique du Congo et ses énormes réserves de cobalt méritent une attention diplomatique bilatérale plus approfondie, qui devrait donner la priorité au bien-être des communautés locales.
Toute réflexion sur le partenariat minier avec l’Afrique devrait également impliquer une surveillance accrue des sociétés minières canadiennes opérant en Afrique. Jusqu’à présent, cette question a été laissée à l’appréciation des entreprises elles-mêmes, compte tenu de leur adhésion volontaire aux cadres de responsabilité sociale des entreprises (RSE) lorsqu’il s’agit de s’engager dans les secteurs extractifs à travers le continent. Au-delà de la génération de revenus économiques, l’élaboration d’une vision et d’une stratégie cohérentes pour le partenariat avec les pays africains en matière de gouvernance minière devrait être guidée de manière plus systématique par des considérations environnementales et relatives aux droits humains. La mise en place de cette vision stratégique nécessiterait une collaboration et une réglementation accrues avec les entreprises canadiennes présentes en Afrique, ainsi qu’un alignement étroit sur les normes régionales existantes, telles que la Vision minière africaine de l’Union africaine.
La stratégie africaine du Canada ne précise pas actuellement les mécanismes possibles pour un partenariat minier. Elle met certes l’accent sur les minéraux critiques comme domaine prioritaire dont le gouvernement cherche à faciliter l’accès pour « le secteur privé et les parties prenantes », notamment par le biais d’une « mission commerciale de haut niveau » en Afrique. Et en effet, le secteur minier est fondamentalement pertinent pour les cinq domaines stratégiques élaborés dans la stratégie globale, y compris la sécurité nationale. Cependant, prendre au sérieux un partenariat minier entre le Canada et l’Afrique signifie également prendre au sérieux le concept de « responsabilité de l’État d’origine » en ce qui concerne la présence minière du Canada en Afrique. Le Canada doit donc élaborer une approche durable et fondée sur les droits en matière d’investissement. Compte tenu de ses expériences passées avec les stratégies de RSE menées par le gouvernement et conçues pour promouvoir le bien-être et la protection des communautés d’accueil où opèrent les entreprises canadiennes, le gouvernement canadien sait qu’il joue un rôle crucial dans l’élaboration d’investissements éthiques à l’étranger. La stratégie africaine du Canada est l’occasion de s’approprier ce rôle. Un mécanisme de responsabilité de l’État d’origine ne devrait pas se limiter au niveau bilatéral et serait plus efficace s’il était mis en place aux niveaux régional et mondial.
Nadège Compaoré est professeure adjointe en relations internationales à l’Université de Toronto. Ses recherches actuelles portent sur les revendications de souveraineté des États et des communautés touchés par l’extraction des ressources naturelles en Afrique.
 Marie-Eve Desrosiers | Université d’Ottawa
Marie-Eve Desrosiers | Université d’Ottawa
La nouvelle stratégie canadienne pour l’Afrique arrive à point nommé dans un contexte où la compétition internationale entre différents pays pour accroitre leur influence sur ce continent est plus palpable que jamais. Or, ce que propose cette stratégie, en particulier dans le domaine de la gouvernance, de l’appui aux processus démocratiques et de la défense des droits de la personne, demeure timide, voire dépassé.
Le continent africain n’est pas en marge de la grande récession démocratique que connaît le monde depuis deux décennies. S’il abrite certains des cas les plus probants de retour à la démocratie, comme les Seychelles, il se trouve aussi au cœur d’une vague de coups d’État qui frappe tout particulièrement le Sahel. Ailleurs sur le continent, l’enracinement autoritaire se poursuit, de manière moins spectaculaire qu’une prise de pouvoir par la force, mais tout aussi préoccupante. Le nombre de tentatives de modifications de la constitution pour permettre à un président de rester au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles permises a en effet cru de manière significative en Afrique depuis quinze ans. Enfin, l’Afrique est également un contexte où de plus en plus de pays autoritaires cherchent à approfondir leurs relations, ce qui change la donne quant à l’influence que des pays comme le Canada peuvent avoir. Les temps, les tendances et les pratiques ont changé. Pourtant, ce que le Canada propose dans sa stratégie ne diffère pas de l’approche proposée par les pays pro-démocratie depuis déjà dix ans.
Appuyer les processus électoraux, contrer la désinformation, promouvoir l’égalité des genres et protéger les droits de la personne – les priorités mises de l’avant sous le vocable « gouvernance » de la nouvelle stratégie – constituent certes des enjeux majeurs. Mais ce sont aussi les mêmes priorités qui dominent depuis bien avant l’enracinement de la récession démocratique actuelle. Ces priorités ont également éclipsé d’autres dimensions essentielles de la résilience démocratique, telles que le renforcement de la justice, des parlements et des institutions d’audit public, désormais sous-financées. Or, les principales forces de résistance aux dérives autoritaires observées en Afrique ces dernières années ont reposé sur l’esprit de l’État de droit, l’indépendance des cours de justice et la mobilisation citoyenne au sein de coalitions traversant classes et identités. Ce sont également des priorités que le Canada devrait centrer au cœur de sa stratégie s’il souhaite que celle-ci soit adaptée aux défis actuels de gouvernance en Afrique.
Marie-Eve Desrosiers est titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et les mouvements politiques en Afrique francophone. Elle est professeure à l’École d’Affaires Publiques et Internationales.
 Nicolas Klingelschmitt | UQAM
Nicolas Klingelschmitt | UQAM
L’annonce du lancement de la nouvelle stratégie du Canada pour l’Afrique en mars 2025 fait suite à près de deux années de consultations de partenaires et d’expert-e-s. Pourtant, si elle est présentée comme « nouvelle », elle ne semble pas à première vue introduire des innovations majeures dans la politique étrangère d’Ottawa sur le continent. Sans être révolutionnaire, pour avancer ses objectifs diplomatiques, économiques ou encore d’appui à la paix et la sécurité, elle doit surtout s’accompagner de moyens, inscrire ses programmes et objectifs dans une vision plus ciblée et distincte des 54 États du continent, et mettre l’accent sur le renforcement des liens et la visibilité des opportunités de part et d’autre.
Commençons par l’évidence : pour avoir une bonne stratégie, le Canada doit d’abord la financer. En comparaison, la stratégie Indopacifique fut accompagnée lors de son lancement en 2022 d’une enveloppe budgétaire de plus de deux milliards de $CAD. Cependant, aucun décaissement spécifique supplémentaire n’a pour l’instant concrétisé l’annonce de la nouvelle stratégie africaine du Canada.
Ensuite, Pour avoir une bonne politique étrangère vis-à-vis de ses partenaires africains, le Canada doit en réalité en avoir plusieurs, en considérant l’Afrique dans la diversité de ses régions, de ses contextes et de ses acteurs. L’essentialisation du continent en une seule grande stratégie est une erreur qui entraine des risques de préjugés et mauvais calculs stratégiques.
Enfin, et ce point est essentiel pour mettre en œuvre le précédent, Ottawa doit renforcer son maillage diplomatique à travers le continent. Le Canada compte quinze ambassades et neuf hauts-commissariats et a depuis deux ans un représentant permanent auprès de l’Union Africaine (UA), sans néanmoins avoir des émissaires équivalents entièrement dédiés à l’une des huit Communautés Économiques Régionales officiellement reconnues par l’UA, ou encore auprès des unions monétaires d’Afrique de l’Ouest ou Centrale.
Ces relais stratégiques bilatéraux et multilatéraux doivent pourtant être plus nombreux pour renforcer les partenariats publics et privés locaux et envoyer un signal positif aux investisseurs canadiens potentiels en montrant l’engagement canadien non seulement en parole, mais également sur le plan financier, matériel et humain.
Nicolas Klingelschmitt est candidat au doctorat en science politique à l’Université du Québec à Montréal et titulaire d’une licence en droit et en science politique ainsi que d’un master en relations internationales – gestion de programmes internationaux de l’Université Lyon 3 (France).
 Falk Petegou | Université d’Ottawa
Falk Petegou | Université d’Ottawa
La nouvelle stratégie du Canada pour l’Afrique devrait s’implémenter à partir d’une approche différenciée—c’est-à-dire, qui tienne compte des différences, des particularités, des besoins, des contextes. Ceci implique la mise sur pied par le Canada d’un indice de mesure des critères de priorité. Cet indice canadien de coopération en Afrique pourraient être mis à jour annuellement pour évaluer chaque partenaire et composé d’indicateurs qualitatifs dont, la stabilité politique, le potentiel économique, la diplomatie, l’engagement pour le climat, l’inclusion sociale, la sécurité humaine. Chaque pays partenaire africain pourrait être classé sur un score global de 140 à raison de 20 points pour chaque indicateur selon les priorités du canada. Les scores permettent de déterminer le niveau de comptabilité avec les objectifs du Canada. Les résultats permettront de déterminer le type d’intervention. Par exemple, le Sénégal et l’Afrique du Sud ont un fort potentiel économique et une stabilité politique, ce qui permet le lancement d’un fonds d’investissement pour les startups locales en partenariat avec des entreprises canadiennes.
Il faut considérer la priorité comme le consensus sur le respect des normes édictées dans le cadre de la mise en œuvre des actions d’intervention. Elle pourrait se mesurer dans les secteurs clés de l’intervention à partir de l’analyse des discours en lien à la sécurité partagée et commune. Les discours sont des déclarations repérées dans les actes administratifs, les communiqués, les positions publiques et officielles, les témoignages et les mémoires et autres publications à caractères scientifiques. Ils reposent sur les critères suivants : la productivité (par exemple, la déclaration du Canada sur la paix et la sécurité au Sahel avec le lancement de programmes de formation des acteurs locaux en matière de protection des civils et des droits humains), l’itérabilité (par exemple, la répétition des principes de prévention des conflits, d’égalité de genres et d’inclusion au sein du sommet Canada-Afrique, l’Union africaine), la reconnaissance sociale (par exemple, l’appui canadien à la participation des femmes dans les processus de paix repris par les partenaires en République Démocratique du Congo).
Il faudrait enfin élaborer un calendrier d’intervention en fonction des priorités déterminées.
Falk Petegou est professeur invité à l’École d’Affaires Publiques et Internationales de l’Université d’Ottawa et détenteur d’un Ph.D. en Études Internationales. Il a été chercheur invité à l’Institut pour la Recherche de la Paix de Francfort (PRIF).
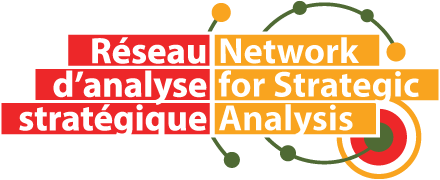
 Nadège Compaoré | Université de Toronto
Nadège Compaoré | Université de Toronto Marie-Eve Desrosiers | Université d’Ottawa
Marie-Eve Desrosiers | Université d’Ottawa Nicolas Klingelschmitt | UQAM
Nicolas Klingelschmitt | UQAM Falk Petegou | Université d’Ottawa
Falk Petegou | Université d’Ottawa






Les commentaires sont fermés.