Policy Forum Politique est un format de publication qui vise à stimuler le débat en présentant un large éventail d’opinions d’experts sur un sujet important pour la sécurité nationale du Canada. Pour cette deuxième édition, nous avons demandé à quatre experts leur point de vue sur la crise du recrutement et de la rétention toujours en cours dans la Forces armées canadiennes au moment où le gouvernement tente d’augmenter ses dépenses militaires.
 Charlotte Duval-Lantoine, Université Deakin
Charlotte Duval-Lantoine, Université Deakin
Contrairement à ce que semble laisser entendre le discours public, la crise du recrutement et de la rétention au sein des Forces armées canadiennes n’est pas simple. Par exemple, l’augmentation de la rémunération est une mesure bienvenue, mais elle ne résoudra pas le problème à long terme. Tout doit être réformé, du processus de génération du personnel aux logements militaires, car bon nombre des politiques régissant la gestion du personnel ne sont pas adaptées pour attirer et retenir les militaires.
Nous ne pouvons pas seulement blâmer l’armée pour son retard dans la mise en œuvre du plan « Fort, sûr, engagé » (2017), car beaucoup de cartes sont entre les mains du Cabinet. Pour réussir à retenir le personnel, il faudra modifier les politiques relatives au logement militaire (au sein du Conseil du Trésor), éliminer les obstacles administratifs entre les provinces (ce qui profiterait à tous les Canadiens) et utiliser les 600 millions de dollars restants consacrés aux questions de personnel dans le cadre des 2 % du PIB consacrés aux dépenses de défense pour renforcer les capacités de formation – un aspect sous-estimé de l’intégration de nouvelles plateformes telles que les destroyers de classe River ou les prochains avions de combat (quel que soit le fournisseur).
Concentrer le capital politique et les fonds sur ces questions de défense « non sensibles » exige des dirigeants civils et militaires qu’ils prennent certains risques, ce qui nécessite à son tour un changement de mentalité. Il faudra s’éloigner de la mentalité très erronée du ratio « dents-queue », qui a conduit à considérer les dépenses liées au personnel comme peu sérieuses. En réalité, pour réussir à recruter et à fidéliser des aviateurs, des marins et des soldats, il faut du personnel pour traiter, former, rémunérer, nourrir et gérer les militaires, de leur enrôlement à leur libération. Cela nécessite des investissements dans la « queue », c’est-à-dire dans le personnel et les processus qui ne sont pas directement impliqués dans la réalisation des effets opérationnels.
Charlotte Duval-Lantoine est vice-présidente des opérations à Ottawa du Canadian Global Affairs Institute, directrice générale et conseillère en matière d’égalité des sexes chez Triple Helix et doctorante à l’université Deakin.
 Stéfanie von Hlatky, Université Queen’s
Stéfanie von Hlatky, Université Queen’s
Cette année, les FAC ont dépassé leur objectif de recrutement après avoir longtemps lutté pour surmonter une crise « existentielle » en matière de personnel militaire. Bien que cette nouvelle représente un renversement de tendance encourageant pour le chef du personnel militaire (CPM), elle ne comblera pas immédiatement le déficit massif en personnel qui s’est accumulé au fil des ans. Alors que le Canada augmente ses dépenses de défense, il doit donner la priorité aux investissements dans le personnel militaire de manière cohérente, afin d’éviter de reproduire l’incertitude qui a caractérisé ces dernières années, où des coupes massives ont été suivies d’augmentations budgétaires encore plus importantes. Les FAC ont mis en place des réformes globales liées au personnel militaire. Ces réformes nécessitent du temps et de l’argent. Les changements fréquents à la tête de l’organisation et les fluctuations budgétaires nuisent à ces progrès.
De nombreux facteurs ont contribué au manque de personnel des FAC, et l’organisation a réagi en conséquence. Certains facteurs échappent au contrôle de l’armée, comme la pandémie et l’économie. Pour remédier au retard pris en matière de recrutement et de formation pendant la pandémie, le CMP a conçu des règles d’admission plus souples, en prenant plus de risques dès le départ pour recruter des candidats et en instaurant une période d’essai afin de procéder à des coupes plus tard dans le processus. Pour remédier au goulot d’étranglement de la formation, qui freinait le rythme du recrutement et décourageait les recrues en attente de qualifications, les FAC ont investi massivement dans ce domaine, en offrant des incitations salariales aux instructeurs. En numérisant le système de recrutement, les FAC se sont efforcées d’améliorer les processus et les procédures qui ont le plus d’impact sur les nouvelles recrues. Confrontés à un système lent et confus, de nombreux candidats ont abandonné toute perspective de rejoindre les forces armées, renonçant à un système qui leur était hostile dès le départ.
Il est certain que les CAF n’ont pas de problème d’attractivité. En 2023-2024, plus de 70 000 candidatures ont été reçues, mais moins de 5 000 recrues ont été enrôlées. Le problème des FAC réside dans leur capacité à répondre aux attentes : elles doivent traiter rapidement les dossiers, cultiver une culture professionnelle du plus haut niveau tout en offrant une formation et des expériences opérationnelles qui répondent aux aspirations de leurs membres. Les FAC sont sur la bonne voie en poursuivant des réformes sur plusieurs fronts pour y parvenir, mais cet élan pourrait rapidement s’essouffler, revenant à ce que l’ancien ministre de la Défense Blair a récemment qualifié de « spirale mortelle ».
Stéfanie von Hlatky est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le genre, la sécurité et les forces armées, boursière de la Fondation Pierre Elliot Trudeau et professeure titulaire au département d’études politiques de l’Université Queen’s.
 Philippe Lagassé, Université Carleton
Philippe Lagassé, Université Carleton
Il n’y a pas un seul facteur qui influence le recrutement et la rétention dans les Forces armées canadiennes. Un domaine qui peut contribuer à améliorer le recrutement et la rétention est un investissement important dans les infrastructures de défense. En termes simples, le personnel militaire et leurs familles méritent de vivre et de travailler dans des bâtiments, des installations et des conditions sûrs. La réparation, le remplacement et la modernisation des infrastructures de défense du Canada contribueraient grandement à garantir cette sécurité et à rendre la carrière dans les FAC plus attrayante.
Le ministère de la Défense nationale gère un nombre considérable de bâtiments. Selon le Répertoire des biens immobiliers fédéraux, la Défense nationale gère 14 042 bâtiments, d’une superficie totale de 7 991 175 pieds carrés. Malgré cette empreinte massive, les infrastructures de défense ont été chroniquement négligées et sous-financées. Cela reflète en partie le fait que le Canada n’a pas consacré suffisamment de fonds à la défense nationale pendant plusieurs décennies. Cela reflète également les transferts de responsabilité passés entre les commandements environnementaux et le ministère de la Défense en matière d’infrastructures. Les infrastructures ont trop longtemps manqué d’un défenseur dédié, jusqu’à la création du poste de sous-ministre adjoint chargé des infrastructures et de l’environnement.
En raison du sous-investissement dans les infrastructures de défense pendant des décennies, de nombreux bâtiments dans lesquels les membres des FAC travaillent et vivent sont en mauvais état ou ne sont plus adaptés à leur usage. Dans d’autres cas, ces bâtiments peuvent contenir des substances dangereuses, telles que l’amiante. Bien que cela ne soit pas nécessairement un facteur déterminant dans la décision d’une personne de s’engager ou de rester dans l’armée, les conditions de travail et de vie physiques ont leur importance. En effet, nous avons tendance à reconnaître que des capacités de pointe peuvent jouer un rôle dans le recrutement et la fidélisation ; il est plus facile de convaincre les gens de s’engager dans l’armée lorsque les forces armées ne sont pas encombrées d’équipements plus anciens que de nombreux officiers supérieurs. Une logique similaire devrait s’appliquer aux infrastructures de défense.
Philippe Lagassé est professeur agrégé et titulaire de la chaire Barton à la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton.
 Richard Shimooka, Institut Macdonald-Laurier
Richard Shimooka, Institut Macdonald-Laurier
Les armées modernes, à l’image des sociétés dont elles sont issues, s’appuient sur un éventail de compétences de plus en plus diversifié pour mener à bien leurs diverses missions. À quelques exceptions près, comme la cyberguerre ou la médecine, les FAC ne peuvent recruter ces personnes au sein du grand public, car ces compétences sont uniques et nécessitent une formation spécialisée. L’armée doit donc les former de manière organique au sein de son propre effectif et les conserver pendant au moins une décennie afin d’optimiser l’investissement. Malheureusement, c’est là que surgira le prochain goulot d’étranglement de la politique du personnel, ce qui compliquera la capacité des FAC à reconstituer leurs effectifs et à créer les nouvelles unités et fonctions nécessaires à la mise en œuvre de la politique de défense.
La dure réalité est que le système actuel est surchargé : un mélange toxique de personnel insuffisant remplissant trop de fonctions opérationnelles. Il en résulte un manque de personnel qualifié excédentaire disponible pour former la prochaine génération de professionnels. Ce manque de capacité limitera la croissance, ce qui pourrait entraîner un processus de réhabilitation qui prendra plusieurs décennies pour de nombreux métiers clés. L’alternative consiste à réduire temporairement les engagements militaires du Canada, car une réduction opérationnelle permettrait aux FAC de former rapidement de nombreux militaires qualifiés et de les faire passer à de nouveaux équipements si nécessaire.
Cette solution pourrait être difficile à accepter pour les alliés internationaux du Canada, mais beaucoup l’accepteront si elle s’accompagne de la promesse crédible que des FAC beaucoup plus performantes se développeront à moyen terme. Avec un recrutement soutenu et une gestion politique habile du dossier de la défense, c’est réalisable. La seule question est de savoir si Ottawa est suffisamment perspicace pour comprendre la situation dans laquelle il se trouve et pour mettre en œuvre des politiques créatives qui revitaliseront les FAC en temps opportun.
Richard Shimooka est chercheur à l’Institut Macdonald-Laurier. Ses travaux portent sur des sujets variés qui incluent les politiques étrangères et de défense du Canada et des États-Unis.
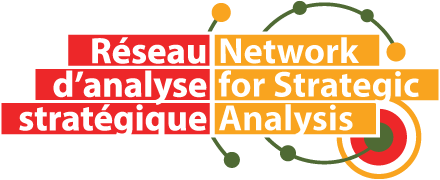
 Charlotte Duval-Lantoine, Université Deakin
Charlotte Duval-Lantoine, Université Deakin  Stéfanie von Hlatky, Université Queen’s
Stéfanie von Hlatky, Université Queen’s  Philippe Lagassé, Université Carleton
Philippe Lagassé, Université Carleton Richard Shimooka, Institut Macdonald-Laurier
Richard Shimooka, Institut Macdonald-Laurier





Les commentaires sont fermés.