Pourquoi un tel projet ?
L’arrivée en 2025 de Donald Trump à la Maison-Blanche a créé un véritable électrochoc pour la communauté européenne. La fiabilité de leur plus grand allié est remise en cause, ce qui les pousse ainsi à revoir leur relation avec la puissance étatsunienne. En réaction à la rencontre tendue entre Zelensky et le président américain ainsi que son vice-président Vance, et à la décision des États-Unis de suspendre temporairement leur aide à l’Ukraine, les pays européens ont rapidement compris la nécessité de « prendre le relais » en matière d’aide à l’Ukraine et de sécurité européenne. Au début du mois de mars, la France et le Royaume-Uni s’accordent sur la mise en place d’une « coalition des volontaires » composée d’eux-mêmes, mais d’autres pays étant prêts à assurer un soutien majeur envers l’Ukraine dans la guerre et dans sa protection ainsi que dans la sureté du continent européen. En parallèle, le chancelier allemand Friedrich Merz a pointé du doigt la problématique du désintérêt américain vis-à-vis de l’OTAN et de l’Europe et a appelé les pays européens détenteur d’arme atomique a songé à une alternative souveraine et européenne. De ce fait, la France et le Royaume-Uni, les seuls détenteurs de l’arme nucléaire en Europe, réfléchissent à la mise en place d’une stratégie de dissuasion commune qui pourrait venir prendre le relais des Américains afin de rassurer l’Europe du manque d’engagement américain et de leur potentiel retrait.
L’enjeu est de taille puisque l’objectif est de garantir le soutien militaire et économique et de fournir une force capable de dissuader la Russie, mais aussi de défendre les partenaires européens en se plaçant comme une alternative de confiance face au parapluie américain. Le but principal de ce projet est de venir coordonner les arsenaux britannique et français afin qu’ils soient capables d’être une force de dissuasion crédible pour les alliés européens, indépendante de la protection nucléaire américaine. Ainsi, cela passe par un élargissement de la zone de protection nucléaire de la France, qui, pour l’instant, était concentré sur son territoire national et ses frontières à une zone largement plus vaste que représente l’Union européenne. Un des enjeux prépondérants de cette initiative est aussi de savoir si cette force dissuasion est capable de fonctionner sans la contribution américaine et si les capacités sont « suffisante » pour défendre l’Europe tout entière. La question majeure qui se pose est de savoir si cette collaboration franco-britannique a réellement la capacité de dissuader la Russie d’une future invasion. De plus, peut-elle aussi assurer une force de dissuasion nucléaire à l’Europe dans un contexte où les États-Unis se désintéressent du continent ? Quelle forme ce parapluie nucléaire pourrait-il prendre ?
Ce texte examine la question de la dissuasion et ses diverses formes ainsi que l’enjeu de la crédibilité. Il passe aussi en revue la question fondamentale des capacités et moyens dans la dissuasion pour faire un état de la situation européenne concernant la dissuasion élargie. Alors que le projet franco-britannique fait preuve d’une grande crédibilité sur son aspect nucléaire cependant, il est nécessaire pour l’Europe de se doter d’une force conventionnelle qui permet une réaction graduelle à un moment où les États-Unis semblent les plus désintéressés de la défense européenne.
La dissuasion nucléaire : une affaire de crédibilité
Dissuader repose principalement sur la question de la crédibilité. La crédibilité de la riposte qui, par la réaction de la personne attaquée, rendra irrationnelle une potentielle agression. Mais aussi la crédibilité politique de la dissuasion qui repose sur la capacité à rendre crédible la puissance de son armement. Jusqu’à la fin de la guerre froide, les différents paradigmes de la dissuasion occidentaux ou soviétiques ont reposé « uniquement » sur la manipulation de l’armement nucléaire. Les modèles d’emplois pouvaient être construits sur une logique d’usage en premier ou non, mais aussi sur une approche graduée ou de destruction assurée. Cependant, ils excluaient de leurs schémas d’escalades la contribution de moyens conventionnels. Avec les progrès réalisés dans les armes de précision dont le succès a été établi lors de la première guerre du Golfe (Desert storm), cette vision classique de la dissuasion nucléaire s’est révélée de plus en plus inopérante. Depuis les années 2000, il s’agit donc de réfléchir à une dissuasion intégrée qui rassemble ou « épaule » les moyens nucléaires stratégiques aux autres. De facto, l’impératif de disposer à nouveau de force conventionnelle pour la haute intensité a donc été réévalué pour éviter tout coup de force ou état de fait qui contournerait le seuil de la dissuasion nucléaire. De la même manière, la résilience des sociétés civiles est impactée avec les risques de désinformation et de guerre hybride. Si le cœur de la logique de la dissuasion – crédibilité d’une riposte – demeure la même, elle est donc plus élargie qu’auparavant. Pour convaincre un adversaire que son agression entrainerait des frais supérieurs à son attaque immédiate, il faut donc non seulement démontrer la fiabilité des moyens nucléaires, mais également signaler la bonne préparation de ses forces armées et de la société civile.
Dans sa dimension nucléaire, la dissuasion repose théoriquement, dans sa forme absolue, sur une triade composée de la terre, de la mer et de l’air. Dans chaque composante, il y a un moyen de déployer sa force nucléaire : sur terre avec les missiles intercontinentaux, dans les mers grâce aux sous-marins et dans les airs par bombardements avec des charges embarqués sur des avions. Bien que la maîtrise des trois soit importante, l’utilisation de seulement un ou deux des trois aspects reste suffisante pour être crédible. Dans ces cas-ci, nous pouvons penser au Royaume-Uni, dont la dissuasion repose principalement sur le penchant naval ou la France qui possède le doublé air et mer. De plus, l’armement nucléaire peut se décliner en plusieurs types. On parle de nucléaire tactique, mais aussi stratégique dont l’objectif diffère. La notion de tactique se rapporte donc à une utilisation ciblée avec des têtes nucléaires de plus petit format permettant une utilisation précise sur le champ de bataille, alors que le stratégique se voit avoir pour but de venir frapper et détruire les centres névralgiques du pays, que ce soit démographique, économique ou politique. Bien qu’il existe une différence que ce soit sur la charge, les dégâts ou le type d’utilisation, la différence entre tactique et stratégie se fait surtout dans le cadre des doctrines étatiques de dissuasion. De plus, il est essentiel de noter que le déploiement de la capacité de dissuasion nucléaire ne se fait pas seul. La menace d’une frappe ou la potentielle frappe doit être couverte par des moyens conventionnels permettant de mener à bien l’opération ou de démontrer une capacité de résilience.
La crédibilité : le nerf de la guerre
Le 10 juillet, le président français et le Premier ministre britannique ont annoncé avoir signé une déclaration sur la coordination des arsenaux nucléaires de leurs deux pays respectifs. Au-delà de ce geste symbolique important, la question de la crédibilité des postures de dissuasion des deux pays, mais aussi de leurs moyens et capacités, est importante à clarifier pour assurer la cohérence du projet de dissuasion européen. Ainsi, il faut venir étudier directement les postures des deux principaux intéressés.
Du côté de la France, la dissuasion nucléaire repose sur une logique de “tous azimuts” ne mettant ainsi pas l’emphase sur un seul ennemi, mais sur la défense de ses tous intérêts vitaux vis-à-vis de n’importe quel adversaire. Par conséquent, la dissuasion nucléaire française est conçue pour être constante et exclusivement défensive. Cependant, elle est utilisée selon une stratégie visant à infliger des dommages inacceptables aux capitales, centres de commandements importants, infrastructures économique et énergétique, etc. De plus, la dissuasion française se veut indépendante et autonome, mettant en avant le fait qu’elle ne relève que du pouvoir du président de la République et ne peut donc être utilisée par d’autres pays ou entités alliés de la France. La conception française de la dissuasion nucléaire a pour cœur les intérêts vitaux du pays, ce qui vient poser un doute sur un élargissement de la doctrine française dans sa construction actuelle. Bien que la question d’une dissuasion européenne nucléaire ne soit pas récente en France, il est compliqué de mesurer ce qui relève de l’intérêt vital en dehors du territoire national. Depuis l’accord d’Aix-la-Chapelle en 2019, la France s’est engagée à protéger l’Allemagne en garantissant une défense conjointe des deux nations grâce à leurs forces militaires, sans toutefois évoquer explicitement l’arme nucléaire. En dehors de cela, le doute réside sur la volonté politique française et la possibilité de réellement défendre les pays menacés directement par la Russie alors que ceux-ci appellent à une protection nucléaire qu’ils perçoivent comme le seul moyen possible pour dissuader leur ennemi commun. Il faudrait ainsi que la France révise l’intégralité de sa doctrine nucléaire afin de proposer un modèle marquant une rupture avec sa conception passée de la dissuasion nucléaire.
Du côté du Royaume-Uni, la posture de dissuasion prévoit l’utilisation de missiles Trident à une échelle substratégique. La logique serait l’emploi de l’arme nucléaire de manière limitée afin de ne pas déclencher un échange de plus grande ampleur. Ainsi, on peut situer cette posture entre le tactique et le stratégique, d’où l’origine de son nom. Toutefois, la doctrine britannique de dissuasion nucléaire cherche à créer un flou sur les circonstances dans lesquelles le pays considère son droit de répondre nucléairement, ce qui lui permet de se garder une certaine marge de manœuvre vis-à-vis d’un potentiel agresseur. Cependant certains principes sont énoncés. Le Royaume-Uni n’engage à ne pas lancer une frappe nucléaire en premier et à répondre de manière minimale, mais crédible. L’arme nucléaire est donc purement pour dissuader l’adversaire potentiel et n’est pas considérée comme une arme utilisable sur un champ de bataille. Enfin, le Royaume-Uni possède une force nucléaire à la fois aérienne et maritime, bien que sa dimension maritime demeure la plus efficace par l’utilisation de ses sous-marins de classe Vanguard, qui seront remplacés à partir de 2028 par la classe Dreadnought. Toutefois, l’arsenal britannique est vieillissant et doit passer par une phase de remise à niveau, que ce soit par l’acquisition des moyens aéroportés ou par la modernisation de ses armes. Bien que les arsenaux des deux pays réunis (290 pour la France contre 225 pour le Royaume-Uni) n’atteignent pas les chiffres des armes nucléaires russes (5580 têtes), la capacité de l’arme nucléaire à dissuader d’elle-même, lorsque combinés aux postures des pays et à leur stratégie, en fait un moyen tout de même efficace de dissuader un adversaire. Toutefois, la question demeure concernant la volonté politique de se porter comme garant de la sécurité d’un nombre d’États au final relativement éloignés de leurs frontières.
La perception des Russes de ces projets européens est aussi un élément à prendre en compte. Comment réagissent-ils à ces décisions ? La question d’une menace posée par une dissuasion nucléaire européenne n’est tout bonnement pas prise au sérieux dans les think tanks ou médias russes. Ce qui ressort principalement est une tentative de discréditer les efforts européens en présentant la marine britannique comme étant dépassée, incapable de se battre contre les Russes, et composée d’individus immoraux. Du côté français, l’idée est la même : Macron ne cherche qu’un prétexte pour entrer dans la guerre et l’Europe joue avec le feu en étant un acteur géopolitique qui n’est plus sérieux. Ainsi, l’idée est que l’Europe n’est pas à la hauteur et est un acteur en faillite qui peine à retrouver sa place. Toutefois, l’arme nucléaire parle toujours pour elle-même et le fait que la France et le Royaume-Uni deviennent des menaces pour la Russie est bien considéré. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Ryabkov, a annoncé que la Russie prendrait en compte les efforts franco-britanniques dans leur prochaine planification militaire. Il est intéressant de noter que la Russie cherche à mettre en évidence une attitude antirusse en France et en Europe. Elle souhaite ainsi discréditer les décisions prises par l’Europe qui chercherait à attiser les tensions pour faciliter l’acceptation de son propre réarmement par sa population. Le sujet du projet européen de dissuasion n’est cependant pas quelque chose de grandement discuté dans les conférences de presse du ministère des Affaires étrangères. Toutefois, lors d’une conférence de presse le 6 mars 2025, sa porte-parole, Maria Zakharova, mentionna le projet français de créer un nouveau parapluie en l’affirmant impossible en raison de la capacité moindre de la France par rapport au parapluie américain. Néanmoins, elle mentionna aussi que ce changement de doctrine serait pris en compte dans la programmation militaire russe à venir.
Des capacités à la hauteur des ambitions ?
En France, comme cela a été mentionné, l’exécution de la dissuasion nucléaire peut être comprise en deux éléments : les missiles aéroportés, ceux installés sur des sous-marins. La composante sous-marine est certainement la plus fiable et la plus efficace, puisque les sous-marins lanceur d’engins (SNLE) sont indétectables et intraçables. En outre, il y aura toujours, parmi les quatre SNLE, au moins un sous-marin en mer prêt à employer l’arme nucléaire, assurant ainsi la dissuasion française. Sa capacité d’emport de 16 missiles M51 par appareil lui laisse une grande force de frappe considérable et capable de remplir sa mission. Ainsi, la composante marine de la dissuasion française est assurée et est crédible aux yeux de ses adversaires. Cependant, la dimension aéroportée est aussi un élément majeur de la doctrine française. Dans ce cas-ci, l’arme nucléaire est embarquée sur des Rafales, stationnés sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, et déployée grâce aux missiles ASMPA. Néanmoins, la force nucléaire aéroportée française se trouve en France dans la logique de défendre les intérêts vitaux du pays. Bien que la mission aéroportée prévoie des ravitailleurs permettant aux Rafales de parcourir de plus grandes distances, ceux-ci sont vulnérables. Par conséquent, il est essentiel que la composante aéroportée soit soutenue par des forces conventionnelles pouvant défendre le vecteur nucléaire. À défaut ou en parallèle, les avions pourraient être stationnés ailleurs, ce qui leur permettrait d’être plus près de l’adversaire à dissuader et de l’atteindre plus rapidement. Enfin, bien que nous ne l’ayons pas mentionné, il est primordial de posséder une capacité accrue de renseignement pour la surveillance et la reconnaissance afin que la stratégie puisse être crédible. Aujourd’hui, la quasi-totalité des pays européens repose sur une coopération étroite avec le renseignement américain diminuant leur « indépendance » stratégique. Pour qu’une telle mission soit viable, la France doit s’assurer le soutien de ces alliés afin que ceux-ci garantissent la mission de dissuasion, que ce soit par un partage de renseignement (composante vitale de la dissuasion nucléaire), mais aussi pour un soutien conventionnel (épaulement) aux avions porteurs ou bien en permettant le stationnement dans des bases alliés dans une logique similaire à celle du partage nucléaire de l’OTAN. Une étape majeure pour la France sera de s’accorder sur une doctrine commune et, dans cette perspective, la logique de partage nucléaire reste sans doute la plus pertinente, permettant ainsi de mettre les alliés à contribution en gardant la décision au sein de l’État-Major des armées françaises.
De son côté, l’armée britannique assure aussi sa dissuasion par une composante sous-marine et plus récemment aéroportée. Pareillement, la mission sous-marine prévoit qu’il y ait toujours au moins un sous-marin de classe Dreadnought déployé en mission. Cependant, en ce qui concerne l’arsenal nucléaire, celui-ci est équipé sur des missiles Trident D2 construit par l’américain Lockheed Martin et capable d’embarquer jusqu’à 12 têtes nucléaires. Dans sa capacité aérienne, le Royaume-Uni a tout récemment annoncé l’acquisition de 12 F-35 afin de se conformer à la mission de l’OTAN à double capacité. Une problématique a été émise concernant la dissuasion britannique en raison de la présence de matériel américain dans ses capacités de dissuasion nucléaire. Avec les diverses annonces de Trump, la question s’est posée quant à l’autonomie stratégique des pays achetant du matériel américain. Dans le cas britannique, cela viendrait directement mettre à mal les capacités nucléaires du pays en raison de ses missiles et de ses futurs avions qui sont tous des produits américains dont la marge d’autonomie stratégique sur leur emploi reste encore flou. Seulement, l’ordre de tirer un missile nucléaire revient au commandant du sous-marin lanceur d’engin, laissant ainsi dehors toute supposition d’une interférence ou d’une validation américaine. Toutefois, c’est dans la maintenance des missiles que Washington fait sa part du travail, ce qui veut dire que la coopération entre les deux puissances pour leur entretien doit être pérennisée afin que ceux-ci demeurent fonctionnels et utilisables. Ainsi l’armement fonctionnera toujours tant que les Américains entretiennent celui-ci. De ce fait, la dissuasion britannique a moins de marge de manœuvre que le modèle français, mais demeure crédible et efficace. Malgré leur infériorité en termes de capacité nucléaire, les deux modèles sont efficaces et capables de travailler ensemble en raison de leurs stratégies qui cherchent à taper fort là où ça fait mal. Toutefois il est nécessaire d’avoir cet épaulement conventionnel pour mener à bien la dissuasion, épaulement qui pourrait être assuré par leurs alliés européens.
Que faire ?
Pour conclure, le projet franco-britannique d’une dissuasion nucléaire commune et européenne propose une base solide avec des capacités réelles qui se caractérise par la puissance sous-marine et balistique des deux pays et des postures stratégiques cohérentes et crédibles qui, malgré leur infériorité numérique, reste appropriée. Leur crédibilité résonne du côté russe puisque le régime, méfiant, compte prendre en compte de cette nouvelle réalité dans son plan de programmation militaire. Cette initiative a pour but de venir rassurer les alliés européens face à un désintérêt américain qui fait courir le risque d’une insécurité croissante pour l’Europe. De plus, la gestion de la sécurité nucléaire du territoire européen par des pays européens permet une vision plus cohérente de la sécurité qui ne repose pas simplement sur les capacités et la volonté américaine. Toutefois, la dimension conventionnelle, principalement pour l’épaulement des capacités nucléaires dans le cas d’un raid, est encore trop faible et manque de fiabilité malgré des déploiements respectivement en Estonie et Roumanie afin de sécuriser le flanc est. Pour cela, la coalition pourrait être le garant de cette force avec le soutien des pays membres qui contribuerait en partie à cette dimension. Malheureusement, les incertitudes politiques et le manque de volonté pour certains pays viennent freiner l’avancement de ce projet et remettre en cause les mesures prises par les alliés.
Que doit faire l’Europe ? Les États-Unis sont encore aujourd’hui très importants dans la défense européenne et, si l’Europe souhaite être autonome, elle doit pouvoir être capable de se passer de leur allié nord-américain. Toutefois, cette perspective semble irréaliste au vu de l’implantation américaine majeure dans la défense européenne (renseignement, capacités, etc.). De ce fait, il serait plus pertinent de voir une forme de rééquilibrage. Une montée de l’Europe qui « prend son destin en main » pour diminuer la dépendance d’une présence américaine sans pour autant faire une croix dessus.
Pour cela, l’Europe dans son ensemble doit développer sa force conventionnelle comme certains de ses membres le font déjà, à l’image de la Pologne ou plus récemment de l’Allemagne. Mais elle doit aussi faire preuve d’une meilleure cohésion et coordination afin de ne pas montrer de signe de confusion et de manque d’unité qui pourrait décrédibiliser le projet ou le faire paraître comme une coquille vide. Le doute réside aussi dans la volonté de ces pays de l’Ouest européen de vouloir réellement défendre les nations de l’Est sous ce nouveau parapluie nucléaire. Si demain la Russie attaquait un pays balte, que feraient la France et le Royaume-Uni ? Une riposte nucléaire ne serait évidemment pas envisageable à moins que l’attaque elle-même soit atomique, mais une riposte conventionnelle présenterait aussi des enjeux, d’où la nécessité de l’élaboration de cet aspect et de la mise en place d’une doctrine pertinente permettant une réponse graduelle et adéquate. Cependant, les capacités ne sont pas encore là pour le permettre. De plus, les plans de réarmement ne semblent être prévus que pour les années 2030 à 2035, soit une échéance beaucoup trop lointaine, alors que de nombreux acteurs européens prévoient plutôt une menace dès 2030 (on peut citer la France, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne ou plus généralement les pays européens ayant adhéré au programme Rearm Europe. L’Europe doit donc investir davantage et plus rapidement dans sa défense, avec des mesures plus immédiates, comme l’a démontré Emmanuel Macron, qui a revu les budgets français pour qu’ils atteignent 67 milliards d’ici 2027/2030 afin de rendre crédible ce projet.
Ainsi, comment le nucléaire et le conventionnel agiraient suivant cette logique ? L’intégration d’armes nucléaires tactiques aux plans de guerres semblent être irréaliste pour les doctrines européennes (contrairement au modèle russe). De ce fait, le renforcement de la composante conventionnel vient consolider l’épaulement de l’arme nucléaire, mais aussi permettre une réponse graduée et crédible face à une attaque ennemie, permettant ainsi une meilleure flexibilité des forces européennes et transatlantiques. Toutefois, l’augmentation des dépenses conventionnelles n’est pas suffisante ; il est maintenant nécessaire de développer des modèles de dissuasion intégrant pleinement l’échelon conventionnel en parallèle de la dimension nucléaire. Cette dernière passe par une coordination complète entre Européens et, dans une autre mesure, avec les États-Unis et le Canada. Elle passe aussi par la révision des doctrines stratégiques existantes, dont la focalisation est encore trop concentrée sur la frappe nucléaire. Ainsi, le conventionnel doit devenir une forme véritable de dissuasion permettant un certain niveau de gradation dans la réponse. De cette façon, l’Europe pourra assurer sa propre sécurité. Cependant, les doutes électoraux qui planent sur certains pays d’Europe viennent porter une ombre conséquente sur ces plans.
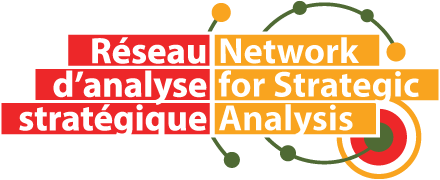




Les commentaires sont fermés.