|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Cette note stratégique fait partie d’une série spéciale, dirigée par Laurent Borzillo (Forum de défense et stratégie, FDS), Teodora Morosanu (FDS) et Benjamin Boutin (Association France-Canada) avec le soutien du programme Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité (MINDS) du ministère de la Défense nationale du Canada et de la DGRIS (Ministère des Armées, France), qui vise à développer des échanges stratégiques franco-canadiens.
Les opinions exprimées ou implicites dans la présente note stratégique sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement les points de vue du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes ou de tout organisme du gouvernement du Canada (en ce qui concerne Erik Vouvalidis) ni de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (en ce qui concerne Gaspard Schnitzler).
Résumé
Le 26 septembre 2024, la France et le Canada ont signé une déclaration commune prévoyant un partenariat renforcé en matière de défense et de sécurité. Si la coopération de défense franco-canadienne poursuit ces dernières années une dynamique positive au niveau politico-militaire, elle demeure pourtant assez peu développée sur le plan industriel. En effet, à l’exception de quelques contrats emblématiques, les acquisitions d’équipement français par les forces armées canadiennes et d’équipement canadien par les armes françaises restent limitées. Cette situation s’explique notamment par les liens militaires étroits qu’entretient le Canada avec les Etats-Unis, qui se traduisent par une priorité donnée à l’acquisition d’équipements américains. Si cette proximité avec l’industrie de défense américaine représente un frein aux coopérations industrielles de défense, il existe pour autant des opportunités de coopération entre industriels de défense français. En effet, l’important processus de modernisation que connaissent actuellement les forces armées canadiennes pourrait donner lieu à des rapprochements dans les prochaines années, notamment dans les domaines suivants :
- La co-construction et l’utilisation de sous-marins de nouvelle génération, en établissant un partenariat stratégique autour du remplacement des sous-marins canadiens de la classe Victoria (dans le cadre du programme CPSP) et la sécurisation des voies maritimes en Arctique et dans l’Atlantique-Nord.
- La co-construction et l’utilisation de navires brise-glaces, en élargissant à la France le partenariat trilatéral autour de la production de navires brise-glaces (ICE Pact), lancé en juillet 2024 par le Canada, les États-Unis et la Finlande.
État de la coopération industrielle de défense entre la France et le Canada
Bien que relativement limitée comparée à d’autres partenaires, la coopération de défense franco-canadienne poursuit une dynamique positive aux niveaux stratégiques et opérationnels. Sur le plan opérationnel, cette dernière se matérialise avant tout par des échanges de personnels, la participation à des exercices interarmées (notamment dans le cadre de l’OTAN), ainsi que des déploiements dans le cadre d’opérations conjointes (i.e par le passé Barkhane et MINUSMA). Au niveau stratégique, la relation bilatérale a été renforcée et institutionnalisée ces dernières années, notamment par l’instauration en 2015 d’un Conseil franco-canadien de coopération en matière de défense, qui réunit régulièrement les ministres de la défense des deux pays, ainsi que la tenue régulière d’un Comité aux affaires stratégiques. En 2023, l’Agence de l’innovation de défense (AID) française et la Direction recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) ont par ailleurs signé un arrangement spécifique dans le domaine de l’innovation de défense. Plus récemment, le 26 septembre 2024, la France et le Canada ont signé une “Déclaration relative à un partenariat renforcé en matière de défense et de sécurité” qui prévoit une coopération renforcée dans les domaines suivants: le soutien à l’Ukraine, l’Indopacifique, la gestion de crises, la modernisation des forces armées, ainsi que la lutte contre les ingérences étrangères et la manipulation de l’information.
Pourtant, si la coopération de défense franco-canadienne semble connaître une dynamique positive au niveau politico-militaire, elle demeure assez peu développée sur le plan industriel.
En effet, à l’exception de quelques contrats emblématiques, tel l’obtention en 2015 par Arquus (ex-RTD) d’un contrat d’environ 500 millions d’euros, pour la fourniture de 1 500 camions militaires aux forces armées canadiennes[1], ou plus récemment, en septembre 2024, l’attribution à Thales d’un contrat de 23 millions d’euros pour la fourniture de 200 caméras thermiques portables multifonctions Sophie Ultima, l’acquisition d’équipement français par les forces armées canadiennes reste limitée. Ainsi, sur les dix dernières années (2013-2023), à l’exception de l’année 2016[2], le volume des exportations d’armement françaises vers le Canada se situaient entre 4 et 24 millions d’euros par an, pour une moyenne à 11 millions d’euros. A titre de comparaison, les exportations d’armement françaises vers les Etats-Unis atteignaient sur la même période une moyenne annuelle de 190 millions d’euros.[3]
Cette situation s’explique notamment par les liens étroits qu’entretient le Canada avec les Etats-Unis, qui se répercutent sur les relations entre industriels de défense canadiens et américains. En effet, voisins et alliés, partageant une frontière commune de près de 9 000 km, les deux pays jouissent d’une relation privilégiée, tant sur le plan économique que militaire, notamment en tant que deux seuls pays non-européens de l’OTAN. Au niveau économique, les deux pays bénéficient depuis les années 1990 d’un accord de libre-échange, qui facilite l’importation de marchandise et l’implantation dans le pays d’entreprises américaines, faisant des Etats-Unis le premier partenaire commercial du Canada. Sur le plan militaire, en plus d’être alliés au sein de l’OTAN, les deux pays coopèrent étroitement au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) – une organisation bilatérale en matière de défense aérienne créée en 1957 – ainsi que dans le cadre des « Five eyes », une alliance entre services de renseignement américains, australiens, britanniques canadiens et néo-zélandais.
Cette proximité, l’importante présence d’entreprises de défense américaines sur le territoire canadien, ainsi que la quête d’interopérabilité entre les deux pays, expliquent en grande partie la priorité donnée par le Canada aux équipements militaires d’origine américaine. Cela s’illustre particulièrement dans le domaine aéronautique, où de nombreuses entreprises américaines telles que Lockheed Martin, Boeing ou Bell Flight, disposent de filiales bien implantées au Canada. Ainsi, à l’exception de l’achat récent (en 2023) d’avions ravitailleurs A330 MRTT d’Airbus, la majorité des aéronefs de l’aviation royale canadienne sont d’origines américaines, qu’il s’agisse des avions de combat F-18 et F-35, des avions de transport C-130 et CC-177, des avions de patrouille maritime P-3, ou encore des hélicoptères de transport CH-147 et multi-rôles CH-146. Il en est de même dans le secteur terrestre, qui, à l’exception des chars Leopard 2 allemands, est essentiellement composé de véhicules d’origine américaine, produits par les filiales canadiennes de General Dynamics Land Systems, Textron ou Oshkosh Defense (i.e. véhicules blindés VBLIII et LAV6, véhicules de transport de troupe M113 et Coyote, véhicules tous terrains HUMVEE…).
Dans le domaine naval, la tendance est légèrement différente, dans la mesure où le Canada dispose d’une importante industrie nationale qu’elle entend préserver et développer. Ainsi, la « Stratégie nationale de construction navale » canadienne limite les possibilités d’exportation pour l’industrie navale française, dans la mesure où les bâtiments de surface doivent en priorité être produits au Canada, à l’instar des 15 navires de combat du programme NCSC dont la construction a été confiée aux Chantiers Maritimes Irving d’Halifax, au grand dam de Naval Group et Fincantieri, qui avaient soumis à Ottawa une offre commune basée sur le design de la frégate FREMM. Malgré tout, les entreprises françaises se sont vu attribuer un certain nombre de contrats dans le domaine naval ces dernières années, la plupart du temps en tant que sous-traitants. Ainsi, en 2021, le missilier MBDA s’est vu attribuer par Lockheed Martin Canada un contrat pour équiper les futurs navires de combat de surface canadien (NCSC) de systèmes de défense anti-aérienne Sea Ceptor. De son côté, Thales Canada s’est vu attribuer en 2023 un contrat d’environ 300 millions d’euros pour le soutien de la flotte de petits navires de guerre et de navires auxiliaires de la Marine royale canadienne, qui comprend une centaine de navires de 24 classes différentes.[4]
Afin de répondre aux critères de passation de marché canadiens et de renforcer leurs chances d’obtenir des contrats au profit des Forces armées canadiennes, de nombreux industriels français ont ouvert des filiales au Canada. C’est notamment le cas de Thales (qui compte environ 2 000 salariés dans le pays), Safran (présent avec environ 2 000 salariés répartis sur 7 sites), Airbus (qui compte environ 4 000 salariés dans le pays), ou encore Naval Group (présent depuis 2014 sous le nom de Naval Group Technologies Canada).
Néanmoins, la préférence américaine susmentionnée, ainsi que les échecs répétés rencontrés par l’industrie tricolore lors de campagnes récentes, contribuent à faire du Canada un marché difficilement accessible (et donc non-prioritaire) pour les industriels de défense français.
Zoom sur le poids économique des industries de défense française et canadienne
Le poids économique de l’industrie de défense tout comme le rapport de l’Etat à cette dernière, varient significativement entre la France et le Canada. Ainsi, l’industrie de défense canadienne emploi environ 36 000 salariés et s’organise essentiellement autour de petites entreprises (85% des acteurs du secteur ont moins de 250 salariés). Son poids économique demeure assez modeste (environ 14Md€ de chiffre d’affaires en 2022) ainsi que son volume d’exportation (environ 7 milliards de dollars en 2022). A l’inverse, l’industrie de défense française occupe un poids économique significatif et est considérée comme un acteur stratégique de premier plan, qui génère environ 200 000 emplois directs et indirects. Présente sur la quasi-totalité des segments, elle s’organise autour d’une dizaine de grands groupes, mêlant systémiers-intégrateurs et équipementiers (i.e. Airbus, Thales, Safran, Naval Group, Dassault, MBDA, KNDS…) et d’environ 4 000 PME, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 30 milliards d’euros. De facto, le poids et la dépendance des deux industries à l’export n’est pas comparable. Ainsi, en 2022, le volume de prise de commande de l’industrie de défense française s’élevait à 27 milliards d’euros, faisant de la France le 3ème pays exportateur d’armement au monde. Il en est de même pour les pays vers lesquels exportent Paris et Ottawa. Alors que les exportations d’armement canadiennes sont majoritairement à destination des Etats-Unis (63% en 2022), la plupart des prises de commandes d’armement français concernent la zone Proche et Moyen-Orient (64% en 2022).
Opportunités de coopération industrielle de défense franco-canadienne
Si la proximité avec l’industrie de défense américaine et les limites fixées par les Etats-Unis en termes de choix de plateforme[5], peuvent être un frein aux coopérations industrielles de défense, il existe pour autant des opportunités de coopération entre industriels de défense français et canadiens, qui pourraient donner lieu à des rapprochements dans les prochaines années. C’est d’ailleurs ce que semble laisser entendre la “Déclaration relative à un partenariat renforcé en matière de défense et de sécurité” de septembre 2024, qui contient un volet dédié à la coopération autour de la modernisation des forces armées des deux pays. Outre un “partage des savoir-faire technologiques respectifs” et des “échanges sur l’organisation et l’amélioration de nos processus d’acquisition”, cette dernière prévoit notamment une coopération renforcée “dans les domaines terrestre, maritime, aérien et cyber”, sans pour autant citer de capacités précises pouvant faire l’objet d’une coopération.
L’opportunité d’une coopération renforcée réside avant tout dans le fait que les forces armées canadiennes connaissent actuellement une période d’importante transformation, conduisant à ce que plusieurs chantiers majeurs de modernisation aient été récemment lancés, ou soient en passe de l’être.
Ainsi, dans sa dernière stratégie de défense nationale, intitulée « Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada », le gouvernement canadien annonce une hausse du budget de défense (+8,1 milliards CAD sur les 5 années à venir et +73 milliards CAD sur les 20 prochaines années) ainsi que d’importants investissements dans plusieurs secteurs. Ottawa prévoit notamment d’acquérir des avions dotés de systèmes de détection et de commandement aéroportés (AWACS), des navires de combat de surface (NCSC)[6], des missiles longue portée, des drones de surveillance et d’attaque, des capacités de lutte anti-drones, de nouveaux hélicoptères tactiques, ou encore de nouveaux sous-marins. En outre, le Canada explore également la possibilité d’acquérir de nouveaux véhicules adaptés à la glace, de moderniser son artillerie, son parc de chars et ses véhicules blindés légers, de se doter de nouveaux moyens de défense aérienne, ainsi que de lancer un programme de production de véhicules blindés légers.
Ces investissements demeurent néanmoins incertains dans la mesure où ils dépendront du résultat des prochaines élections fédérales canadiennes, qui devraient se tenir d’ici octobre 2025.
Perspectives de coopération dans le domaine des sous-marins
Parmi les opportunités de coopération qui pourraient voir le jour dans les prochaines années, la France et le Canada pourraient nouer un partenariat stratégique autour de la question du renouvellement des sous-marins canadiens.
En effet, le Canada, ne dispose à ce jour que de quatre sous-marins à propulsion diesel-électrique acquis d’occasion auprès de la Royal Navy (Royaume-Uni) à la fin des années 1990, qui devraient être retirés du service fin 2030. Aussi, le pays souhaite se doter de nouveaux sous-marins, plus modernes, pour permettre à la marine canadienne de protéger les approches et les voies maritimes du Canada, ainsi que de participer aux missions de l’OTAN. Si ce besoin a été exprimé à plusieurs reprises ces dernières années[7], notamment dans un rapport parlementaire de la Commission Défense du Sénat publié en 2017 et dans le cadre du « Programme de sous-marins de patrouille canadiens » lancé en 2021 par la Marine royale canadienne, il n’a pour le moment jamais été concrétisé. Cela pourrait bien évoluer alors que la dernière stratégie de défense nationale canadienne (avril 2024) mentionne la volonté « d’étudier les possibilités de renouvellement et d’expansion de notre flotte de sous-marins pour que la Marine royale canadienne continue d’agir comme élément de dissuasion sur les trois côtes grâce aux sous-marins à propulsion classique capables de naviguer sous la glace ».
Depuis, ce projet a été précisé, notamment par le Premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé en juillet 2024 que le Canada allait acheter « 12 sous-marins à propulsion classique capables de naviguer sous la glace ». Baptisé « Projet de sous-marins de patrouille canadien » (PSPC), ce programme, dont le coût total est estimé d’environ 60 milliards de dollars canadiens, a officiellement été lancé le 10 juillet 2024, avec la publication d’une déclaration par le ministère de la Défense nationale, qui annonce la publication d’une demande d’information officielle « à l’automne 2024 ». Outre le fait qu’il devrait permettre au Canada de resserrer ses liens avec ses alliés et partenaires, le communiqué précise que ce programme devra « créer une relation durable entre le Canada et son (ou ses) partenaires stratégiques pour soutenir la formation du personnel et le partage de l’information ». Soucieuse de minimiser les délais et les coûts, la marine royale canadienne préconise l’acquisition de nouveaux sous-marins étrangers prêts à l’emploi, dont le premier exemplaire devrait être livré au plus tard en 2035, afin d’éviter toute rupture capacitaire.
A ce jour, la marine royale canadienne a identifié six modèles pouvant répondre à ses besoins, dont le sous-marin français Shortfin Barracuda de Naval Group, aux côtés du sous-marin allemand U212CD (TKMS), suédois C-71 Oceanic (Saab), espagnol S-80 (Navantia), sud-coréen KSS-III Batch 2 (Hanwha) et japonais Taigei (Kawasaki et MHI). Confrontés à des difficultés de production entraînant d’importants retards, les constructeurs américains n’ont pas été sollicités.
Aussi, plusieurs entreprises se sont déjà positionnées, dont l’allemand TKMS, profitant de la visite du ministre de la défense allemand Boris Pistorius à Ottawa en mai 2024, à l’occasion de laquelle l’Allemagne et la Norvège (tous deux membres du programme U212CD) ont proposé au Canada la mise en place d’un « partenariat stratégique » pour protéger les voies maritimes de l’Arctique ainsi que celles de l’Atlantique-Nord.
Si la France ne s’est pour le moment pas officiellement positionnée, nouer un partenariat stratégique autour de la question de la défense de l’Arctique et du Grand Nord, serait une excellente opportunité de renforcer la coopération de défense franco-canadienne et par là même de relancer la coopération industrielle de défense entre nos deux pays, en l’inscrivant dans la durée autour d’un projet structurant. En effet, face à la hausse des activités russes et chinoise, la France entend s’investir davantage dans cette zone du globe et pourrait faire bénéficier le Canada de son expérience opérationnelle (navigation sous-marine océanique), tandis que le Canada pourrait apporter à la France sa connaissance du terrain Arctique et de la navigation dans les glaces. De plus, les sous-marins expéditionnaires de la famille Barracuda de Naval Group semblent répondre aux principales exigences identifiées par le Canada en matière de capacités sous-marines (furtivité, létalité, persévérance et capacité de déploiement dans l’Arctique), ces derniers bénéficiant d’une autonomie et d’une endurance accrues, héritées de leur ascendance nucléaire. Au-delà des capacités opérationnelles et des délais de livraison, ce choix dépendra notamment de la capacité de la France à proposer un partenariat structurant à l’industrie navale canadienne (i.e. formation, infrastructures, maintien en condition opérationnelle…) qui permette de rapprocher les bases industrielles des deux pays et génère des retombées économiques positives, tant à l’échelle locale que nationale.
Perspectives de coopération dans le domaine des navires brise-glaces
Un autre domaine à fort potentiel de coopération franco-canadien concerne la production de navires brise-glaces. Alors que le Canada, les États-Unis et la Finlande ont lancé lors du sommet de l’OTAN de juillet 2024 un projet de construction commune de navires brise-glaces, sous le nom de “’Icebreaker Collaboration Effort” (ou ICE Pact), la France aurait tout intérêt à rejoindre ce projet et de bénéficier de l’expertise du Canada en la matière, en acquérant un ou plusieurs navires de ce type auprès de l’industrie navale canadienne. En effet, malgré le fait qu’elle possède la seconde ZEE au monde derrière les Etats-Unis, la France ne dispose à ce jour que d’un navire brise-glace, “L’Astrolabe”, exclusivement dédié à des missions de ravitaillement en Antarctique et de surveillance des ZEE.[8] Il n’existe pas de navire équivalent pour la zone Arctique. Le besoin pour la France de tels équipements étant limité en termes de volume, contrairement au Canada, une production purement nationale n’aurait pas d’intérêt. A l’inverse, un partenariat industriel franco-canadien autour de la production de ces équipements renforcera la collaboration industrielle entre Paris et Ottawa, ainsi que leur capacité à mener des missions communes en Arctique et dans le Grand Nord, conformément à la volonté affichée par les deux pays.
À propos des auteurs
Gaspard Schnitzler est chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), spécialiste des questions de défense européennes et des politiques industrielles de défense. Auparavant, il a travaillé comme analyste au sein du ministère des Armées. Gaspard est diplômé de l’institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) où il enseigne aujourd’hui.
Erik Vouvalidis est analyste au sein du secteur de l’infrastructure et environnement du ministère de la Défense nationale du Canada. Auparavant, il a travaillé comme analyste à Sécurité publique Canada, au sein du secteur de la sécurité nationale et de la cybersécurité. Erik est titulaire d’une maîtrise en affaires internationales de la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton.
[1] Via Mack Defense, la filiale américaine du groupe Volvo.
[2] En raison du contrat susmentionné.
[3] Le volume financier des exportations d’armement du Canada vers la France demeure inconnu. Néanmoins, la France figure parmi les quatre principales destinations des licences d’exportation d’armement délivrées en 2022 par le Canada (derrière le Royaume-Uni, l’Allemagne et Israël) avec 226 licences délivrées pour des « articles stratégiques. Source.
[4] Dont les navires de défense côtière de la classe Kingston, les navires d’entraînement de la classe Orca, ainsi que les navires de soutien auxiliaires.
[5] En raison notamment de l’intégration sur ces dernières d’équipements d’origine américaine.
[6] Le programme NCSC prévoit l’acquisition de 15 navires de combat en vue du remplacement des destroyers de la classe Iroquois et des frégates de classe Halifax.
[7] Il apparaissait déjà dans le Livre blanc sur la défense publié en 1987
[8] Propriété des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV), il est armé par la Marine nationale.
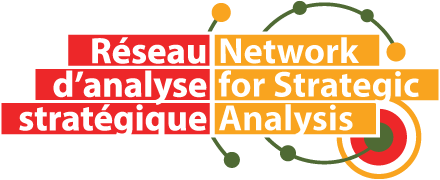



Les commentaires sont fermés.