|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Pour un pays qui n’a pas entrepris de révision complète de sa politique étrangère depuis près de deux décennies, le Canada a vu, en l’espace d’un automne, l’articulation de deux visions qui ont pour objectif de guider son engagement international.
La première a pris la forme d’un discours prononcé par la vice-première ministre Chrystia Freeland devant la Brookings Institution à Washington, le 11 octobre. Ses remarques, qui ont rapidement été renommées la « Doctrine Freeland », exposent la façon dont le Canada devrait naviguer dans le monde de l’après après-Guerre froide, qui, selon elle, est marqué par une compétition entre démocraties et autocraties.
Un peu plus d’un mois plus tard, le Canada a publié sa stratégie pour l’Indo-Pacifique, attendue depuis longtemps. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a estimé que cette stratégie était une réorientation de la politique étrangère du Canada vers la région Indo-Pacifique, même si Ottawa compte maintenir ses engagements actuels sur les autres théâtres.
Ces deux visions offrent deux réflexions stratégiques distinctes sur la façon dont le Canada devrait se positionner dans un monde de rivalité et de changement. Pourtant, si les deux présentent des points forts évidents, ceux-ci risquent, dans les deux cas, d’être compensés par les faiblesses de ces textes.
La doctrine Freeland : une recette pour s’isoler davantage
Le discours de Freeland à Washington reconnaît une réalité désormais incontournable, à savoir que l’ordre international libéral du moment unipolaire de l’après-Guerre froide est révolu et ne reviendra pas. Même si certaines normes et pratiques traditionnellement associées à l’internationalisme libéral continueront d’influencer la conduite interétatique, les conditions qui ont permis l’expression la plus complète de l’ordre libéral n’existent tout simplement plus.
Au cours des trois dernières décennies, l’ère de l’hégémonie libérale a permis au Canada de mener une politique étrangère confortable et axée sur des valeurs. En revanche, l’ordre international émergent menace de forcer le découplage entre certains des impératifs de la politique étrangère du Canada et l’identité nationale du pays. Dans cette perspective, Mme Freeland peut être félicitée pour avoir eu le courage de s’attaquer à la culture canadienne en matière de politique étrangère, une culture qui est bien ancrée et apparaît dépassée.
Pourtant, si le diagnostic de Mme Freeland est exact, les traitements qu’elle propose sont problématiques. Son discours présente trois piliers de réflexion pour la révision d’une approche occidentale vis-à-vis du reste du monde : les relations entre démocraties, celles avec les régimes autoritaires et enfin celles avec les États qui « nichent entre les deux camps ». Chaque pilier présente des défauts fondamentaux. Ensemble, ils constituent une recette qui risque de renforcer – plutôt que réduire – l’isolement du Canada sur la scène internationale.
Le premier pilier de Mme Freeland, qui est, selon elle, « le plus fondamental », appelle à un approfondissement des relations entre les démocraties du monde. Si, à première vue, il y a peu de raisons d’être en désaccord avec une telle proposition, le diable se cache dans les détails.
Par exemple, l’idée selon laquelle l’« amilocalisation » (friendshoring : commerce entre pays qui partagent les mêmes valeurs démocratiques) offrirait une solution aux problèmes de sécurité d’aujourd’hui se heurte à des difficultés dès que l’on s’intéresse aux détails. Qu’est-ce que l’amilocalisation nous permettrait d’obtenir de nos alliés que nous n’obtenions pas déjà d’eux ? Dans quels secteurs spécifiques devrions-nous nous dissocier de nos adversaires ? Combien de temps une telle réorientation des chaînes d’approvisionnement prendrait-elle et comment pourrait-elle être appliquée ? Quel serait le coût pour les consommateurs ? De plus, l’approfondissement des liens économiques entre les États-Unis et leurs alliés européens et asiatiques ne menacerait-il pas la position privilégiée du Canada dans l’économie américaine ? Bien qu’on ne puisse s’attendre à ce qu’un seul discours réponde à toutes ces questions de manière suffisamment détaillée, elles soulèvent néanmoins des doutes quant à la faisabilité de l’« amilocalisation » en tant que cadre de la politique étrangère.
Après l’effondrement des relations entre l’Empire et la périphérie au XIXe siècle et des blocs géopolitiques au XXe siècle, nous vivons aujourd’hui dans le premier ordre véritablement mondial de l’histoire. On ne sait toujours pas dans quelle mesure l’amilocalisation permettrait aux démocraties libérales d’améliorer leur influence relative et leur attractivité dans ce nouvel ordre mondial, un ordre qui sera inévitablement façonné par le pluralisme politique et culturel. En effet, le concept divise au sein même de l’Occident, certains estimant que réinvestir dans une architecture du commerce mondial qui serait ouverte et fondée sur des règles est un effort plus intéressant qui jouerait en faveur de l’Occident. Les volontés de découplage risquent d’entraîner un nivellement par le bas que les pays occidentaux – en particulier les économies dépendantes comme le Canada – ne gagneront peut-être pas.
Le deuxième pilier mentionné par Mme Freeland – et celui qui est le moins développé conceptuellement – concerne les relations avec les pays dits intermédiaires, qui ne sont ni nos alliés démocratiques ni nos adversaires autoritaires. Une telle terminologie est susceptible de réduire notre influence auprès de ces pays plutôt que de nous aider à construire des ponts avec eux, si tant est que nous ayons l’intention d’entreprendre un effort substantiel pour construire de tels ponts et sortir de l’approche largement centrée sur les alliés (approche caractéristique de la politique étrangère canadienne au cours des dernières décennies). Ces pays « intermédiaires » ne se considèrent pas comme des acteurs qui pourraient être utilisés dans le cadre d’une lutte idéologique qui les dépasse, mais comme les auteurs de leur propre destin. Ce sont des États souverains et ils n’ont pas besoin qu’on leur explique quels sont leurs intérêts.
Le troisième pilier – et le plus problématique – du discours de Mme Freeland appelle à repenser nos relations avec les pays autoritaires. Cette partie du discours est truffée d’hypothèses qui ne reflètent pas la nature complexe de l’ordre international émergent.
L’idée même selon laquelle le monde d’aujourd’hui est marqué par une compétition entre démocraties et autocraties est démentie par de nombreux faits facilement observables. Dans le cas de l’Ukraine, les pays occidentaux démocratiques se tournent vers les pays autoritaires que sont le Venezuela, l’Arabie saoudite, le Qatar et l’Azerbaïdjan pour les aider à faire face aux retombées énergétiques de la guerre. Parallèlement, certaines des plus grandes démocraties du monde, comme l’Inde et le Brésil, se sont largement abstenues de condamner l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Dans la région Indo-Pacifique, le système politique léniniste du Vietnam ne l’a pas empêché de s’associer à l’Occident pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité face à la Chine. Ces faits montrent que le Canada ne devrait pas adopter le paradigme « démocratie contre autocratie » comme critère de renforcement de son engagement international, étant donné que ce paradigme ne permet pas de saisir les dynamiques des plus grands défis géopolitiques d’aujourd’hui (l’Ukraine) et de demain (l’Indo-Pacifique).
Le schéma binaire démocratie-autocratie manque également de nuances pour rendre compte de la diversité des systèmes politiques dans le monde, ainsi que des différents objectifs de politique étrangère que peuvent avoir les États autoritaires. Alors que la Russie fait fi des normes établies et est sortie perdante de la Guerre froide, la Chine a été grandement bénéficiaire du statu quo et cherche à maintenir des liens économiques et technologiques avec l’Occident pour alimenter sa modernisation et sa croissance.
Bien que l’ascension de la Chine suscite de nombreuses préoccupations – légitimes – en matière de sécurité, les impératifs qui façonnent les relations du Canada avec la Chine diffèrent fondamentalement de la question des relations avec une Russie revancharde. Cela est d’autant plus vrai que Pékin occupe une place centrale dans le commerce mondial et dans le multilatéralisme, dont Ottawa est traditionnellement dépendant. L’affirmation générale de Mme Freeland selon laquelle « les régimes autoritaires nous sont fondamentalement hostiles » et « notre réussite fait peser sur eux une menace existentielle » réduirait la marge de manœuvre du Canada qui lui aurait pourtant permis de mener une politique étrangère reflétant l’intérêt national au cas par cas. Étant donné qu’une coopération doit aller dans les deux sens, cela implique l’établissement d’un cadre général pour les relations qui facilite (au lieu de décourager) la collaboration lorsque nos intérêts sont alignés.
Pour une ministre des Affaires étrangères dont l’allocution de signature en 2017 était centrée sur la nécessité de maintenir « l’ordre international fondé sur des règles », il est choquant de constater que le discours récent de Freeland n’accorde que peu d’attention à la manière dont l’adhésion à la concurrence idéologique pourrait miner la résilience des normes internationales. Et si Mme Freeland admet que la coopération avec les pays autoritaires reste nécessaire dans des domaines d’intérêt commun tels que le changement climatique, cette coopération peut devenir beaucoup plus difficile lorsque le paradigme (en matière de politique étrangère) est axé essentiellement sur la concurrence sécuritaire (voire sur l’endiguement pur et simple).
Du point de vue intellectuel, il est cohérent d’adopter une vision de la politique étrangère canadienne qui cherche moins à s’éparpiller en rejoignant de multiples et divers clubs/groupes et qui est plus étroitement axée sur les intérêts fondamentaux du Canada. Il n’est pas sûr que cela soit cependant l’intention initiale de Freeland. La vision de Freeland risque de pousser le Canada à se refermer au sein de l’Occident non géographique, mais sans les avantages d’une politique étrangère plus étroitement ciblée.
Le paradigme Freeland en politique étrangère canadienne est de nature idéologique et de portée mondiale. Cependant, le Canada n’a pas les moyens d’être simultanément un acteur central en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans les forums multilatéraux. Une vision plus géographique ainsi qu’une orientation régionale pourraient-elles mieux servir les intérêts canadiens ?
La stratégie Indo-Pacifique du Canada : un document engendrant de la confusion
Le Canada a publié sa stratégie pour l’Indo-Pacifique à la fin du mois de novembre. Ce document a été salué comme étant le « document stratégique le plus substantiel » en matière de politique étrangère qui ait émané d’un gouvernement canadien depuis des années.
Compte tenu du rôle central de l’« ancrage nord-atlantique » dans l’élaboration de la politique étrangère du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale, le simple fait d’élaborer une stratégie Indo-Pacifique pourrait contribuer à rééquilibrer les priorités internationales du Canada pour tenir compte du déplacement des centres de gravité géopolitique et économique du monde. En particulier, l’absence d’une utilisation des termes « libre et ouvert » pour formuler les enjeux régionaux dans ce document est une évolution bienvenue, car cela peut indiquer que la stratégie régionale d’Ottawa se distingue de l’approche plus conflictuelle de Washington. La conceptualisation de la région par le gouvernement se distingue également car elle exclut l’océan Indien occidental et se taille un rôle spécial de « voisinage » dans le Pacifique Nord, ce qui démontre la volonté (louable) de cibler les objectifs stratégiques.
Toutefois, si on va plus loin dans l’analyse, trois lacunes majeures sont visibles.
Premièrement, la stratégie Indo-Pacifique ne s’appuie pas sur une compréhension plus générale de la nature et de la portée des intérêts du Canada dans un ordre international en mutation. Il serait nécessaire de mener un examen complet de la politique étrangère qui situerait les intérêts indo-pacifiques du Canada dans un cadre de référence global, en évaluant l’importance relative de la région par rapport aux impératifs politiques sur d’autres théâtres géographiques. En l’absence d’un tel examen, les objectifs régionaux du Canada continueront de manquer de clarté.
Cette situation est exacerbée par la promesse (émise dans la stratégie) de renforcer la présence militaire du Canada dans la région, ce qui suggère une incapacité à cibler davantage des ressources nationales limitées. Cela va à l’encontre des recommandations du Réseau d’analyse stratégique et reflète une réticence à reconnaître qu’un environnement de plus en plus militarisé sur le continent européen continuera d’accaparer une grande partie de l’attention du Canada dans le domaine militaire. Même une victoire de l’Ukraine dans la guerre actuelle n’éliminera pas le défi que la Russie est susceptible de poser pour le système de sécurité européen à long terme. Une présence militaire canadienne symbolique dans la région Indo-Pacifique est davantage susceptible de désorganiser la politique étrangère globale du Canada que de dissuader la Chine.
Deuxièmement, bien que la Chine soit au premier plan et occupe une part importante dans ce texte, la stratégie Indo-Pacifique n’a pas été utilisée comme une occasion de poursuivre une stratégie détaillée et calibrée pour la Chine. À ce titre, l’inquiétude persiste quant à la possibilité que le Canada ait développé une stratégie Indo-Pacifique dans le but de ne pas avoir à proposer une approche globale et révisée vis-à-vis de la Chine.
La stratégie est claire quant à la nature multidimensionnelle du défi que représente la Chine pour la sécurité canadienne et l’ordre mondial. Toutefois, elle ne précise pas si le fait d’empêcher la Chine de dominer l’Indo-Pacifique en termes de sécurité représente un intérêt vital pour le Canada et, le cas échéant, si cet objectif peut être atteint par des mesures autres que l’endiguement et le découplage complets. Bien qu’il soit symboliquement fait mention de la nécessité de coopérer sur certains dossiers, aucune plateforme concrète de coopération n’est identifiée. En outre, il n’y aucune démarche de délimitation des domaines dans lesquels la coopération devrait être restreinte pour des raisons de sécurité.
Que ce soit au niveau national, bilatéral, régional ou multilatéral, l’accent est mis sur la contestation de la Chine ou sur la défense face aux conséquences négatives de ses actions. Le focus mis sur la coexistence avec la Chine par Marc Garneau, le prédécesseur de Joly, dans son approche des « quatre C » a disparu. Le résultat est que le Canada n’a pas réussi à exprimer clairement, de manière simple, s’il est en faveur d’une région ouverte ou d’une région structurée par une nouvelle Guerre froide. Ainsi, comme dans le cas de la doctrine Freeland, une relation dont le point de départ intellectuel est la confrontation plutôt que la coexistence peut avoir du mal à faire de la place pour la coopération, même lorsque celle-ci est dans l’intérêt des deux parties. Il n’est pas possible de traiter un adversaire comme une menace existentielle, de poursuivre une stratégie de confrontation générale et d’espérer choisir des domaines de coopération en fonction de ses propres préférences.
Enfin, il s’agit d’une occasion manquée qui aurait pu permettre de démêler les différentes valeurs et les différents intérêts de manière à clarifier la portée des objectifs régionaux du Canada. Bien que nous nous soyons habitués à l’hypothèse selon laquelle la promotion de nos valeurs s’accorde avec la promotion de nos intérêts, le déclin de l’hégémonie libérale dans la politique mondiale entraîne le découplage (partiel) de ces deux objectifs.
Pour souligner la portée Indo-Pacifique du document, l’Inde figure en deuxième position (après la Chine) dans la description de l’engagement régional du Canada. Pourtant, la stratégie présente le désir d’approfondir les relations avec New Delhi en utilisant le langage de la démocratie et des droits de la personne, plutôt que des intérêts stratégiques communs, malgré le recul démocratique évident et largement reconnu de l’Inde. Le paradigme Indo-Pacifique, développé en réaction à la montée en puissance de la Chine, est par nature un concept stratégique davantage qu’un concept fondé sur des valeurs. L’accent mis sur les valeurs partagées avec l’Inde, alors que celles-ci font défaut à bien des égards, révèle à quel point Ottawa a encore du mal à déterminer et articuler ses intérêts.
La stratégie fait également de multiples références à l’établissement de relations avec des pays « d’optique commune » (like-minded partners). Cependant, plusieurs partenaires du Canada dans l’Indo-Pacifique se sont abstenus de critiquer l’agression illégale de la Russie contre l’Ukraine. De même, une grande partie de l’Asie du Sud-Est considère la Chine comme un partenaire économique important et non comme une menace existentielle, quels que soient les différends territoriaux que ces pays peuvent avoir avec Pékin. Il est difficile de savoir dans quelle mesure le Canada partage effectivement les mêmes idées que des pays comme l’Inde. Cela soulève la question suivante : le Canada est-il vraiment déterminé à s’engager en faveur des priorités des acteurs de la région ou Ottawa se concentrera-t-elle inévitablement sur l’approfondissement des relations avec ses quelques partenaires qui partagent vraiment les mêmes idées, comme le Japon et l’Australie ?
En fin de compte, le Canada paie le prix de plusieurs années à maintenir une posture réactive à l’égard de l’Asie. La stratégie canadienne est publiée neuf mois après celle des États-Unis et plus d’un an après celle de l’Union européenne. De plus, le soi-disant pivot vers l’Asie de Washington, malgré tous ses défauts, date de l’administration Obama.
Nous sommes en retard sur la question et nous n’avons pas réussi à formuler clairement nos priorités globales en matière de politique étrangère. Nous sommes donc contraints de nous adapter aux conditions fixées par d’autres. Cela vaut notamment pour la confrontation avec la Chine, pour laquelle les États-Unis se réserveront le droit de promouvoir leurs intérêts tout en imposant des limites à la marge de manœuvre de leurs alliés dans la définition de leurs propres intérêts. Cela réduira sans aucun doute l’éventail d’actions potentielles pour l’engagement d’Ottawa dans la région.
Conclusion : un futur continental pour le Canada ?
D’une part, le changement conceptuel de Mme Freeland, qui passe de la préservation de l’ordre international fondé sur des règles à une quasi-adoption d’une nouvelle Guerre froide, devrait inquiéter tous les Canadiens qui croient qu’un certain degré de prévisibilité mondiale est nécessaire pour qu’Ottawa puisse se tailler une politique étrangère qui aille au-delà de la garantie de la souveraineté nationale et de la sauvegarde de la relation avec les États-Unis. Si la vice-première ministre croit que les intérêts du Canada sont en grande partie continentaux, elle devrait le faire savoir explicitement. Un tel acte rendrait un grand service à la politique étrangère canadienne en l’aidant à surmonter des décennies de dérive sans but.
D’autre part, malgré les grandes attentes qui accompagnaient la publication de la stratégie Indo-Pacifique, le Canada semble avoir très peu appris de son partenaire régional, l’Australie. Canberra est beaucoup plus consciente de la nature ciblée et géographique de ses intérêts, et a réussi à devenir un acteur à part entière dans la région Indo-Pacifique tout en évitant les dangers d’une expansion excessive.
Certes, la géographie de l’Australie diffère de la nôtre – le Canada est simultanément un État de l’hémisphère occidental, de l’Atlantique, de l’Arctique et du Pacifique. Toutefois, au XXIe siècle, le statut de puissance moyenne dépend en partie d’une présence déterminante dans un complexe de sécurité régional. Le Canada n’occupe une telle position nulle part, que ce soit dans les Amériques, en Europe, ou en Asie. Pendant des décennies, nous avons refusé d’affronter la réalité du déclin de notre influence mondiale relative, en grande partie pour des raisons liées à notre identité nationale et à notre politique intérieure. Ce faisant, nous nous sommes éparpillés et nous avons laissé passer des occasions de conserver notre statut de puissance moyenne.
Le Canada est trop isolé des principales dynamiques économiques et stratégiques en Asie pour être pris au sérieux en tant qu’acteur régional de premier plan, au même titre que le Japon, l’Inde ou l’Australie. Le Canada ne jouera jamais non plus un rôle aussi important que la France ou l’Allemagne dans le tissu politique européen. Toutefois, avec une population plus importante, le Canada pourrait être davantage pris au sérieux par son voisin américain. Par ailleurs, le changement climatique ouvre la voie à une importance stratégique accrue de l’arrière-cour canadienne en Arctique pour les acteurs du monde entier.
Ces faits plaident en faveur d’une politique étrangère plus continentale pour le Canada, car c’est la voie la plus prometteuse pour retrouver le statut de puissance moyenne à (peut-être très) long terme. Malgré toutes les discussions entourant la stratégie Indo-Pacifique du Canada, on a trop peu tenu compte du fait qu’une stratégie consiste à faire des choix, surtout lorsque les ressources sont limitées.
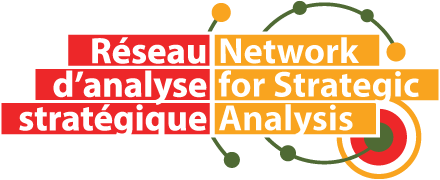




Les commentaires sont fermés.