En février 2025, l’Arabie saoudite accueillait une rencontre entre émissaires américains et russes afin de s’entendre sur les modalités d’engagement de négociations russo-américaines directes sur le conflit opposant Moscou et Kiev depuis maintenant trois ans. Le choix de la capitale saoudienne n’est pas anodin, Riyad entretenant des relations diplomatiques privilégiées avec l’administration Trump (et ce depuis le premier mandat de ce dernier, qui avait effectué son premier déplacement à l’étranger dans le pays) et avec Moscou. Le choix de l’Arabie saoudite illustre la position de plusieurs États arabes depuis le début de la guerre en février 2022, qui, loin de couper les liens avec Moscou, ont conservé et pour certains renforcé leurs liens avec le régime de Vladimir Poutine. Ainsi, en juin 2023, le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectuait une visite d’État en Russie à l’invitation de Vladimir Poutine, plus d’un an après le lancement de l’offensive russe contre Kiev. Il précéda de quelques semaines le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui rencontra le président Poutine à Saint-Pétersbourg au mois de juillet suivant. Par ailleurs, au-delà du maintien des relations diplomatiques, certaines prises de positions arabes ont pu quelque peu surprendre les analystes occidentaux. En effet, du côté du Golfe arabe, lors du vote par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU), le 25 février 2022, d’une résolution condamnant l’invasion russe de l’Ukraine, les Émirats arabes unis, membre non permanent et pourtant allié des États-Unis et de la France, se sont abstenus. L’Arabie saoudite est quant à elle parfois accusée de s’entendre avec la Russie depuis le début du conflit ukrainien afin de maintenir un prix élevé des hydrocarbures, dont son économie, comme celle de la Russie, est particulièrement dépendante.
Ces quelques exemples illustrent ainsi les positions complexes, voire ambiguës qu’entretiennent plusieurs États arabes avec le conflit russo-ukrainien. Loin de condamner sans équivoque l’attaque déclenchée le 22 février 2022, certains États membres de la Ligue arabe, pour certains particulièrement proches des États-Unis, ont pris leur distance avec le légitimisme revendiqué des positions occidentales, donnant l’impression de ne pas soutenir par défaut le droit international et les valeurs du système onusien. Ce positionnement peut être d’autant plus surprenant au premier abord, puisque certains États comme l’Algérie ont fait de la lutte contre l’impérialisme et la défense du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes le fil conducteur de leurs politiques étrangères, et ce depuis plusieurs décennies.
Cette contribution se propose d’analyser les positions de plusieurs États arabes, répartis en trois catégories, au sujet de l’agression russe ; de mettre en lumière leurs déterminants ; et de conclure quant au positionnement d’États situés dans un espace soumis à de fortes rivalités entre les grandes puissances sur la scène internationale. Elle démontre que plusieurs États de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont adopté des positions singulières reposant à la fois sur la prise en compte d’intérêts directs tout en veillant à ne pas s’opposer frontalement aux États-Unis et aux autres puissances occidentales. Elle vise, finalement, à déterminer si, comme l’affirme Maurice Gourdault-Montagne, vue des pays du pourtour méditerranéen et de la région moyen-orientale, la guerre russo-ukrainienne ne constitue qu’un « conflit régional entre Blancs » ne présentant pas un caractère fondamentalement déterminant.
***
Pour poursuivre la lecture, rendez-vous sur le site du Rubicon.
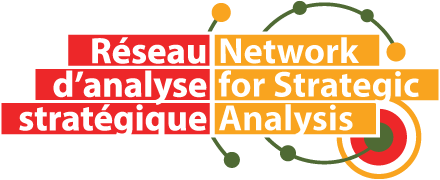



Les commentaires sont fermés.