Analyse du plan de Donald Trump pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan
Le 8 août 2025, Donald Trump reçoit à la Maison Blanche le Président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, et leur affirme son soutien au processus de résolution du conflit entre les deux pays, qui dure depuis plus de trente ans.
Les deux anciennes républiques socialistes soviétiques se sont affrontées à plusieurs reprises durant cette période pour le contrôle du Haut-Karabagh, région montagneuse alors peuplée majoritairement d’Arméniens et enclavée dans l’Azerbaïdjan. En septembre 2023, l’armée azerbaïdjanaise reprend le contrôle total de cette enclave et de sa capitale Stepanakert, renommée Khankendi et réintégrée au sein de la République d’Azerbaïdjan. Sa population arménienne a dû fuir en Arménie, mais la fin de ce conflit armé pose plusieurs questions qui continuent de nourrir des tensions entre les deux pays : sort réservé aux prisonniers de guerre arméniens, préservation de l’héritage culturel dans la région, repeuplement de la région sous l’autorité du gouvernement de Bakou et ‘accueil des réfugiés du Karabagh en Arménie.
Alors que la guerre était l’élément le plus déterminant pour le paysage politique et géopolitique dans la région, la paix durable est désormais l’objectif dont se réclament tous ces acteurs, répondant au principe de « la paix par le deal » cher au président des Etats-Unis. Mais la construction de cette paix se heurte également à des intérêts différents. Dans ce point chaud, les objectifs des acteurs régionaux et extérieurs, qui disent soutenir l’apaisement dans le Caucase, seront analysés.
Le Karabagh, nouvelle vitrine du gouvernement d’Aliyev
Premièrement, il est important de s’interroger sur le conflit en lui-même et sa résolution. Côté azerbaïdjanais, on dit que le dossier est refermé avec la réintégration de la région du Karabagh, tandis que côté arménien, on déplore l’absence de mesures en faveur des populations civiles, notamment vis-à-vis de l’épineuse question du « droit au retour ». En effet, une grande partie de cette population habitant dans la république sécessionniste de l’Artsakh (nom du Haut-Karabagh en arménien) y résidait déjà avant la première guerre en 1988. A l’inverse, les populations azéries qui ont été exilées dans d’autres région d’Azerbaïdjan après la prise de contrôle par les Arméniens sont aujourd’hui incitées à revenir dans la région, alors que la plupart des villages azéris sont restés à l’abandon pendant trois décennies.
A coups de mesures incitatives et de construction d’infrastructures, le président Aliyev tente de rendre la région attractive pour ses citoyens, en proposant entre autres de vivre dans des villes nouvelles construites par le gouvernement à moindre coût, afin de renforcer sa popularité. L’objectif d’Aliyev est de tourner la page de la guerre, malgré les accusations de nettoyage ethnique, et demande à l’Arménie d’amender sa constitution en retirant les références à l’Artsakh et de mettre fin au groupe de Minsk de l’OSCE, qui était une plateforme pour un processus de pacification, surveillée par la Russie, les États-Unis et la France. Or, les demandes du président Aliyev continuent d’alimenter le ressentiment en Arménie, partagée entre volonté de trouver une paix durable et traumatisme de cette terre perdue.
La crise politique en Arménie
Le gouvernement de Pachinian est en effet sous tension. Le Premier ministre, issu d’une révolution de velours en 2018, est aujourd’hui en conflit ouvert avec l’opposition parlementaire, mais également avec l’Église apostolique arménienne, qui dispose d’une autorité morale au sein de la population, ainsi qu’avec Samuel Karapetian, qui est l’homme le plus riche du pays et propriétaire de la plus grande société énergétique. Le Premier ministre dit avoir échappé à un coup d’État organisé par ce dernier et par l’évêque Bagrat Galstanian, qui se fait le porte-parole des opposants au processus de paix avec Bakou. La rupture entre le gouvernement et ces acteurs est aussi très profonde et divise la société arménienne. Sur fond de cette nouvelle divergence se pose une divergence plus ancienne, plus géopolitique, entre les partisans d’un rapprochement avec l’Occident, incarnée par Pachinian, et les nostalgiques de la relation très forte avec la Russie. En effet, suite au retrait des troupes russes chargées du maintien de la paix dans le couloir de Latchine entre l’Arménie et le Haut-Karabagh en 2023, Yerevan est allé plus loin que jamais dans son divorce avec Moscou, indirectement lié à l’isolement stratégique de Vladimir Poutine depuis le 24 février 2022.
Ce retrait des Russes, déploré par l’Arménie, a été interprété par des experts comme un blanc-seing accordé à Ilham Aliyev pour mener la dernière guerre, par crainte de détériorer leurs relations avec lui. Par exemple, l’Arménie a suspendu sa participation à l’Organisation du traité de sécurité collective, alliance politico-militaire pilotée par le Kremlin, et fait voter une loi en faveur une potentielle candidature à l’entrée dans l’Union européenne au parlement. Cette orientation prise par le gouvernement arménien a révélé la perte d’influence de la Russie dans le Caucase du Sud, région qu’elle considère comme son « étranger proche ».
La Russie tente tant bien que mal de garder des relations étroites avec l’Arménie, qui a longtemps été l’un de ses relais favoris dans la région. Mais les relations se sont également dégradées entre la Russie et l’Azerbaïdjan, avec l’interpellation de multiples Azéris en Russie et de Russes en Azerbaïdjan au cours des derniers mois et la fermeture des médias pro-russes dans l’ancienne RSS. Le torchon brûle entre Bakou et Moscou, et d’autres acteurs pourraient en profiter.
Normalisation(s) ?
En effet, l’Arménie réalise qu’elle ne peut se permettre de dépendre de la Russie sur un plan militaro-stratégique et commercial. C’est pour cela que le dossier de la normalisation avec la Turquie est remis sur la table. La frontière turco-arménienne est fermée depuis la première guerre en 1994, et Ankara a imposé un blocus commercial en solidarité de son allié à Bakou. Mais le Premier ministre Pachinian a rencontré le président Erdogan à Istanbul, ce qui est un fait rare dans l’histoire de la relation entre les deux pays. La Turquie semble plus ouverte qu’avant à une ouverture des frontières, qui serait bénéfique pour les régions frontalières, voire à une normalisation.
Cependant, cette normalisation semble dépendre de la normalisation entre Yerevan et Bakou, car la Turquie reste fidèle à son alliance avec l’Azerbaïdjan, en dépit de certains désaccords de fond, notamment sur le Proche-Orient. De son côté, l’Arménie essaie de miser sur un projet appelé « Crossroads of Peace » (ou « Carrefours de la paix »), qui permettrait d’ouvrir les frontières entre les pays du Caucase. Cela semble nécessaire, à partir du moment où la Géorgie, qui était le pays resté neutre dans ce différend, et donc voie de passage pour beaucoup, semble de moins en moins fiable en raison de la politique de son nouveau gouvernement, non reconnu par une partie de la communauté internationale.
« Trump Route for International Peace and Prosperity »
L’une des conditions posées par l’Azerbaïdjan pour signer la paix définitivement avec l’Arménie est la création d’un couloir qui traverserait la région du Syunik dans le sud de l’Arménie, et relierait la région autonome du Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan. Pour l’instant, les Azéris du Nakhitchevan doivent passer par l’Iran pour y accéder. Par ailleurs, cette région autonome est limitrophe de la Turquie sur quelques kilomètres : le rêve des nationalistes azéris est de relier ces deux composantes du monde turcique. L’Azerbaïdjan est déjà le premier partenaire énergétique de la Turquie, qui se voit desservie par la Géorgie. Ces projets de corridor sont considérés comme dangereux pour les Arméniens, d’abord parce qu’ils porteraient atteinte à leur souveraineté territoriale, ensuite parce que le gouvernement de Bakou a déjà montré qu’il n’était pas digne de confiance. L’Arménie tient à sa région méridionale du Syunik, ainsi qu’à son étroite frontière avec la République islamique d’Iran, qui reste un partenaire économique non négligeable.
Pendant que le Premier ministre arménien veut surtout éviter l’Azerbaïdjan d’occuper cette fine bande de terre de quelques kilomètres qui lui donnerait un accès au Nakhitchevan et à la frontière avec la Turquie, le Président Aliyev veut éviter un corridor contrôlé par les Arméniens, qui pourraient imposer des droits de passage sur leur territoire. Aliyev appelle ce couloir le « corridor du Zanguezour », et fait ainsi référence au nom azéri de la région du Syunik, ce qui est considéré comme une provocation du côté arménien, puisque cette dénomination fait abstraction de la souveraineté de Yerevan sur cette vallée.
C’est ici qu’intervient le président Trump. Son objectif : déjouer l’influence des Russes et des Iraniens dans le Caucase. Le 47e président continue son projet de faire la paix à tout prix à travers des deals, et ne cache plus son intention de gagner le prix Nobel de la paix pour cette raison. Parmi les six ou sept paix qu’il dit avoir instituées, il compte celle entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, même si les pays ne sont plus en conflit armé depuis 2023. Trump a ainsi proposé d’être un intermédiaire pour les deux dirigeants du Caucase du Sud. Il propose un bail emphytéotique américain sur la route du Syunik, renommée TRIPP, pour Trump Route for International Peace and Prosperity, et permettrait de relier le Nakhitchevan à Bakou. Cette mainmise des Américains durerait cent ans, mais pose plusieurs questions : d’abord, la souveraineté nationale de l’Arménie est-elle véritablement respectée ? Ensuite, clôt-elle les ambitions de Bakou et institue-t-elle une paix stable ? Enfin, ce corridor permet-il de désenclaver la région, dans laquelle beaucoup de frontières restent complètement fermées, en l’absence de véritable normalisations diplomatiques ?
Un tournant géostratégique pour désenclaver la région
L’Arménie et l’Azerbaïdjan doivent se servir de cette nouvelle donne pour transformer leurs relations bilatérales. Longtemps, ces deux pays ont été dans l’orbite de Moscou, qui a continué d’alimenter les tensions entre les deux pendant des décennies. L’Arménie a toujours été très dépendante de la Russie, car au contraire de l’Azerbaïdjan, elle ne dispose pas de ressources énergétiques propres. Ce dernier a gardé sa relation historique avec la Turquie, même si des désaccords sur certains sujets se font de plus en plus entendre (notamment sur la relation de ces deux pays à Israël, rival stratégique d’Ankara mais partenaire militaire et énergétique infaillible de Bakou). La Géorgie, qui gardait des liens cordiaux avec les deux pays, est confrontée elle-même à une instabilité inédite, ce qui oblige tout le monde à repenser les rapports dans l’ensemble de la région. L’Iran était l’allié traditionnel par défaut de l’Arménie, par rivalité avec l’Azerbaïdjan. Aujourd’hui très affaibli par sa guerre contre l’État hébreu, Téhéran voit d’un mauvais œil le projet de TRIPP, dans une zone qui était influencée par Moscou bien plus que par Washington.
Mais les États-Unis ne sont pas un partenaire suffisant, et l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont besoin de développer les partenariats en Eurasie. C’est ainsi que la Chine apparaît comme une nouvelle option : contrairement à la Russie, elle ne tarit pas d’une mauvaise image auprès des gouvernements respectifs et propose d’inclure ces pays dans ses nouvelles routes de la soie. L’Azerbaïdjan est vu comme essentiel dans l’établissement du fameux corridor transcaspien, aussi appelé Middle Corridor (parfois « corridor médian » en français), et qui relie la mer de Chine à l’Europe en passant par le Kazakhstan, le Caucase (contournant au passage l’Arménie) et la Turquie.
L’Arménie et l’Azerbaïdjan, tout comme la Turquie ont ainsi participé, en qualité de partenaire de dialogue, au sommet de Tianjin, de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui réunit entre autres la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan et l’Iran, et tente de proposer une alliance alternative à l’hégémonie américaine aux pays d’Asie. C’est dans ce cadre que Nikol Pachinian a rencontré Xi Jinping. Entre la TRIPP américaine et le dialogue avec l’Est, l’Arménie et l’Azerbaïdjan semblent, à différents égards, tenter de jouer sur plusieurs tableaux pour assurer leur transition géostratégique. Yerevan a également profité de la fin de la guerre pour nouer des relations avec les pays de l’OCS, en particulier avec l’Inde, dont elle était déjà proche au cours des dernières années. A noter que Yerevan a instauré des relations diplomatiques avec le Pakistan, qui était le seul Etat membre de l’ONU qui ne reconnaissait pas l’indépendance du pays du Caucase, en raison de son soutien à Bakou. A présent, l’Arménie est reconnue par l’intégralité de la communauté internationale.
Le rapprochement avec l’UE
Et l’Union européenne dans tout ça ? L’UE est un partenaire important pour les deux pays, en les incluant dans sa politique de voisinage, mais opte pour une relation adaptée à chaque gouvernement. Tandis que la relation avec l’Azerbaïdjan est principalement commerciale, en raison de l’exportation d’énergie par Bakou vers l’Europe, l’Arménie est considérée comme un relais essentiel dans la région, en particulier depuis que le nouveau gouvernement de la Géorgie semble abandonner ses désirs d’intégration dans l’UE. Ainsi l’UE a installé une mission civile à Yeghenadzor en Arménie depuis 2023. L’Union européenne a toujours soutenu le processus de paix entre les deux pays, et a salué les efforts faits par Yerevan et Bakou dans le cadre de la rencontre à la Maison blanche.
L’Union européenne encourage également le processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi qu’entre cette dernière et la Turquie. Certains pays membres de l’UE ont historiquement davantage soutenu l’Arménie, en particulier la France et la Grèce, tandis que d’autres ont en général montré leur proximité avec Bakou.
A présent, quel avenir pour la présence européenne dans cette région ? En Arménie, le gouvernement veut montrer son désir de rapprochement avec l’Europe, à travers un texte voté au parlement en mars 2025, « enclenchant la procédure d’adhésion à l’UE », toutefois sans caractère contraignant au niveau diplomatique. Aucune candidature d’adhésion n’a été officiellement entamée, contrairement à la Géorgie, l’Ukraine ou encore la Moldavie.
Si cette orientation pro-européenne du cabinet Pachinian est inédite pour un gouvernement arménien, elle reste sujette à des nuances. D’abord, Yerevan a aussi développé de nombreux liens avec l’Inde et la Chine, ainsi qu’avec certains pays du Golfe ; ensuite, sa politique intérieure joue un rôle très important dans cet aspect. En effet, en juin 2025, le pays organise des élections parlementaires, qui seront certainement déterminantes dans l’orientation de l’Arménie. Pachinian est à présent relativement impopulaire, notamment à cause de ses différends avec l’Église apostolique, mais est également exposé à des campagnes de désinformation de la part de la Russie, de même qu’en Moldavie à l’aune des élections de septembre 2025. S’il est réélu Premier ministre, il devra également soumettre au référendum la question des modifications dans la Constitution exigées par l’Azerbaïdjan pour un traité de paix, ce qui est loin d’être gagné. Toutes ces questions de politique intérieure rendent le gouvernement de Pachinian très exposé à des ingérences étrangères, et pourraient, à l’avenir, fragiliser les relations euro-arméniennes.
En conclusion, on pourrait dire que si l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont sur le point de conclure une paix durable, la situation reste très tendue. La prochaine échéance qui sera clé pour l’avenir de cette région est le scrutin des élections législatives arméniennes en 2026, qui seront vraisemblablement marquées par des tensions politiques très fortes, des tentatives d’ingérence inédites et une incertitude très forte dans la population. Le sort de la Géorgie voisine est tout aussi incertain, et semble démontrer que la stabilité régionale durable n’est pas pour 2025 ou 2026. Cependant, les efforts de normalisation de l’Arménie vis-à-vis de ses voisins occidental et oriental ne sont pas anodins. Le recul de l’influence russe ne l’est pas non plus. Moscou n’a sans doute pas renoncé à cette région, qu’elle considère comme hautement stratégique par sa géographie, son histoire et ses liens commerciaux. Pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, le Caucase gagne en importance stratégique, et contribue à sa consolidation dans le grand jeu géopolitique, quand sur le plan intérieur, le gouvernement doit faire face à des nouveaux défis.
Le diagnostic pour les Occidentaux est ambivalent : d’un côté, la paix est encouragée, y compris suite au plan de Trump, et la Russie semble avoir reculé ; d’un autre, cette situation a favorisé l’émergence de la Turquie comme nouvelle puissance régionale et de l’Azerbaïdjan comme partenaire stratégique, alors que ce dernier a fait montre d’un repli autoritaire inédit et a mis fin à toute issue multilatérale dans le conflit avec l’Arménie.
En l’état, l’Arménie semble être le nouvel allié privilégié de l’UE dans la région, au moment où la Géorgie est en pleine dérive autoritaire et retombe dans le « proche étranger » cher à Vladimir Poutine. Reste à savoir si cette tendance est durable, et si les promesses annoncées par Donald Trump à travers sa fameuse TRIPP seront suivies de réelles avancées diplomatiques.
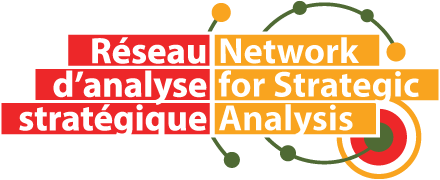




Les commentaires sont fermés.