Comment le Canada doit-il adapter sa politique de défense pour faire face aux réalités du nouvel environnement géopolitique ? Plusieurs experts ont proposé, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, que le Canada refonde sa politique étrangère, diversifie ses partenariats stratégiques et développe des capacités plus autonomes en matière de renseignement, de dissuasion et d’industrie de défense. Ces propositions peuvent sembler relever de l’hérésie tant elles sonnent une note discordante avec la complaisance historique du Canada en matière de défense. Pourtant, l’actualité géopolitique impose de doter le Canada de capacités de défense souveraines.
Or, les débats actuels n’ont rien de nouveau. Dans cette analyse, nous proposons que le Canada revienne à un concept méconnu de la politique de défense canadienne. Ce concept est celui de la « défense contre l’aide » (defence against help), élaboré par Nils Ørvik en 1973 dans le but de proposer les contours d’une politique de défense pour un État faisant face à une puissance majeure à ses frontières. Lorsque ce concept a été utilisé afin de donner un sens à la politique de défense canadienne, notamment dans le contexte de sa relation asymétrique avec les États-Unis, plusieurs ont soutenu que le Canada poursuivait cette stratégie dans ses relations avec les États-Unis. Néanmoins, ce n’est pas le cas. Plutôt que d’adopter une stratégie privilégiant le développement d’une force militaire capable de garantir le contrôle territorial canadien sans recourir à « l’aide américaine », les gouvernements fédéraux successifs ont privilégié une structure de force largement définie par une intégration étroite avec les États-Unis. En conséquence, ils ont ignoré la potentielle menace posée par les États-Unis contre l’intégrité territoriale canadienne.
Face à l’hostilité affichée par l’administration Trump à l’égard de la souveraineté canadienne (et danoise), à ses menaces d’abandonner la protection des alliés des États-Unis et à sa volonté de mener une guerre tarifaire tous azimuts, force est de constater que les États-Unis ne constituent plus un allié fiable et bienveillant. Comme l’a affirmé sans ambages le premier ministre Mark Carney : « L’ancienne relation que nous avions avec les États-Unis, basée sur l’intégration approfondie de nos économies et une coopération étroite en matière de sécurité et de défense, est terminée ». Dans cette optique, il a lancé un réexamen de l’acquisition de F-35 et affirmé son intérêt de participer au projet de « Dôme d’or » annoncé par le Président Trump, déclarant : « Nous sommes maintenant dans une position où nous collaborons si nécessaire [avec les États-Unis], mais nous n’allons pas nécessairement collaborer ». Cette stratégie passe par deux piliers : diversifier les partenaires du Canada en se rapprochant d’alliés plus fiables, tels que les Européens, ainsi que privilégier le développement d’une industrie militaire canadienne.
Pour mettre en œuvre la vision de M. Carney, il est nécessaire de revisiter l’idée originale d’Ørvik afin de dresser les contours d’une politique de défense contre l’aide américaine pour les décennies à venir. Pour ce faire, nous débuterons par rappeler comment le Canada s’est retrouvé dans la situation difficile dans laquelle il se retrouve aujourd’hui. Ensuite, nous présenterons les défis auxquels le Canada est confronté actuellement. Enfin, nous proposerons une série de mesures afin que le Canada surmonte ces défis en mettant en œuvre une stratégie de défense contre l’aide.
La renonciation de capacités souveraines de défense
Pour comprendre la situation actuelle du Canada en matière de défense, il faut remonter assez loin dans le temps. Il est important de reconnaître tout d’abord que les dépenses militaires canadiennes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n’ont connu une véritable ascension qu’entre 1950 et 1953 en proportion du PIB. Comme en attestent les données du SIPRI, le Canada est passé de 2,43% du PIB alloué aux dépenses militaires en 1950 à un sommet de 7,37% en 1953. Puis, avec la fin de la guerre de Corée, la proportion de dépenses militaires n’a cessé de diminuer jusqu’en 1974, atteignant à ce moment 1,78% du PIB. Ce déclin progressif a coïncidé avec l’introduction de programmes sociaux et reflétait le développement de la doctrine de destruction mutuelle assurée entre les États-Unis et l’Union soviétique.
Dans ce contexte, il n’était pas logique que le Canada consacre une part substantielle de ses dépenses aux forces armées. En effet, comme l’indiquait le Livre blanc sur la défense publié en 1970 par le gouvernement de Pierre Trudeau, « il n’y a pas de niveau évident pour les dépenses de défense au Canada ».[1] Quoique le constat peut paraître banal, ce fut une tournant dans la politique de défense canadienne depuis la guerre de Corée. Plutôt que de fixer un pourcentage du PIB à atteindre, le Livre blanc estimait que les dépenses militaires devaient tenir comptes des besoins des autres programmes gouvernementaux. D’une part, le gouvernement de Pierre Trudeau réduisit de moitié le contingent Canadiens déployés en Europe, passant de 10 000 à 5 000 militaires et de six à trois escadrons de CF-104. En effet, le Livre blanc inversait les priorités canadiennes, faisant passer la défense du territoire national devant les obligations envers l’Alliance atlantique.
D’autre part, même si le Livre blanc déclarait que l’objectif premier de la politique de défense canadienne était de « préserver la souveraineté et l’indépendance du pays », il acceptait la dépendance à l’égard de la protection américaine en matière de dissuasion nucléaire. Compte tenu de la menace posée par les missiles balistiques intercontinentaux soviétiques, le Livre blanc renonçait « à consacrer des sommes importantes à l’achat d’un nouvel équipement ou de nouvelles installations qui ne pourraient servir dans l’avenir qu’à la défense anti-bombardiers active ». Le Canada choisissait de se fier entièrement sur les capacités de détection, d’interception et de représailles anti-missiles des États-Unis pour assurer sa protection territoriale. Puisque l’accord du NORAD « ne spécifie aucun niveau de forces, équipement ou installations » requises, « la nature et l’étendue de la contribution du Canada restent matière à décision pour le gouvernement du Canada. »
Pourtant, le gouvernement de Pierre Trudeau lança dès 1975 un programme de réarmement des Forces canadiennes. Il augmenta de façon considérable le budget consacré à la défense entre 1976 et 1984, de façon à acquérir une nouvelle flotte d’avions de chasse, de navires, de véhicules blindés et de chars d’assaut. Si le premier objectif était de remplacer plusieurs capacités vieillissantes, un second consistait à maintenir un engagement militaire conséquent en Europe afin d’accroître les relations commerciales avec le Vieux Continent et de maintenir la réputation d’allié fiable de l’OTAN. La part du PIB consacrée à la défense passa ainsi de 1,78% en 1974 à 2,12% en 1984, soit une augmentation réelle de 49%.
Le gouvernement Mulroney entendait poursuivre sur cette voie dans les années 1980 en promettant une augmentation significative des dépenses de défense, mais cela ne s’est jamais concrétisé. La fin de la Guerre froide de même que les contraintes budgétaires canadiennes rendirent caduc les mesures imposantes annoncées en 1987. Malgré le programme de réarment amorcé par son prédécesseur, le gouvernement Mulroney estimait que les ressources consacrées à la défense étaient insuffisantes pour respecter les engagements militaires canadiens. Dressant un constat sévère, le Livre blanc de 1987 déclarait :
Les forces maritimes possèdent trop peu de bâtiments opérationnels, ont une capacité extrêmement limitée de mener des opérations dans l’Arctique et sont dépourvues de moyens de garantir que les voies navigables et les ports du Canada soient exempts de mines. […] Les forces terrestres, quant à elles, sont aux prises avec une très grave pénurie de matériel et ne comptent pas assez de soldats prêts au combat […]. Les forces aériennes, pour leur part, manquent nettement d’aéronefs pour transporter les troupes et le matériel en Europe en période de tension et pour assurer le soutien durant des hostilités ; elles manquent également d’appareils de patrouille maritime et d’armes modernes destinées aux CF-18 et n’ont pas de CF-18 de remplacement pour compenser les pertes subies en temps de paix.
Plutôt que de réduire les engagements du Canada en Europe, qui aurait eu pour effet de compromettre « la cohésion de l’Alliance », le Livre blanc préconisait un réinvestissement majeur dans les forces armées. Grâce à une croissance réelle de 2% des dépenses militaires par année (c’est-à-dire après inflation), environ 270 grands projets d’acquisition de matériel étaient prévus, dont les suivants : sous-marins à propulsion nucléaire (SSN), avions de patrouille à grand rayon d’action, chasseurs CF-18A et frégates additionnelles, système d’alerte du Nord, systèmes de sonars fixes dans l’Arctique, et systèmes de surveillance spatiale. À ceci s’ajoutaient la création de brigades territoriales supplémentaires, l’augmentation du nombre de militaires affectés en Europe, ainsi que la consolidation des engagements militaires en Europe, de sorte d’être en mesure de déployer une division (i.e., deux brigades) en Allemagne en cas de crise.
Il va sans dire que, aux yeux du gouvernement Mulroney, le Canada ne disposait pas des capacités nécessaires pour défendre le pays face à une possible agression extérieure. Par exemple, pour justifier l’acquisition de 10 à 12 SSN, le Livre blanc affirmait : « Le SSN est le seul type de bâtiment capable d’assurer surveillance et contrôle dans l’océan Arctique et dans les eaux canadiennes prises par les glaces… Le SSN est considéré comme l’achat le plus avantageux pour la Marine, parce qu’il s’agit d’une plate-forme anti-sous-marine pouvant mener des opérations dans les trois océans qui nous intéressent. » Dès novembre 1989, toutefois, le premier ministre Mulroney déclarait lors d’une visite en URSS que la politique de défense de 1987 était dépassée. Le Canada renonçait alors à assurer une présence anti-sous-marine effective dans les trois océans qui le bordent, soit un espace océanique de près de six millions de km2.
Afin d’équilibrer le budget fédéral le gouvernement Chrétien entama d’importantes coupures budgétaires dans les années 1990. Le budget de défense fut réduit de 30% entre 1994 et 1998 et le renouvellement des équipements majeurs fut indéfiniment retardé. Les dépenses militaires passèrent de 2,11% du PIB en 1986 à 1,11 % en 2005 et le gouvernement réduisit la taille de ses forces d’un tiers. Néanmoins, les Forces armées canadiennes furent déployées dans presque toutes les opérations alliées, du Golfe persique à l’Afghanistan, en passant par la Bosnie et le Kosovo.
La combinaison d’un rythme opérationnel élevé et de faibles dépenses a mené le Canada, et de nombreux autres alliés européens, à optimiser sa planification et ses dépenses militaires. Cette optimisation a consisté à s’appuyer de plus en plus sur les États-Unis pour financer la recherche et le développement de nouvelles capacités militaires, ce qui permit au Canada d’en bénéficier pour un coût relativement faible. En prime, les Forces armées canadiennes purent accroître leur interopérabilité avec leurs homologues américains et, surtout, purent participer à des opérations aux côtés des États-Unis à un coût minime.
Dans le cadre du NORAD, le Canada a en outre approfondi son étroite collaboration avec les États-Unis pour défendre le continent nord-américain, tout en retardant les investissements supplémentaires, tels que de nouveaux avions chasse et de ravitaillement, des systèmes de radars et de défense aérienne adaptés aux technologies avancées, des systèmes de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), ou encore des sous-marins capables d’opérer dans les eaux glacées. Cette solution était jugée optimale car le Canada pouvait maintenir une force polyvalente dotée de capacités de combat dans les trois armées, tout en consacrant à la défense un peu plus de 1% de son PIB, compte tenu de la collaboration étroite avec les États-Unis.
Le débat entourant le refus du gouvernement canadien de participer au programme de défense antimissile des États-Unis illustra également cette dynamique. Comme le souligna Philippe Lagassé, certains affirmèrent que de permettre aux États-Unis de défendre le continent contre les missiles balistiques sans une contribution canadienne porterait atteinte à la souveraineté du Canada. Contrairement au concept de défense contre l’aide d’Ørvik, cependant, peu d’analystes ont suggéré que le Canada construise son propre système de défense antimissile, ou encore se dote de ses propres capacités d’interception. Les arguments contre la décision du gouvernement canadien ne visaient pas développer des capacités de défense souveraines contre l’aide américaine, mais plutôt à profiter de la protection offerte par le système américain et des faibles coûts d’un soutien politique canadien, tout en conservant un « siège à la table » afin d’espérer participer à la prise de décision sur l’interception de missiles. L’intérêt déclaré du gouvernement Carney envers une participation du Canada dans le « dôme d’or » du président Trump semble signaler que le Canada reconnait que la protection américaine ne sera plus gratuite.
La poursuite de l’alignement au cours du premier mandat Trump
Le gouvernement de Justin Trudeau amorça en 2017 un vaste programme de recapitalisation des Forces armées canadiennes afin de remplacer les équipements vieillissants ou désuets, puis, en 2022, afin de moderniser les installations du NORAD. Les dépenses en capital prévues pour la défense jusqu’en 2037 étaient estimés à 215 milliards de dollars. En 2024, le gouvernement Trudeau annonça un autre programme de recapitalisation, prévoyant faire passer le budget annuel de défense de 41 milliards de dollars en 2024 à 57,8 milliards de dollars en 2029, soit une augmentation de 41%. Aussi importante soit-elle, cette augmentation ne devait faire passer la proportion des dépenses militaires de 1,35% qu’à 1,58% du PIB, soit loin de l’engagement du Canada auprès de l’OTAN de consacrer 2% du PIB en défense en 2024.
La hausse notable mais modeste des dépenses militaires prévue par le gouvernement Trudeau s’inscrivait dans la même approche d’alignement sur les États-Unis que ses prédécesseurs, prévoyant surtout l’acquisition de capacités américaines. Bien sûr, le Canada a acheté auprès d’Airbus 16 avions CC-295 Kingsfisher pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que neuf avions CC-330 Husky pour le ravitaillement en vol et le transport de personnalités. Nous pouvons également penser à de nombreux autres exemples de capacités européennes acquises pour les FAC, mais lorsqu’il s’agissait d’investissements majeurs en matière de capacité de combat, le gouvernement canadien demeurait fermement décidé de se doter de technologie américaine. Par exemple, l’on peut citer l’acquisition de 88 chasseurs F-35A auprès de Lockheed Martin, de trois aéronefs de renseignement, reconnaissance et surveillance Beechcraft King Air 350ER auprès de Textron, de 16 avions de patrouille maritime P-8A Poseidon auprès de Boeing, du système de combat Aegis de Lockheed Martin pour les 15 futurs navires de guerre, ou encore du système de communication par satellite à large bande (WGS-9) de Boeing.
En privilégiant l’acquisition de capacités militaires produites à l’étranger, le Canada se privait de fait du développement de ces systèmes par sa propre industrie nationale. L’acquisition d’une flotte de P-8A, d’une valeur de 10,4 milliards de dollars en 2023, suscita d’ailleurs la controverse, car le gouvernement canadien préféra un fournisseur américain (Boeing) plutôt que Bombardier, une entreprise canadienne, et les capacités de surveillance maritime avancées développées par General Dynamics Mission System – Canada pour le remplacement de la flotte CP-140 Aurora. L’option proposée par Bombardier semblait trop incertaine en termes de calendrier et de disponibilité opérationnelle pour Ottawa, malgré les assurances de Bombardier que l’avion serait prêt au début des années 2030.
Cette décision est l’exemple par excellence de la stratégie d’approvisionnement militaire canadienne, qui exige des capacités existantes et éprouvées au moment de la décision d’acquisition, acquiesce aux préférences des militaires canadiens pour des appareils interchangeables avec ceux utilisés par les États-Unis, et renonce du même coup à développer une industrie canadienne dans un secteur aussi stratégique et névralgique que constitue l’industrie aérospatiale. Car si le Canada avait choisi de privilégier le développement de capacités souveraines, il aurait investi dans l’industrie canadienne plusieurs années avant le moment de remplacer la flotte d’Aurora, de manière à ce qu’il existe une solution éprouvée et fabriquée au Canada au moment venu.
Cette renonciation au développement de capacités souveraines pouvait représenter un choix optimal à l’époque où le programme de recapitalisation des FAC s’appuyait sur une projection des dépenses militaires sous le seuil de 2% du PIB et avec la confiance envers une intégration étroite avec les forces armées américaines. Telle était la situation au début de la seconde investiture de Trump. Depuis son arrivée au pouvoir, force est toutefois de constater que cette stratégie met à risque le Canada.
Le défi de Trump 2.0
Le président américain Donald Trump a remis en question la souveraineté du Canada, lancé une guerre commerciale contre ses alliés et semé le doute quant à l’engagement des États-Unis envers l’Article 5 de l’OTAN. Ces attaques sont répétées, ciblent plusieurs alliés, s’inscrivent dans une vision promulguée dès son premier mandat et, contrairement à ce dernier, sont désormais mises en œuvre de manière agressive. Par exemple, les services de renseignement américain mènent des opérations d’espionnage au Groenland.
En ce qui concerne le Canada, deux interprétations s’opposent. Certains estiment que la rhétorique du président Trump fait partie d’une stratégie visant à inclure le Canada dans une forteresse nord-américaine, alors que d’autres jugent qu’il faut prendre M. Trump au mot, à savoir que les États-Unis n’ont pas besoin de ce que le Canada a à offrir et que la défense du Canada est trop onéreuse pour les États-Unis. Peu importe laquelle de ces visions est la plus représentative de la pensée du président Trump, il n’en reste pas moins que cette administration remet en cause les fondements de la politique et de la planification de la défense canadienne. Que le Canada soit lâché par Washington et forcé d’assurer sa propre sécurité, ou qu’il soit confronté à la volonté américaine de combler unilatéralement les défaillances de la défense territoriale du Canada, tous deux scénarios signifieraient l’arrêt de mort de la politique de défense conjointe et amicale du continent nord-américain qui prévaut depuis la fin des années 1930.
L’une des possibilités les plus inquiétantes est que M. Trump ou l’un de ses successeurs concluent que le Canada est tellement important pour la sécurité américaine qu’il doit être défendu par les États-Unis aux conditions imposées par Washington. L’administration appliquerait alors au Canada une rhétorique similaire à celle appliquée au Groenland. Ce scénario est peut-être improbable, mais beaucoup de choses que l’administration Trump a fait ces derniers mois semblaient initialement improbables, comme le fait de s’aligner sur la Russie de Vladimir Poutine, de miner la communauté du renseignement américain, et de saper les principes fondamentaux de la Constitution américaine.
Plusieurs au sein de la communauté canadienne de sécurité et de défense estiment que Trump n’est qu’un problème temporaire et qu’Ottawa doit en conséquence maintenir une stratégie consistant à se baisser la tête et se protéger (duck and cover). L’ancien ministre de la Défense, Bill Blair, minimisait ainsi la menace posée par les États-Unis à la mi-février 2025, et le ministère de la Défense temporise la nécessité de reconsidérer l’acquisition de chasseurs F-35. Cette attitude est compréhensible étant donné l’étroitesse des liens qui unissent la communauté de la défense canado-américaine.
Toutefois, le gouvernement du Canada n’a pas le luxe de supposer que la stratégie du sablier fonctionnera face à Trump. Il serait politiquement irresponsable de jouer la montre face Trump et d’éviter de se prémunir contre les scénarios d’un abandon ou d’une coercition américaine. Il est fort possible que les fondements populistes, nationalistes, protectionnistes et autoritaires de la politique étrangère de Donald Trump s’inscriront dans la durée.
Les actions et les paroles de l’administration Trump représentent une menace claire pour le Canada, même si elles n’aboutissent pas à une guerre contre le Canada. Si le scénario d’une invasion à grande échelle du Canada par les États-Unis n’est pas crédible, un autre beaucoup plus probable est celui d’une incursion américaine afin de sécuriser l’accès à des ressources naturelles, des infrastructures critiques, ou des voies maritimes canadiennes, incluant dans le Grand Nord. Ce scénario pourrait voir les États-Unis déployer des forces militaires sur le territoire canadien sous prétexte de « l’aider » à résoudre un incident ou un problème de sécurité, mais ne jamais quitter ensuite. Cela se ferait sous le couvert d’une intervention amicale, d’une offre d’assistance face à une menace réelle ou fabriquée. Le président Trump a déjà offert de déployer des forces américaines au Mexique afin d’aider le pays à combattre les cartels de la drogue et son conseiller Peter Navarro a affirmé que les cartels sont en expansion au Canada. Une « offre » similaire pourrait donc être faite au Canada. Si cette offre venait, ou devrions-nous plutôt dire si cette offre était imposée, elle le serait à la façon de Don Corleone – sans que l’on puisse la refuser. Le Canada se verrait demander d’accepter en toute amitié une aide inamicale et ne pourrait compter sur ses alliés européens pour lui prêter main forte.
Se défendre contre l’aide non sollicitée
Que doit faire le Canada pour se préparer à une telle éventualité ? Lorsque Ørvik proposa le principe de défense contre l’aide au Canada, il l’entendait au sens finlandais du terme. En effet, la Finlande a veillé à ne pas avoir besoin de l’« aide » soviétique pour maintenir son indépendance et sa souveraineté au cours de la Guerre froide. La défense contre l’aide représentait la meilleure stratégie qu’un petit État voisin d’une grande puissance potentiellement hostile pouvait adopter. Selon Ørvik, trois principes sont essentiels afin de réussir une stratégie de défense contre l’aide : 1) plus grande est l’importance stratégique du territoire d’un petit État pour son puissant voisin, plus il devra investir dans ses capacités militaires afin de dissuader une aide non sollicitée ; 2) la volonté et la capacité du petit État à empêcher l’accès et l’utilisation de son territoire doit être perçue comme crédible par son voisin plus puissant; et 3) le petit État doit pratiquer une politique de non-alignement à l’égard des États rivaux de son puissant voisin.
Compte tenu de l’importance croissante du territoire canadien pour les États-Unis en raison de sa position géographique et de ses richesses naturelles, l’adoption d’une stratégie de défense contre l’aide par Ottawa exigerait, outre le non-alignement sur la Chine ou la Russie que pratique déjà le Canada, le développement d’une capacité militaire crédible et suffisante pour faire face à tout incident, problème ou menace sur son sol, dans ses airs, ou dans ses eaux. Une telle politique de défense, fondée sur l’autonomie, la résilience et la diversification des partenaires, permettrait d’empêcher la grande puissance voisine d’utiliser un prétexte pour déployer ses forces sur le territoire de son plus petit voisin. De cette façon, le Canada pourrait dire en toute crédibilité aux États-Unis : « nous n’avons pas besoin de votre aide ».
Il faudrait plus d’une décennie ou deux pour que le Canada puisse de manière réaliste mettre en pratique une stratégie de défense contre l’aide tant Ottawa a systématiquement sous-investi en défense et renoncé au développement de capacités souveraines. Cela dit, la tâche n’est pas impossible. À court terme, le Canada ne peut se priver des capacités américaines existantes. Les abandonner rendrait le Canada encore plus vulnérable et nuirait à son industrie militaire profondément intégrée à celle des États-Unis. Mais en même temps, le Canada doit dès à présent et avec un sentiment d’urgence développer ses capacités souveraines dans des secteurs critiques et nouer des partenariats avec des alliés fiables afin de réduire la dépendance chronique sur les États-Unis. Cela permettrait de jeter les bases d’une politique crédible de défense contre l’aide à l’horizon de 2040.
À quoi cela ressemblerait-il dans la pratique ? Cela signifierait une force capable de défendre son propre espace aérien et maritime, ainsi que de faire face à un accident majeur et à des catastrophes naturelles sur l’ensemble du territoire national, incluant en Arctique. Cela signifierait en outre une force disposant de systèmes de communication, de renseignement et de surveillance indépendants, incluant par satellites, capteurs sous-marins et radars. Enfin, la défense contre l’aide signifierait prioriser la défense du territoire canadien par rapport aux missions expéditionnaires et privilégier le développement de capacités souveraines plutôt que l’acquisition d’équipement américain.
L’exemple le plus probant réside dans l’acquisition de F-35, remise en question par le premier ministre Carney. Avec raison, certains estiment que le Canada devrait se tourner vers une alternative européenne, comme le Gripen ou le Rafale, de manière à réduire la dépendance du Canada à l’égard du soutien opérationnel et technologique des États-Unis. Toutefois, les critiques ont également raison de souligner que le Canada a tellement besoin de nouveaux avions de chasse qu’il ne peut se permettre un retard supplémentaire pour remplacer ses CF-18, et que les F-35 offrent des capacités furtives inégalées par leurs concurrents européens. Dans une logique de défense contre l’aide, le Canada devrait dès lors opter pour une flotte mixte, tel que le préconise l’ancien commandant de l’Avion royale canadienne, Yvan Blondin. Aux 88 F-35A prévus entre 2026 et 2034 devrait être ajoutée une flotte de 50 chasseurs européens, de manière à porter la flotte canadienne à 138 appareils, soit autant que la quantité de F-18 acquise en 1982. Le choix du second appareil devrait être conditionné à ses capacités de défense du territoire canadien tout autant qu’à la volonté du fournisseur de développer les capacités de production au Canada, de manière à établir les bases d’une capacité industrielle nationale. C’est d’ailleurs ce à quoi s’étaient engagés Dassault et Saab. À ceci devrait s’ajouter la participation du Canada dans le développement d’un chasseur de 6e génération, soit du côté du Global Combat Air Programme (GCAP) développé par le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie, soit auprès de la France et de l’Allemagne et leur Système de Combat Aérien du Futur (SCAF), de manière à développer en tandem les capacités de drones qui feront partie intégrant de la future génération d’avions de chasse.
Il ne fait aucun doute qu’une flotte mixte et le développement d’une industrie aérospatiale nationale serait coûteuse et exigeante en termes de personnel. Le modèle d’une force simple et interchangeable avec les États-Unis est beaucoup moins onéreux. C’est précisément pourquoi il était optimal pour le Canada de privilégier ce modèle jusqu’à présent. Certains pourraient arguer que tant que la coercition américaine ne se matérialise pas, il n’est pas nécessaire de s’en prémunir. Le problème avec cette logique, bien entendu, est que si cette coercition se matérialiserait, il serait trop tard pour l’en empêcher. Si des pays tels que le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, la Grèce et la Pologne ont fait le choix de maintenir une flotte mixte d’avions de chasse, le Canada pourrait s’inspirer de leur modèle de développement du personnel et des infrastructures afférentes.
D’autres secteurs stratégiques devraient être priorisés par la future stratégie industrielle de défense du Canada, qui est attendue au cours de l’été 2025. Parmi les capacités souveraines à développer, citons les avions d’alerte précoce aéroportés (AEW&C), une vaste de gamme de drones (navires de surface sans pilote, véhicules sous-marins sans pilote, véhicules aériens sans pilote de basse, moyenne et haute altitude), des capteurs acoustiques sous-marins, ou encore des systèmes de missiles air-sol et antinavires. Dans d’autres domaines, tels que les sous-marins, un partenariat stratégique avec la Suède (Saab), la France (Naval Group), l’Allemagne (TKMS), l’Espagne (Navantia) ou la Corée du Sud (Hanwha) sera nécessaire. Le choix du fournisseur devrait être fondé non seulement sur les capacités techniques des sous-marins proposés, mais également sur la volonté de transférer au Canada la propriété intellectuelle et l’infrastructure nécessaires au maintien en service et développement technologique des capacités associées aux sous-marins.
Dans cette perspective, le premier ministre Carney a raison d’envisager participer à l’ambitieux programme « dôme d’or » de défense antimissile du président Trump. Dans les mots du premier ministre : « Oui, c’est une bonne idée pour le Canada d’avoir une protection contre les missiles, parce qu’à partir de maintenant, il y a de vraies menaces contre le Canada venant de Russie, de Corée du Nord et peut-être de Chine, d’ici un certain temps ». Il faut toutefois rappeler que le Canada participe déjà au système de détection et d’alerte du programme de défense antimissile nord-américain, et qu’il collabore avec les États-Unis au développement des radars, satellites et autres infrastructures associées à la modernisation du NORAD. Toutefois, dans la logique de la défense contre l’aide, la participation du Canada à la défense antimissile devrait s’appuyer sur le développement de capacités canadiennes de surveillance, détection et d’interception, dans les limites de ce qui semble utile pour garantir la souveraineté du Canada. Ainsi, il serait sage d’investir dans les systèmes de radars, de satellites et de missiles de longue portée, mais sans doute moins dans les capacités d’interception basées dans l’espace.
La mise en œuvre d’une politique de défense contre l’aide serait nécessairement plus coûteuse que la politique actuelle d’intégration au sein des forces armées américaines. Mais le contexte politique est favorable à des investissements majeurs en défense et les Canadiens appuient en majorité une hausse des dépenses militaires. Le plan du premier ministre Carney prévoit ajouter plus de 30 milliards de dollars aux prévisions budgétaires de la politique Notre Nord, Fort et Libre (NNFL), annoncé en avril 2024. Ceci ferait passer le budget annuel de la défense de 41 milliards de dollars en 2024-25 à 68,4 milliards de dollars en 2028-29, soit une hausse de 67%. Si les alliés de l’OTAN s’entendent comme prévu sur un nouveau seuil de 3,5% du PIB en défense, cela signifierait, selon les estimations du Directeur parlementaire du budget, un budget annuel de 128 milliards de dollars en 2030, soit une hausse de 212% par rapport au budget de 2024-25. De telles hausses budgétaires rendraient donc non seulement possible mais surtout impérative la mise en place d’une stratégie de défense contre l’aide, puisque dépenser de telles sommes dans l’industrie américaine plutôt que canadienne ferait scandale. En effet, si le premier ministre Carney a raison d’affirmer que 75% des acquisitions militaires actuelles du Canada vont à l’achat d’équipement américain, maintenir un tel ratio serait économiquement indécent et politiquement risqué. Dans un contexte d’investissements majeurs en défense, la stratégie de défense contre l’aide constitue la meilleure voie à suivre.
Conclusion
L’histoire de la politique de défense canadienne témoigne d’un choix constant de dépendance à l’égard des États-Unis, fondé sur une logique de rationalisation budgétaire et d’interopérabilité stratégique. Toutefois, le retour de Donald Trump au pouvoir, et plus largement l’instabilité politique croissante chez notre voisin, impose une révision profonde de cette posture. L’actualisation du concept de la « défense contre l’aide » permettrait au Canada de recouvrir sa souveraineté militaire, en renforçant ses capacités nationales, en diversifiant ses partenariats industriels et stratégiques, et en préparant une réponse crédible à toute tentative d’ingérence « amicale » de Washington.
Ce changement de cap exige non seulement des investissements massifs mais aussi un engagement politique soutenu pour développer une industrie de défense autonome et résiliente. À l’aube de choix budgétaires cruciaux et de tensions géopolitiques durables, le Canada a l’occasion historique de transformer sa dépendance en puissance souveraine. Le succès de cette transformation dépendra de notre volonté collective d’assumer les coûts de notre indépendance et de bâtir, dès aujourd’hui, les bases d’une sécurité nationale conçue par et pour les Canadiens.
La fatigue constituera un défi majeur à surmonter. De nombreux Canadiens guetteront le moindre signe de recul de Trump pour affirmer que nous devons revenir à nos anciennes habitudes. Il est vrai que les anciennes méthodes sont faciles, confortables et peu coûteuses. La perspective de retourner au statu quo ante et de ne plus jamais avoir à se préoccuper de Trump est très attrayante et pourrait finalement l’emporter. Mais seule une stratégie de défense contre l’aide permettra au Canada de protéger sa souveraineté, de tirer profit de son économique, et de se rendre moins vulnérable aux soubresauts politiques américains.
[1] Traduction libre de la version anglaise : « There is no obvious level for defence expenditures in Canada. » La version officielle en français n’est pas aussi claire : « Le Canada ne possède pas de barème afin de déterminer l’importance des dépenses de la défense. »
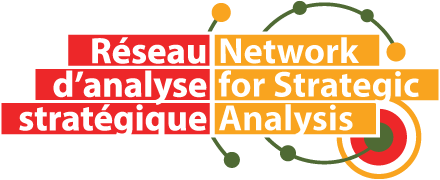





Les commentaires sont fermés.