Alors que le monde devient « de plus en plus dangereux et divisé », le premier ministre Mark Carney a déclaré son intention de relancer les Forces armées canadiennes (FAC) grâce à un programme de dépenses majeur visant à combler les lacunes importantes en matière de capacités tout en réduisant la dépendance globale envers les États-Unis. M. Carney s’est même engagé à porter les dépenses de défense à 2 % du produit intérieur brut du Canada d’ici mars 2026. Le catalyseur de ce réarmement est évident. Bien qu’il se soit engagé à atteindre l’objectif de 2 % lors du sommet de l’OTAN au Pays de Galles en 2014, le Canada est à la traîne par rapport à la plupart de ses alliés, malgré l’agressivité de la Russie envers ses voisins et les défis sécuritaires liés à la montée en puissance de la Chine. Plus récemment, les propos annexionnistes du président des États-Unis, aussi graves soient-ils, ont également suscité l’inquiétude au Canada quant à son incapacité à garantir sa propre souveraineté politique et son intégrité territoriale.
L’un des éléments clés de cette initiative visant à reconstruire les FAC consiste à impliquer le Canada dans le programme ReArm Europe, tel qu’envisagé dans la déclaration commune sur la sécurité et la défense publiée par le Canada et l’Union européenne le 23 juin 2025. Créé en mars dernier par la Commission européenne, ReArm Europe est un programme de prêts qui débloque jusqu’à 800 milliards d’euros (1 250 milliards de dollars) sur cinq ans pour les États membres de l’UE afin qu’ils les consacrent à la défense. Il est ouvert aux États non membres de l’UE comme le Royaume-Uni et le Canada. À première vue, l’adhésion à ReArm Europe permettrait à Ottawa de faire progresser trois objectifs connexes. Premièrement, l’accès à ces fonds permettrait en théorie au Canada d’augmenter ses dépenses de défense. Deuxièmement, ces fonds supplémentaires pourraient contribuer à stimuler l’industrie de la défense canadienne. Troisièmement, enfin, la participation à ce programme de prêt concrétiserait l’objectif déclaré de M. Carney de diversifier les partenariats du Canada en matière de sécurité afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Mais qu’est-ce que ReArm Europe exactement, et que peut-on raisonnablement attendre de la participation du Canada à ce programme ? Malgré les sommes colossales en jeu, peu d’articles ont été publiés au Canada sur le programme de prêt de l’UE. Le but de cet essai est d’évaluer ReArm Europe en expliquant ce qu’il est, quels problèmes il vise à résoudre dans l’industrie européenne de la défense et, plus important encore, quels problèmes il ne résoudra pas. Nous montrerons ensuite comment le Canada pourrait participer de manière fructueuse à ReArm Europe.
En résumé, nous soutenons que le Canada devrait modérer ses attentes quant à ce que cette initiative stratégique de défense peut offrir. Bien qu’elle puisse débloquer des fonds pour le Canada, l’absence de changements structurels significatifs sur le marché européen de la défense et les besoins spécifiques du Canada limiteront ce que ReArm Europe peut faire pour le Canada alors qu’il tente de relancer ses propres forces armées. L’objectif déclaré de ReArm Europe est d’encourager une plus grande collaboration en matière de dépenses, mais l’effet pratique sera probablement de soutenir les industries nationales européennes.
Qu’est-ce que ReArm Europe ?
La première chose à noter est que « ReArm Europe » est un terme inexact. Bien que le roi Charles III y ait fait explicitement référence dans son discours du trône en mai, l’utilisation du nom « ReArm Europe » est quelque peu anachronique. Les Premiers ministres espagnol et italien ayant estimé que cette expression était trop provocatrice, l’initiative de défense stratégique a été rebaptisée « Readiness 2030 », 2030 étant la date suggérée par les services de renseignement européens comme étant celle à laquelle la Russie pourrait avoir la capacité d’attaquer les États membres de l’UE/OTAN. Le fait que les dirigeants européens aient du mal à appeler un chat un chat est révélateur de certains des défis décrits ci-dessous.
Indépendamment de la politique qui sous-tend son nom, la Commission européenne a dévoilé ReArm Europe/Readiness 2030 en mars 2025 afin qu’il serve d’initiative de défense stratégique visant à mobiliser l’industrie et les capitaux pour la sécurité commune. Conçue comme un complément aux efforts de modernisation de la défense au niveau national, elle vise à réaliser des économies d’échelle dans le secteur et à garantir l’approvisionnement militaire, principalement par l’harmonisation réglementaire, le rapprochement des marchés financiers et la coordination des achats entre les États participants.
Selon les estimations récentes de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, ReArm Europe vise à mobiliser 800 milliards d’euros sur cinq ans. Cela dit, ce chiffre est légèrement trompeur, car ReArm Europe n’est pas financé par une augmentation des contributions au niveau de l’UE, mais principalement par des dépenses déficitaires sanctionnées par l’UE. Bien que son règlement constitutif « Security and Action For Europe » (SAFE) prévoie des prêts d’achat communs pour un montant total de 150 milliards d’euros, ReArm Europe verra les 650 milliards d’euros restants levés en exemptant les dépenses militaires des exigences budgétaires prévues par le pacte de stabilité et de croissance de l’UE. D’autres avantages pour le secteur seront obtenus grâce à la déréglementation, les projets de défense pouvant bénéficier d’investissements utilisant l’aide économique des États membres et l’assistance de la Banque européenne d’investissement, qui a récemment triplé son portefeuille de défense. La durée des prêts accordés sous la bannière de ReArm Europe peut aller jusqu’à 45 ans, ce qui en fait une dette multigénérationnelle afin d’atténuer les compromis entre les dépenses militaires et les dépenses civiles auxquels les pays européens sont déjà confrontés.
À son tour, comment le Canada s’intégrerait-il dans ce système ? Étant donné qu’il n’est pas membre de l’UE, il n’est pas tenu de se conformer à l’assouplissement de sa réglementation fiscale. Selon le règlement SAFE, les tiers peuvent bénéficier d’achats conjoints s’ils signent un partenariat de sécurité et de défense (SDP) avec le bloc, une mesure confirmée par les décideurs politiques canadiens. Compte tenu du débat intense qui entoure la dépendance du Canada à l’égard des États-Unis pour les produits liés à la défense, de nombreux décideurs politiques, dont le Premier ministre, ont présenté ce mécanisme comme une occasion de réduire cette dépendance et de diversifier les liens du Canada en matière de sécurité. Néanmoins, plusieurs éléments du plan laissent de nombreuses questions importantes sans réponse, et l’intégration de pays extérieurs à l’Union européenne offre moins d’avantages, en particulier en dehors de l’environnement de sécurité continental, que ce ne serait le cas pour les États membres de l’UE.
Contraintes structurelles dans le secteur européen de la défense
L’objectif général de ReArm Europe est de faciliter les dépenses de défense sur le continent européen. Après tout, la combinaison des dividendes de la paix après la guerre froide, l’accent mis sur les opérations expéditionnaires hors zone et l’austérité financière ont épuisé de nombreux établissements de défense européens au cours des trois décennies qui ont précédé l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Le fait que les États-Unis aient fourni des garanties de sécurité solides et disposent de fournisseurs de défense compétitifs qui vendent des capacités militaires de haute qualité n’a pas non plus aidé l’industrie européenne de la défense. Peu d’entreprises s’étant imposées comme leaders sur le marché européen, les fournisseurs traditionnels se sont retranchés sur les marchés publics nationaux. Avec la baisse de la demande et la réduction des budgets militaires, le secteur européen a connu moins d’innovations disruptives que l’industrie américaine de la défense, malgré la préférence de cette dernière pour les entreprises traditionnelles.
Les gouvernements continuaient de voir la valeur de leurs industries de défense nationales, mais les marchés publics avaient tendance à suivre les objectifs industriels dans un esprit de juste retour, ce qui freinait les projets d’approvisionnement communs et créait des inefficacités pour de nombreux produits militaires, mais certainement pas tous. Il en résulte une duplication de certains systèmes, comme les véhicules blindés de combat et les systèmes de commandement et de contrôle, tandis que d’autres besoins, comme la production de munitions, ont été négligés par beaucoup. Trop de pays ont eu tendance à considérer la défense comme une source d’emploi plutôt que comme un moyen de se préparer stratégiquement. Bien qu’en hausse par rapport à 11 % en 2010, les dépenses consacrées à l’acquisition collaborative d’équipements de défense en Europe restent inférieures à l’objectif de 35 % fixé par la Commission européenne, s’élevant à 18 % des dépenses totales de défense en 2020.
Les établissements de défense européens ne sont pas dimensionnés pour se préparer à une guerre de haute intensité, malgré leur potentiel de puissance latent global. Plus précisément, ils ont eu du mal à honorer les commandes existantes. Les goulets d’étranglement dans l’approvisionnement ont été caractéristiques de l’industrie européenne de la défense. Un rapport de 2011 de la commission des comptes publics de la Chambre des communes (Royaume-Uni) a souligné que le Typhoon, un avion multirôle acheté par la Grande-Bretagne avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, constituait un exemple édifiant en matière de collaboration européenne dans le domaine de la défense, compte tenu des « retards considérables et de l’augmentation vertigineuse des coûts » qui ont accompagné le projet. La Royal Air Force a ensuite été contrainte de cannibaliser ses avions pour en récupérer les pièces détachées. L’Australie a dû mettre hors service sa flotte d’hélicoptères de transport tactique NH90 de NHIndustries, fabriqués en Europe, quinze ans avant la date prévue, en raison de leurs performances médiocres et du « manque de pièces de rechange ». Bien que l’aérospatiale soit l’un des secteurs les plus européanisés de l’industrie européenne de la défense, l’acquisition par le Canada de l’Airbus C295 accuse déjà six ans de retard.
Ces frustrations n’ont fait que s’accentuer après que l’Ukraine s’est montrée capable de déjouer les efforts de la Russie pour renverser son régime dès les premiers jours de son invasion à grande échelle. Avant même que Donald Trump ne reprenne ses fonctions présidentielles, la relance de la base industrielle de défense européenne était devenue une priorité. Mettant de côté ses instincts pro-marché antérieurs, le bloc s’est orienté vers une politique industrielle visant à sécuriser son approvisionnement énergétique et à reconstruire ses capacités de production. L’enthousiasme pour les dépenses financées par l’endettement de ReArm Europe rend ce point encore plus saillant lorsqu’on considère l’aide militaire à l’Ukraine, qui est en partie considérée comme une dépense préventive pour un futur conflit impliquant l’UE. Et en effet, l’une des raisons pour lesquelles certains membres de l’OTAN ont accordé une aide militaire plus importante à l’Ukraine, au moins jusqu’en 2022, était le montant qu’ils avaient dépensé pour leur propre préparation stratégique au cours des années qui ont précédé l’attaque à grande échelle de la Russie. Toutefois, comme le montre la controverse sur le nom de ReArm Europe, les États membres de l’UE restent divisés sur le soutien à l’Ukraine et, par conséquent, sur la préparation à un conflit stratégique avec la Russie.
Ainsi, même si ReArm Europe tente de remédier à la sous-capacité industrielle en consolidant et en coordonnant la production de systèmes de défense clés, l’essentiel de ReArm Europe consiste à injecter de l’argent dans les problèmes inhérents à l’industrie européenne de la défense. Les chaînes d’approvisionnement resteront complexes et les différences nationales compliqueront également les plans d’approvisionnement communs. Les inefficacités persisteront en l’absence d’une vision commune plus solide de la défense, que divers commentateurs ont déclarée essentielle pour que l’industrie européenne de la défense puisse réaliser des progrès significatifs.
Pas de grandes attentes
En raison de la structure de l’initiative, l’adhésion à ReArm Europe par l’intermédiaire de la SAFE en tant qu’État non membre de l’UE comporte plusieurs obstacles structurels pour le Canada. Malheureusement, même si l’initiative mérite d’être poursuivie, les dirigeants canadiens ne devraient pas surestimer les avantages qu’ils tireront de ReArm Europe.
Dans le cadre d’un effort plus large visant à accroître l’efficacité et la productivité au sein de l’Union européenne à la suite du rapport Draghi de 2024, la Commission européenne a créé l’Union de l’épargne et de l’investissement (UEI). Cette initiative renforcera ReArm Europe, car l’intégration des marchés des capitaux et la facilitation des transactions bancaires transfrontalières permettent de relier l’épargne européenne aux besoins d’investissement. Le Canada ne fait pas partie de l’UES et celle-ci aura donc peu d’incidence sur les marchés financiers canadiens. Il est essentiel de noter que le fait d’orienter l’épargne européenne vers des investissements au Canada va à l’encontre de l’objectif déclaré de renforcer le secteur de la défense et la compétitivité mondiale de l’Europe. En effet, l’objectif premier de l’UES est de réduire la fragmentation du secteur bancaire européen et d’encourager la croissance économique au sein de l’Union européenne.
Bien sûr, les entrepreneurs canadiens du secteur de la défense pourraient bénéficier indirectement du fait que leurs homologues européens disposent de plus de capitaux et rencontrent moins d’obstacles à l’investissement qu’auparavant. Cependant, on peut faire valoir que le Canada n’a pas besoin des fonds de l’UE pour mener à bien ses propres dépenses déficitaires. Le Canada n’a qu’à dépenser son propre argent. Il est essentiel de noter que cette initiative stratégique donnera la priorité aux projets qui contribuent à la défense continentale. Après tout, elle s’appelle « Réarmer l’Europe », et non « Réarmer l’Amérique du Nord » ou même « Réarmer l’Atlantique Nord ». Cette priorité se traduit par le statut accéléré (c’est-à-dire sans SDP requis) accordé aux pays européens qui sont au moins partiellement intégrés au marché commun de l’Union européenne, y compris ceux de l’Espace économique européen, de l’Association européenne de libre-échange et de l’Ukraine, cette dernière étant censée bénéficier de l’intégration de la défense et de l’aide militaire que ReArm Europe pourrait contribuer à développer. Les marchés publics communs sont même accessibles aux pays en voie d’adhésion et aux pays candidats comme la Serbie et la Turquie, même si leurs chances d’adhérer à l’UE sont actuellement très faibles.
La priorité accordée aux produits de défense européens pour l’Europe est également évidente dans les conditions d’utilisation des fonds. Les règles sont claires. En ce qui concerne les consommables de guerre tels que les munitions et les missiles, les États membres « doivent veiller à ce que les composants représentant 65 % du coût du produit final proviennent de l’Union, des pays de l’AELE membres de l’EEE ou de l’Ukraine ». Cette exigence est plus stricte pour les systèmes complexes, car les États membres de l’UE doivent également veiller à ce que « les contractants contrôlent entièrement la conception des équipements de défense » afin de ne pas créer de « nouvelles dépendances » dans leur production. En bref, dans le scénario le plus optimiste, les contractants canadiens pourraient réaliser jusqu’à 35 % du coût du produit final.
La réalité sera toutefois loin de ce seuil, car les décideurs politiques européens considéreront probablement que le déploiement de capitaux outre-Atlantique augmente les coûts en raison de la simple distance géographique qui sépare le Canada des chaînes d’approvisionnement et des ressources militaires européennes, ce qui limitera sa participation à des projets d’approvisionnement conjoints. En effet, étant donné que près des deux tiers des exportations canadiennes dans le domaine de la défense étaient destinées aux États-Unis en 2022, l’industrie canadienne de la défense est tellement intégrée à son homologue américaine qu’il sera difficile de la libérer, d’autant plus que, en vertu du titre III de la loi américaine sur la production de défense (Defence Production Act), les entreprises canadiennes de défense sont traitées comme des entreprises américaines. Le fait que les achats de défense canadiens aient été orientés vers les États-Unis nuit à la crédibilité d’Ottawa en tant qu’investisseur potentiel et peut rendre la question du contrôle de la conception délicate pour Ottawa. Enfin, ReArm Europe contribuera probablement à financer de grandes entreprises traditionnelles qui sont des champions nationaux sur le continent. Pour ces raisons, les possibilités de collaboration en matière d’innovation et de partage de technologies entre les deux côtés de l’océan Atlantique pourraient rester limitées.
Les quelques initiatives qui ont été proposées, telles que la relocalisation de la production de l’avion de combat Gripen de Saab au Canada, doivent être considérées avec scepticisme. Deux questions se posent. La première concerne la faisabilité et la rentabilité de la mise en place et du maintien de nouvelles installations de production dans un délai raisonnable. La seconde, plus pertinente, concerne la pertinence d’acquérir les capacités spécifiques que ces initiatives encourageraient. L’une des raisons pour lesquelles le marché européen de la défense est fragmenté est que, comme le note Jan Joel Andersson, « les divergences entre les exigences nationales, les philosophies de conception et les intérêts politiques et industriels rendent difficile tout accord ». Le Canada a ses propres considérations qui reflètent son orientation géopolitique, notamment son implication importante dans la défense de l’Amérique du Nord. Bien que le bilan du futur programme d’avions de combat du Canada soit particulier, notamment en raison des controverses qui ont entouré l’acquisition du F-35, l’une des raisons pour lesquelles Dassault et Airbus sont hors jeu est qu’ils ne pouvaient pas respecter, à un coût raisonnable, les exigences en matière de systèmes de commandement, de contrôle et de communication que nécessite la participation du Canada au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).
Une approche plus sensée pourrait consister à situer la participation du Canada à ReArm Europe dans le contexte de ses engagements européens préexistants. Après tout, le Canada est en train d’augmenter son engagement militaire dans la brigade multinationale en Lettonie, dont il est la nation cadre depuis 2017. Les inquiétudes concernant la viabilité de l’engagement canadien se sont intensifiées à la suite de la décision prise lors du sommet de Madrid en 2022 de faire passer l’ancien groupement tactique de présence avancée renforcée d’un bataillon de grande taille à une brigade. La rotation de 1 900 membres du personnel des FAC entre le Canada et la Lettonie a pesé lourdement sur le dispositif global des forces canadiennes. Ainsi, les besoins en capacités qui servent directement la contribution canadienne – munitions et autres consommables – pourraient être financés par ReArm Europe, tirant ainsi parti des chaînes d’approvisionnement plus courtes et des partenariats existants que la brigade incarne déjà.
Conclusion
L’adhésion à ReArm Europe a été une priorité déclarée du premier ministre Carney dans le cadre de ses efforts louables pour redynamiser les Forces armées canadiennes. Devenir membre de ReArm Europe présente des avantages, d’autant plus que le Canada participe déjà à la sécurité européenne en tant que contributeur de premier plan à la brigade multinationale en Lettonie. Cependant, ces avantages ne doivent pas être surestimés auprès du public canadien. Les responsables de la défense canadienne devraient modérer leurs attentes quant à ce que ReArm Europe peut réellement apporter. La raison est simple : l’industrie européenne de la défense restera probablement fragmentée selon les frontières nationales et donc sujette à des inefficacités. L’utilisation des fonds prêtés dans le cadre de cette initiative donnera une forte préférence aux produits européens fabriqués en Europe. Les sommes colossales associées à ReArm Europe ne doivent pas détourner l’attention de ces questions.
Jacob Tuckey poursuit une maîtrise en gouvernance mondiale à la Balsillie School of International Affairs de l’Université de Waterloo et est un chercheur émergent au sein du Réseau d’analyse stratégique. Alexander Lanoszka est professeur agrégé au département de sciences politiques de l’Université de Waterloo et codirecteur du Réseau d’analyse stratégique. Les auteurs remercient Richard Shimooka pour ses commentaires sur une version antérieure de cet article.
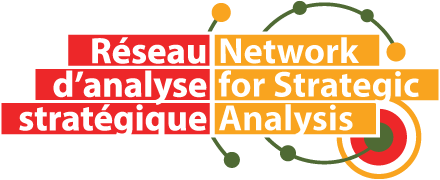





Les commentaires sont fermés.