Le 9 novembre, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé un accord de fin des hostilités, sous l’égide de la Russie. Ce cessez-le-feu, qui consacre une victoire militaire pour l’Azerbaïdjan, aura maintes répercussions sur la sécurité régionale et au-delà. Le cadre changeant du processus de paix entourant le conflit du Haut-Karabakh – d’une entreprise euro-atlantique à une entreprise régionale – indique que ni la Russie ni la Turquie ne continuent à considérer l’Occident comme un acteur pertinent dans leur cour arrière. Cette dynamique, que l’on avait déjà observée dans d’autres théâtres conflictuels ces derniers mois, notamment suite au retrait militaire des États-Unis de la Syrie, est indicative d’un changement de paradigme dans la gestion du cours des affaires internationales, voire dans l’ordre mondial. Ce changement de paradigme est favorisé par un certain désengagement des États-Unis et un « réveil » et une alliance de circonstance des deux principales puissances régionales.
Au moment d’écrire ces lignes, un cessez-le-feu parrainé par la Russie vient de mettre un terme à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les derniers bilans officiels parlent de plus de 2300 soldats et de 50 civils morts du côté arménien, mais ce chiffre est incomplet puisque l’Azerbaïdjan n’a toujours pas communiqué ses pertes militaires, tout en faisant état de 93 civils décédés des suites du conflit. Les deux parties affirment avoir tué « des milliers » de militaires de l’autre camp. Des sources russes indiquent, deux semaines avant l’établissement du cessez-le-feu que les pertes seraient de l’ordre de 5000 morts, ce qui en ferait un des conflits les plus meurtriers de l’année. Au cours des opérations militaires, de nombreuses sources ont indiqué d’importantes acquisitions territoriales réalisées par l’Azerbaïdjan, y compris des sources arméniennes qui pourtant ont tendance à minimiser leurs pertes. Après les stupeurs et les craintes initiales que cette escalade belligène entraîne les acteurs régionaux, notamment la Turquie et la Russie, et leurs alliés par extension, ces acteurs extérieurs ont fait preuve d’une certaine retenue. Il n’est toujours pas possible d’envisager quelle sera la solution à ce conflit, mais il est toutefois d’ores et déjà permis d’affirmer que cette guerre aura des conséquences au-delà du nombre de victimes ou des destructions sur le terrain. Un nouveau cadre sécuritaire régional se développait parallèlement aux combats, potentiellement annonciateur d’un nouvel ordre international.
Le réveil du « conflit gelé » au Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’est étiré sur des mois : après des escarmouches frontalières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet 2020, les combats de l’automne ont sans conteste été les plus violents depuis l’établissement d’un cessez-le-feu en 1994. Cette soudaine reprise des hostilités contraste avec les signes encourageants de rapprochement entre les deux camps qui semblaient se dessiner en 2018, notamment avec l’instauration d’une ligne d’alerte directe entre les leaders des deux camps.
On fait souvent référence aux conflits gelés pour désigner ces conflits sécessionnistes de l’ex-URSS, où les parties sécessionnistes ont réalisé des gains militaires sur le terrain sans pour autant obtenir une reconnaissance internationale. Ces conflits s’enlisent alors dans des processus de paix interminables qui finissent par entrer dans un état de dormance, du fait du manque de progrès dans les négociations. Le terme « gelé » ne caractérise cependant pas tellement les conflits eux-mêmes, qui voient souvent la reprise épisodique des violences, mais plutôt les processus de paix visant à les résoudre. C’est particulièrement vrai dans le cas du conflit du Haut-Karabakh qui jusqu’à ce jour ne bénéficiait d’aucune force d’interposition de la paix pour faire respecter les accords de cessez-le-feu. Il est important de rappeler que ce conflit est essentiellement une lutte à trois acteurs – Arménie, Azerbaïdjan et République du Haut-Karabakh (RHK, appelée Artsakh par les Arméniens) – et comporte une double nature : elle est à la fois une lutte sécessionniste interne à l’Azerbaïdjan et un conflit international opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, même si les combats se sont presque exclusivement déroulés en Azerbaïdjan.
Les combats de l’automne 2020 ont pris des proportions existentielles pour les principaux protagonistes. Les Arméniens du Karabakh défendent des terres qu’ils considèrent les leurs depuis trois millénaires et, par analogie au génocide arménien de 1915, affirment risquer l’élimination pure et simple. Pour sa part, l’Azerbaïdjan cherche à rétablir son intégrité territoriale en restaurant sa souveraineté sur le territoire sécessionniste autoproclamé. Non seulement les forces sécessionnistes s’étaient affranchies de la gouverne de Bakou depuis le début des années 1990, mais elles occupaient d’importants territoires azerbaïdjanais, sept districts en fait, au-delà de ce qui constituait la région autonome du Nagorno-Karabakh de l’époque soviétique. Les forces sécessionnistes comptaient se servir de ces territoires occupés comme monnaie d’échange dans leurs négociations avec les autorités azerbaïdjanaises, alors que la restitution a été exigée par quatre résolutions de l’ONU (Résolutions 822, 853, 974 et 884) depuis 1993. Progressivement, la possession de ces territoires s’est transformée en occupation, avec la construction d’infrastructures permettant de lier le Haut-Karabakh à l’Arménie. L’Azerbaïdjan, frustré et humilié de voir les résolutions de l’ONU sans effet, et de se voir obligé d’absorber une importante population de réfugiés et de personnes déplacées, cherche à prendre sa revanche depuis l’éclatement du conflit il y a une trentaine d’années.
Bien que la RHK subsiste de manière indépendante de l’Azerbaïdjan depuis 1994, il s’agit d’un État de facto qu’aucun autre État n’a reconnu, ni même l’Arménie voisine ou la Russie. Cette dernière a pourtant reconnu deux autres territoires sécessionnistes ayant acquis leur indépendance de facto de la Géorgie voisine dans un contexte similaire, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, suite à la guerre qu’elle a livrée à la Géorgie en août 2008. Depuis ces événements, la Russie continue d’intervenir dans la vie politique de cette petite république du Caucase. À l’instar des territoires sécessionnistes en Géorgie, le conflit du Haut-Karabakh interpelle le droit international placé devant le dilemme de devoir trancher entre deux principes diamétralement opposés : celui du droit des peuples à l’autodétermination et celui du droit des États à défendre leur intégrité territoriale et leur souveraineté. La crise humanitaire et le jeu des puissances régionales interpellent également la communauté internationale et, éventuellement, pourraient à terme nécessiter son intervention.
Étant donné l’insatisfaction des belligérants par rapport à leur insécurité respective, les éclats de l’été ont clairement préparé la guerre de l’automne. À l’occasion de la 75e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2020, les discours prononcés par les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais, quelques jours à peine avant le début des opérations militaires à grande échelle du 27 septembre, portaient déjà en germe l’escalade à venir. Le premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont tous deux utilisé un langage équivoque : le premier faisait la promotion du droit à l’autodétermination tout en dénonçant l’implication croissante de la Turquie, le second déplorait le manque de progrès diplomatique dans la résolution de ce conflit et accusait la partie arménienne d’intransigeance.
De fait, depuis le début des années 1990, les négociations pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh sont ancrées dans le processus de Minsk, qui s’inscrit dans le cadre de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), dont est issu un groupe de contact co-présidé par les États-Unis, la France et la Russie : le Groupe de Minsk. Ce groupe s’est constitué dès 1992, à l’époque où l’OSCE était encore la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Malgré son cadre euro-atlantique, le Groupe de Minsk inclut tous les États intéressés et acteurs étatiques régionaux d’importance, y compris la Turquie, à l’exception notable de l’Iran. Cependant, au cours des près de trente ans de son existence, ce groupe de contact a poursuivi ses travaux sans atteindre de résultats tangibles. On a de plus en plus l’impression, en particulier en Azerbaïdjan, que le Groupe de Minsk est incapable ou refuse de fournir une solution efficace au conflit. En début juillet 2020, le président Aliyev a ouvertement attaqué le processus de paix et remis en question la nécessité de négocier avec l’Arménie. Seulement quelques jours plus tard ont éclaté les attaques sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Cette coïncidence, s’il s’agit bien d’une coïncidence, n’est pas sans rappeler les critiques analogues émises par les autorités azerbaïdjanaises en février et en mars 2016, soit peu avant la reprise des hostilités – dans ce que certains ont appelé la « guerre d’avril » ou la « guerre de cinq jours » – qui se sont soldées par près de 200 victimes et la reconquête par l’Azerbaïdjan de quelques positions sur le pourtour du Haut-Karabakh.
Ce qui a changé en 2020
Il n’est pas exceptionnel que l’on assiste à une reprise des hostilités armées dans ce conflit « très peu gelé ». Ce qui distingue cependant l’escalade actuelle des éclats précédents est le rôle beaucoup plus actif de la Turquie, celui plus réservé de la Russie et l’absence des États-Unis. L’analyse des réactions officielles de ces acteurs extérieurs donne aux observateurs un aperçu des conséquences que cette reprise violente du conflit pourrait avoir : elle pourrait être le prélude à une transformation du processus de paix d’un processus euro-atlantique en un processus plus « régional ».
Depuis l’été 2020, la Turquie – qui n’a jamais été neutre sur cet enjeu du fait de sa proximité culturelle avec l’Azerbaïdjan, mais qui a toujours évité de s’impliquer trop fortement de peur de s’attirer les foudres de Moscou – semble avoir abandonné sa neutralité de façade. Au-delà des critiques dirigées contre l’Arménie lors des éclats de juillet, Ankara a intensifié sa rhétorique contre l’Arménie en août, à l’occasion du centenaire du traité de Sèvres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a multiplié les critiques de l’Arménie à la suite d’exercices militaires conjoints turco-azerbaïdjanais à la fin juillet et au début d’août de cette année. Dès septembre, des observateurs font état d’un soutien diplomatique accru de la Turquie à l’endroit de Bakou et du transfert de matériel militaire turc vers l’Azerbaïdjan. Sans que ce soit confirmé officiellement, les témoignages se sont accumulés à l’effet que la Turquie utilise des centaines de combattants armés pro-turcs ayant œuvré en Syrie pour soutenir Bakou, bien que ce soit vivement démenti de la part des autorités politiques et intellectuelles du pays.
Contrairement aux attentes, l’appui sans équivoque en provenance de la Turquie et sa présence militaire en Azerbaïdjan ne se sont pas heurtés à une vive réaction de la part de la Russie, qui s’est contentée pendant près de dix jours de lancer un appel à la retenue aux belligérants – une position très peu vocale qui a donné l’impression que la Russie, pourtant l’alliée stratégique de l’Arménie dans le cadre de l’Organisation du traité de la sécurité collective (OTSC), soit très peu intéressée à s’impliquer dans ce conflit. Après dix jours, Moscou s’est activée à piloter des pourparlers de paix, même après qu’un de ses hélicoptères ait été abattu par erreur par les forces azerbaïdjanaises au-dessus du territoire arménien. Plusieurs analystes à Moscou et ailleurs questionnaient même si une implication de la diplomatie russe dans ce conflit n’engendrerait pas un coût trop élevé pour les bénéfices que peut en retirer Moscou. La Russie a réussi à négocier un cessez-le-feu le 9 octobre, une trêve humanitaire le 17 octobre et une autre le 26 octobre, trois ententes qui furent ignorées sur le terrain. Pour sa part, l’accord du 9 novembre semble avoir eu plus d’écho : un cessez-le-feu a été signé par l’Arménie et l’Azerbaïdjan, notamment une entente qui comprend un rôle de maintien de la paix pour la Russie. Il s’agit ici d’une première, car le cessez-le-feu précédent, qui a suspendu l’essentiel des hostilités armées entre 1994 et 2020, n’était pas accompagné d’une force d’interposition déployée dans la région. Fait à noter, l’accord ne fait nulle mention du rôle du Groupe de Minsk ou de l’OSCE.
Vers un tandem Turquie-Russie au Caucase?
Bien que tacite, la participation de la Turquie au conflit dans une région que la Russie considère comme son arrière-cour peut être vue par le prisme d’une synergie de politique étrangère de Moscou et d’Ankara sur plusieurs fronts. Ainsi, alors même que la Turquie et la Russie se tiennent sur des côtés opposés dans les guerres civiles syrienne et libyenne, elles ont toutes deux trouvé un terrain d’entente dans leur éloignement respectif des paradigmes politiques et même militaires occidentaux. Pour la Turquie, cet éloignement prête le flanc à la critique de ses partenaires de l’OTAN, un phénomène dont l’ampleur grandit à mesure qu’Ankara multiplie les gestes de provocation unilatéraux, que ce soit en Syrie, en Libye ou, plus récemment, en Méditerranée orientale. Le régime du président Erdogan affiche de plus en plus ouvertement une politique étrangère nationaliste sans complexe, que certains qualifient d’irrédentiste, mais qui est davantage axé sur des considérations politiques et sécuritaires et serait plus proche d’un certain « gaullisme à la turque ». Plusieurs questionnent maintenant si la Turquie est toujours un partenaire fiable au sein de l’Alliance atlantique, ce qui mine le climat de confiance indispensable entre alliés, au moment où la Turquie cherche à faire sa marque sur la scène régionale. Du côté de Moscou, ce changement d’approche pourrait s’expliquer par une tentative de faire revivre la doctrine Primakov (du nom de l’ancien ministre russe des Affaires étrangères et premier ministre Evgueni Primakov), voulant que la Russie forme des alliances régionales pour ainsi résister à l’hégémonie mondiale des États-Unis.
De nombreux observateurs estiment que la reprise du conflit armé au Haut-Karabakh est un nouveau chapitre dans la guerre par procuration séculaire que se livrent Moscou et Ankara dans le Caucase. Pourtant, après un examen plus approfondi de la situation géopolitique actuelle, il semble plutôt que les deux parties aient développé un certain rapprochement, voire une collaboration pragmatique dans certains dossiers au Caucase plutôt que d’utiliser chaque prétexte pour relancer leur rivalité historique. Ce conflit renouvelé semble leur procurer une opportunité de travailler ensemble afin d’exercer une influence dans la région tout en excluant les puissances occidentales.
La relation amour-haine turco-russe est devenue la plus évidente quand, le 24 novembre 2015, des chasseurs F-16 turcs ont abattu un avion Sukhoï SU-24 russe au-dessus de la frontière entre la Turquie et la Syrie. L’incident qui aurait pu être utilisé par Moscou pour aggraver les tensions avec Ankara, s’est simplement traduit par un froid diplomatique momentané qui fut déjà oublié à la mi-2016, lorsque les deux pays ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques. En 2017, les relations turco-russes étaient déjà redevenues suffisamment amicales pour que les deux pays signent un accord de coopération militaire ouvrant la voie à l’achat par Ankara de missiles sol-air de fabrication russe. Vu les problèmes de sécurité indéniables que pose l’achat d’équipement militaire russe par la Turquie pour les partenaires de cette dernière au sein de l’OTAN, la crainte que la Turquie bascule dans le camp de la Russie dans un climat qui rappelle celui de la guerre froide, a provoqué l’ire de Washington, qui a annulé certains programmes de coopération avec Ankara, dont le programme des F-35, et même entamé une réflexion sur la possibilité d’exclure la Turquie de l’Alliance atlantique. Ankara ne semble pas s’en préoccuper, poursuivant de façon ouverte, provocatrice aux yeux des Occidentaux, un rapprochement avec des régimes peu fréquentables – Iran, Venezuela et Russie – tout en adoptant une politique de plus en plus nationaliste sur la scène régionale. Il faut dire que les pays membres de l’OTAN peuvent difficilement exclure la Turquie de l’Alliance atlantique, une impossibilité stratégique selon plusieurs analystes, car cela signifierait pour l’OTAN de se couper du détroit du Bosphore essentiel pour ses navires et mènerait à l’isolement complet des flottes roumaines et bulgares, en plus d’anéantir la possibilité de voir un jour la Géorgie intégrer l’OTAN. Conscient de sa position stratégique, Erdogan se moque des préoccupations de ses partenaires de l’OTAN en décidant de tester ses nouveaux systèmes de missiles russes le 16 octobre 2020, soit en pleine crise du Haut-Karabakh, un geste qui sera probablement suivi de l’exclusion de la Turquie d’autres programmes de l’OTAN, voire de sanctions, sans pour autant mener à son expulsion.
Outre leur suspicion et leur attitude oppositionnelle à l’égard de l’Occident, la Russie et la Turquie ont toutes les deux su profiter de plusieurs développements au cours des deux dernières années pour accroître leur coopération, en particulier dans le Caucase du Sud. L’isolationnisme accru de la politique étrangère américaine des dernières années et le déclin de l’intérêt des pays européens dans la région fournissent une opportunité à la Russie et à la Turquie de « détourner » le dossier du Haut-Karabakh du Processus de Minsk de l’OSCE en le convertissant en une entreprise régionale. Cet acte de conversion est même accéléré par les gestes de défiance posés par la Turquie, qui n’hésite plus à se froisser avec les pays occidentaux. Après des mois de relations houleuses entre Ankara et Paris, au sujet de la Libye ou de l’exploration pétrolière en Méditerranée, Erdogan reproche désormais au président français Emmanuel Macron son projet de lutter contre l’islamisme radical en France. Face aux critiques très peu diplomatiques formulées par Erdogan, qui a questionné la « santé mentale » de Macron en l’invitant « à se faire soigner », la France n’eut d’autres choix que de rappeler l’ambassadeur de la Turquie. À la même occasion, le président turc a accusé la France d’être « responsable de l’occupation d’une partie du territoire de l’Azerbaïdjan par les séparatistes pro-arméniens », ce qui vise évidemment à miner la crédibilité de la France, qui abrite une large population d’origine arménienne, dans son rôle potentiel de médiatrice neutre dans ce conflit et en tant que co-présidente du Groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie. La rupture des relations diplomatiques franco-turques ne pourra que limiter davantage les pressions que Paris est en mesure d’exercer sur les acteurs de ce conflit, alors que la Turquie y manifeste sa participation de plus en plus ouvertement. Les États-Unis étant complètement absorbés par la campagne présidentielle et ses suites, il ne reste plus que la Russie pour s’occuper d’entretenir le processus de paix de Minsk. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la Turquie appelle à l’établissement d’un nouveau cadre de négociation pour le processus de paix pour le Haut-Karabakh, un cadre qui se ferait désormais à quatre : Arménie, Azerbaïdjan, Russie et Turquie.
Les conséquences de la transposition du conflit du Haut-Karabakh d’un cadre multilatéral de l’OSCE dans un cadre plutôt régional russo-turc (avec un rôle iranien possible, mais pas encore clair) pourraient être majeures et durables. Dans ce contexte, l’approche « attentiste » initiale de la Russie, suivie par son implication dans la négociation d’un cessez-le-feu entre les protagonistes, porte fruit. En effet, la Russie a habilement su utiliser ses différents leviers de pression pour imposer son processus de paix alternatif à celui du Groupe de Minsk. D’ailleurs, le cessez-le-feu négocié le 9 novembre prévoit le déploiement d’une force russe de maintien de la paix composée de 1960 militaires, une perspective qui n’avait jamais été acceptée par les protagonistes (surtout l’Azerbaïdjan) jusqu’à maintenant. La Turquie y obtient un rôle de superviseur de l’application de l’accord. Une autre conséquence de cet accord est l’évacuation complète de la perspective du Haut-Karabakh : en effet, jusqu’à maintenant, l’Arménie avait toujours refusé de signer un quelconque accord sans que la RHK en soit partie. Le fait que l’Arménie ait signé cet accord de cessez-le-feu désavantageux indique non seulement son extrême vulnérabilité géopolitique, mais donne également du crédit à la thèse azerbaïdjanaise qui, depuis des décennies, affirme que le conflit du Haut-Karabakh n’est pas tant un conflit sécessionniste sur son territoire qu’un conflit interétatique entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie voisine. Ainsi, même s’il est clair que l’Azerbaïdjan est passé à l’offensive militaire ces dernières semaines, cet État aime projeter une image de soi comme étant la victime de l’intransigeance des Arméniens depuis trente ans.
Du point de vue de la Turquie, le récent conflit et la possible diplomatie régionale en collaboration avec la Russie pour le résoudre apportent un double avantage : l’occasion, pour Erdogan, de revendiquer une victoire militaire et diplomatique et, plus important encore, le renforcement du « mentorat » de la Turquie sur l’Azerbaïdjan. Ces deux éléments permettent à la Turquie d’avancer son programme d’affirmation sur la scène régionale et internationale.
Malgré l’appel du Conseil de sécurité de l’ONU, lancé le 29 septembre, à contenir le conflit et à poursuivre sa médiation dans le cadre de l’OSCE, il est devenu évident que le processus de Minsk n’est plus une option viable pour les acteurs impliqués dans le conflit. Ceci signifie l’enterrement définitif de ce processus moribond, qui avait déjà été abandonné par l’Arménie depuis longtemps.
Le passage d’un processus de paix d’un cadre multilatéral – le Groupe de Minsk de l’OSCE – à un cadre plus régional russo-turc indique que l’Occident est un acteur de moins en moins pertinent dans la cour arrière de la Russie et de la Turquie. Que ce soit par choix ou par convergence accidentelle, les deux puissances régionales sont prêtes à définir et à mettre en œuvre leurs propres stratégies de sécurité dans le Caucase du Sud de manière bilatérale, avec seulement des objections symboliques et timides de la part de l’Occident. Le processus de Minsk semble être la dernière victime de cette tendance ainsi que du désengagement américain dans le cours des affaires mondiales.
Considérations politiques pour le Canada
Le conflit du Haut-Karabakh interpelle le Canada à maints égards. D’abord, le soutien de plus en plus documenté de la Turquie auprès des forces azerbaïdjanaises est préoccupant, car ce partenaire de l’OTAN a livré de la technologie canadienne aux forces armées azerbaïdjanaises, qui l’ont utilisée dans leurs opérations militaires de l’automne. En réaction, la firme canadienne BRP a suspendu ses livraisons de moteur de drones à la Turquie et un examen complet des produits canadiens militaires susceptibles d’avoir été employés sur le champ de bataille caucasien est mené par les autorités canadiennes afin de voir s’il n’y a pas lieu d’élargir l’embargo.
Ensuite, en tant que puissance moyenne, le Canada a toujours privilégié le travail diplomatique des organisations internationales. C’est là une façon canadienne d’avoir une voix sur la scène internationale, une voix généralement peu entendue en dehors de ces organisations en raison de l’alignement historique du Canada sur les positions géopolitiques des États-Unis. Or l’échec du Groupe de Minsk et la quasi-absence de médiation occidentale dans ce conflit sont une occasion perdue. Étant largement perçu comme un État relativement neutre sur les enjeux du Caucase, Ottawa aurait été bien positionné pour tenter de faire le pont entre les protagonistes. Une telle initiative diplomatique pourrait éventuellement aider le Canada dans ses ambitions à obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.
Enfin, Ottawa doit prendre position sur l’enjeu de la reconnaissance – ou la non-reconnaissance – de l’indépendance de la RHK. Il s’agit d’un enjeu sensible pour le Canada, qui héberge une petite population d’origine arménienne qui compte plusieurs artistes, intellectuels et personnalités publiques. Cette communauté a une bien plus grande visibilité que les personnes d’origine azerbaïdjanaise, beaucoup moins nombreuses au pays, ce qui lui permet de bénéficier d’une certaine capacité d’influencer les autorités politiques canadiennes. C’est ainsi qu’elle a su convaincre les législateurs canadiens de reconnaître le génocide de 1915, malgré les menaces de rétorsions de la Turquie, pourtant un allié dans le cadre de l’OTAN. Cette influence explique également l’initiative du sénateur Leo Housakos, qui a déposé une motion demandant la reconnaissance de l’indépendance de la république du Haut-Karabakh. Le Canada n’est pas le seul pays à être interpelé par la communauté de la diaspora arménienne, car un véritable mouvement a été lancé pour la reconnaissance internationale de la RHK. L’Uruguay, comme bien souvent sur ce genre d’enjeu – après tout, il s’agit du tout premier État au monde à avoir reconnu le génocide arménien de 1915 – ouvre le bal en discutant explicitement la possibilité de reconnaître l’indépendance de la République du Haut-Karabakh, même si cela se fait sur un territoire diminué. Sa capitale, Montevideo, l’a formellement reconnue.
Pour le Canada, il convient toutefois d’être prudent avant de se lancer dans un tel processus de reconnaissance étatique. Le Haut-Karabakh est une entité ayant fait sécession d’un État souverain, l’Azerbaïdjan, que le Canada a reconnu dans ses frontières héritées de l’époque soviétique. Or, en dehors des situations coloniales, le droit international ne reconnait généralement pas un droit à la sécession, sauf à de très rares situations spécifiques – telle une occupation étrangère (comme au Koweït en 1990) ou en cas de dissolution d’État (comme l’URSS et la Yougoslavie en 1991 et la Tchécoslovaquie en 1993) – des conditions qui ne sont pas applicables au Karabakh. Certes des juristes activistes tentent de développer un nouveau droit à la sécession depuis une vingtaine d’années, à savoir dans le cas de populations qui seraient soumises à une répression sévère et de longue durée. Le seul cas qui a pu en bénéficier à ce jour est celui du Kosovo, pourtant un cas qui est loin de faire l’unanimité. Toujours contestée par la Serbie, l’indépendance du Kosovo n’est reconnue que par une centaine d’États et l’entité ne parvient pas à gagner l’appui nécessaire pour faire son entrée à l’ONU. Au moment de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, en février 2008, la plupart des États l’ayant reconnu comme un nouvel État indépendant, comme le Canada, ont pris la peine de souligner qu’il s’agissait d’un cas unique qui ne créerait pas de précédent. Or, quoi qu’en pensent les autorités canadiennes, et malgré les mises en garde de spécialistes, une telle unicité est insoutenable en droit international et la reconnaissance du Kosovo constitue bien un précédent, qui a d’ailleurs servi de modèle à la reconnaissance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie et quelques autres États en 2008.
Si le Canada s’engage dans une nouvelle reconnaissance de ce type, il risque de reproduire ce qui a toujours été présenté comme ayant un caractère unique. Il s’agit d’un jeu dangereux qui pourrait, d’une part, déstabiliser l’ordre international en banalisant l’ingérence dans les affaires internes des États tout en favorisant la multiplication des États et, d’autre part, venir hanter le Canada si jamais une province canadienne cherchait à faire sécession et obtenait des appuis étrangers dans ses efforts sécessionnistes. Ottawa ne peut s’attendre à la retenue des autres États s’il se permet de soutenir une approche qui porte atteinte de façon flagrante à la souveraineté d’autrui.
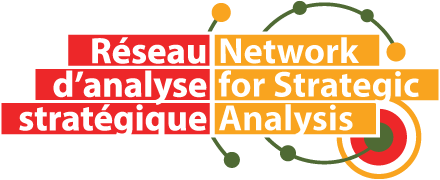




Les commentaires sont fermés.