Dans une interview accordée le 30 mars, le président américain Donald Trump a menacé l’Iran de bombardements et de droits de douane secondaires si Téhéran n’acceptait pas un nouvel accord nucléaire avec Washington. Il a indiqué que des discussions étaient en cours entre des responsables américains et iraniens, mais n’a pas fourni de détails spécifiques. M. Trump a déclaré que si aucun accord n’était conclu, il envisagerait de réimposer des droits de douane secondaires similaires à ceux imposés il y a quatre ans. En réponse, l’Iran a rejeté les négociations directes sous la pression et les menaces militaires des États-Unis, mais a réitéré sa volonté de s’engager dans des discussions indirectes. Trump a également indiqué qu’il prendrait une décision sur les tarifs secondaires dans quelques semaines si aucun progrès n’était réalisé. Cette décision fait suite à celle qu’il a prise en 2017 de retirer les États-Unis de l’accord nucléaire conclu en 2015 avec l’Iran.
Une semaine plus tard, le 8 avril, adoptant une position un peu moins agressive, le président Trump a annoncé que des responsables américains rencontreraient directement les dirigeants iraniens pour discuter des ambitions nucléaires du pays. Il a averti que si les négociations échouaient, « l’Iran serait en grand danger ». Il a également déclaré que si les négociations n’aboutissaient pas, les États-Unis pourraient entreprendre une action militaire contre les installations nucléaires iraniennes, soulignant que l’Iran ne devait pas être autorisé à posséder des armes nucléaires. Depuis le début de son second mandat, le président Trump oscille entre une ligne dure et une approche plus indirecte à l’égard de Téhéran. Ces changements constants soulèvent la question de la logique sous-jacente à la politique iranienne de l’administration Trump. Cet article soutient que sous ces oscillations se cache un objectif stratégique : utiliser une pression maximale non seulement pour limiter les ambitions nucléaires de l’Iran, mais aussi pour perturber son alliance de plus en plus profonde avec la Chine – réaffirmant ainsi la domination des États-Unis dans la région et contrant l’influence mondiale croissante de Pékin.
Trump est-il sérieux au sujet de la menace de bombardement ?
La première question qui se pose est de savoir si le président américain est sérieux lorsqu’il évoque la possibilité d’attaquer l’Iran. L’administration de Trump a poussé à des sanctions plus agressives et à une pression militaire sur l’Iran, en particulier depuis qu’il a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 au cours de son premier mandat. Il a récemment étendu le déploiement des forces militaires américaines au Moyen-Orient et a menacé de procéder à des frappes militaires si l’Iran ne parvenait pas à un accord. Certains critiques, dont le commentateur médiatique conservateur Tucker Carlson, se sont prononcés contre un conflit militaire, évoquant le risque de pertes et de dommages importants pour les États-Unis.
Si l’histoire récente nous a appris quelque chose, c’est que rien de ce que le président Trump annonce ne doit être pris à la légère. Récemment, Vladimir Poutine a déclaré que l’une de ses déclarations les plus farfelues, comme l’idée de prendre le contrôle du Groenland, devait être prise au sérieux. Cela dit, l’approche du président Trump, notamment en ce qui concerne la République islamique d’Iran, a toujours été transactionnelle. Malgré les décisions audacieuses qu’il a prises depuis le début de son second mandat, il semble probable qu’il choisisse de reprendre sa stratégie de pression maximale à l’égard du régime iranien, en poussant les dirigeants iraniens à faire le plus de concessions possibles, notamment en ce qui concerne le programme nucléaire. À cet égard, il convient de noter que sa stratégie de non-prolifération est largement soutenue par la plupart de ses alliés et, dans une certaine mesure, par la Russie de Poutine qui, malgré son soutien à Téhéran, n’est pas tout à fait à l’aise avec l’idée d’un Iran nucléaire.
Si une guerre totale des États-Unis contre l’Iran reste improbable, la possibilité de frappes ciblées contre les infrastructures et les installations nucléaires iraniennes ne peut être écartée, notamment en raison du précédent créé par la frappe réussie d’Israël sur le réacteur nucléaire syrien, aujourd’hui abandonné, en 2007. Cette opération a démontré la volonté et la capacité des alliés régionaux à agir de manière décisive contre les menaces nucléaires perçues. Dans ce contexte, les États-Unis pourraient choisir de déléguer cette action à Israël, en lui apportant un soutien logistique ou de renseignement plus ou moins important. La stratégie sous-jacente consisterait à exercer une pression militaire calibrée afin de ramener l’Iran à la table des négociations, notamment en ce qui concerne son programme nucléaire.
L’affaiblissement de l’Iran le pousse-t-il à négocier avec Trump ?
Une autre question importante est de savoir si la reprise de la stratégie de pression maximale et le recours aux menaces militaires suffiront à convaincre les autorités iraniennes de s’asseoir à la table des négociations et d’engager des discussions directes avec les représentants de l’administration Trump.
Il est important de noter que les États-Unis n’ont pas eu de discussions directes avec l’Iran depuis l’administration Obama. Bien que l’Iran ait rejeté les négociations directes avec les États-Unis sous la direction de Trump, il a exprimé sa volonté de s’engager dans des pourparlers indirects. En réponse à l’annonce de M. Trump, Nour News, aligné sur le Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran, l’a critiquée comme étant une opération psychologique visant à influencer l’opinion publique.
La République islamique d’Iran refuse depuis longtemps les négociations directes avec les États-Unis pour des raisons idéologiques et politiques, considérant ces discussions comme une légitimation des politiques américaines qu’elle perçoit comme nuisibles à sa souveraineté et à la stabilité régionale. Même lorsque le dialogue peut sembler bénéfique d’un point de vue international, les responsables peuvent refuser des négociations directes avec les États-Unis en raison de rivalités internes au régime, d’une rhétorique nationaliste et de la crainte de perdre leur légitimité nationale. L’Iran estime que des négociations directes pourraient compromettre ses principes fondamentaux, notamment sa position sur l’influence régionale, le développement nucléaire et la résistance à la domination occidentale. L’Iran préfère les pourparlers multilatéraux, qu’il considère comme un moyen plus équilibré d’aborder les problèmes avec les États-Unis sans isoler ses positions.
Le 7 avril, Téhéran a confirmé sans surprise la reprise du dialogue sur le programme nucléaire iranien, tout en précisant qu’il s’agirait de discussions indirectes. Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les discussions se dérouleraient sous la médiation d’Oman, avec la participation de l’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Cela fait suite à une annonce antérieure du président Trump concernant des pourparlers « directs » avec l’Iran, bien que Téhéran ait rejeté l’idée de négociations directes.
Il est intéressant de noter que la Russie a récemment proposé sa médiation entre Téhéran et Washington, notamment en ce qui concerne le programme nucléaire iranien. Cette initiative témoigne du rôle croissant de la Russie dans la diplomatie internationale, d’autant plus que les tensions entre l’Iran et les États-Unis restent vives. L’offre de médiation du Kremlin reflète à la fois ses intérêts stratégiques et son désir de promouvoir le multilatéralisme, réduisant ainsi la probabilité d’actions unilatérales de la part des États-Unis. L’ouverture de la Russie s’appuie également sur la position conciliante de l’administration Trump, qui permet à Moscou d’étendre son influence, en particulier dans des régions comme le Moyen-Orient où le leadership des États-Unis s’est affaibli.
Cependant, les récents développements au Levant, y compris l’affaiblissement des forces mandataires de l’Iran et de ses capacités militaires asymétriques, ont considérablement diminué la profondeur stratégique régionale de l’Iran. Cette perte, combinée aux sanctions et à l’isolement diplomatique, pourrait pousser Téhéran à reconsidérer son refus de négociations directes avec les États-Unis. Bien que l’Iran ait été idéologiquement opposé à de telles négociations, l’évolution de la dynamique régionale et les coûts économiques et politiques de sa stratégie actuelle pourraient faire du dialogue avec les États-Unis une option plus viable pour désamorcer les tensions et protéger ses intérêts.
Au-delà du fou : Le fil de soie
Bien qu’elle puisse paraître désordonnée et improvisée, la politique internationale de l’administration Trump trouve sa cohérence dans son objectif de limiter l’influence mondiale de la Chine – que ce soit au Panama, au Groenland, sur la scène économique mondiale ou en mer de Chine méridionale. Le vice-président américain a confirmé l’existence d’un fil conducteur anti-chinois dans la politique de Washington, affirmant que depuis son entrée en fonction, l’administration Trump cherche un antidote à l’« économie mondialiste », qui, selon les décideurs américains, profiterait systématiquement aux intérêts chinois.
En ce qui concerne l’Iran, Washington est particulièrement inquiet de voir l’Iran tomber sous l’influence de la Chine. En mars 2021, Téhéran et Pékin ont signé un ambitieux partenariat stratégique couvrant les secteurs économique, technologique et militaire. L’accord de 25 ans entre la Chine et l’Iran marque un rapprochement stratégique perçu par les Etats-Unis comme une menace directe pour leurs intérêts. Cette coopération se manifeste par des échanges militaires, notamment des ventes d’armes, des exercices conjoints et des partages technologiques, renforçant ainsi les capacités défensives et offensives de l’Iran. Sur le plan économique, cette alliance s’étend à l’énergie, aux infrastructures et à des secteurs économiques plus larges, intégrant l’Iran dans l’initiative chinoise « Belt and Road » (BRI) et liant davantage la République islamique à la Chine. Pour la Chine, la position de l’Iran au carrefour du Moyen-Orient, de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud en fait un élément essentiel de ses stratégies géopolitiques et économiques.
Washington craint que ce partenariat ne fasse de l’Iran un pivot stratégique, affaiblissant ainsi ses efforts pour limiter l’influence de la Chine au Moyen-Orient et en Asie. À moyen terme, l’activisme diplomatique de la Chine, qui vise à rapprocher l’Iran d’acteurs régionaux tels que l’Arabie saoudite et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), est perçu comme un moyen pour Pékin de s’imposer comme un acteur politique et économique de premier plan, marginalisant ainsi l’influence américaine. À long terme, cette coopération tripartite pourrait faciliter l’émergence d’un bloc eurasien, dont l’Iran serait le maillon clé, et qui pourrait servir de contrepoids à l’hégémonie américaine.
Ces éléments offrent un contexte plus large pour comprendre l’approche de Washington vis-à-vis de l’Iran, en particulier à la lumière de la résurgence de la stratégie de « pression maximale » et des menaces permanentes d’action militaire. Au lieu de recourir à des frappes militaires qui dévasteraient l’économie et l’infrastructure de l’Iran, les États-Unis visent à atteindre un objectif plus stratégique : détacher l’Iran de l’influence croissante de la Chine. Ce faisant, Washington espère rétablir progressivement l’Iran dans la sphère d’influence américaine, où il peut être plus facilement géré et influencé politiquement et économiquement.
La stratégie américaine vise à éloigner l’Iran de ses liens de plus en plus étroits avec la Chine et à encourager Téhéran à revenir à un cadre dans lequel ses activités économiques et politiques sont plus étroitement alignées sur les intérêts américains. Au minimum, Washington espère intégrer l’Iran dans un système commercial qui reste soumis à la surveillance et aux réglementations américaines, en veillant à ce que l’influence américaine continue à façonner le paysage économique de la région et à ce que l’Iran reste quelque peu limité dans ses transactions internationales. Cette approche reflète une vision à long terme visant à réaffirmer la domination des États-Unis au Moyen-Orient et à réduire l’empreinte croissante de la Chine dans la région.
Conclusion
En conclusion, les tensions actuelles entre les États-Unis et l’Iran reflètent un paysage politique complexe et fluctuant, la stratégie du président Trump oscillant entre des moyens de pression agressifs et des ouvertures diplomatiques. Malgré ses menaces d’action militaire et de réimposition de tarifs secondaires, la probabilité d’une guerre à grande échelle reste faible, même si des frappes ciblées pourraient toujours être sur la table en tant qu’outils de négociation. La résistance de l’Iran aux négociations directes souligne sa position idéologique, mais l’évolution de la dynamique régionale et la pression croissante pourraient obliger Téhéran à reconsidérer sa position. Par ailleurs, les inquiétudes de Washington concernant les liens croissants entre l’Iran et la Chine ajoutent une nouvelle urgence à la situation, les États-Unis cherchant à limiter l’influence de la Chine dans la région. En fin de compte, la stratégie américaine ne vise pas seulement à endiguer le nucléaire, mais aussi à réaffirmer sa domination au Moyen-Orient en remodelant les alliances et le cadre économique de l’Iran. Alors que la partie d’échecs géopolitique se déroule, une chose est sûre : les enjeux sont élevés et l’équilibre des forces dans la région pourrait changer radicalement dans les années à venir.
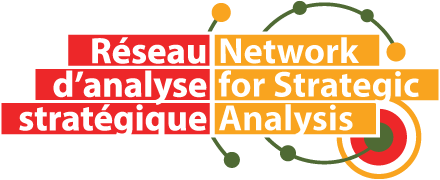




Les commentaires sont fermés.