Le conflit armé du Nagorno-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qui a débuté le 27 septembre, a duré près de deux mois et aurait fait plus de 10,000 morts, dont deux fois plus du côté azéri. Il a pris le monde entier par surprise. Il n’y a là rien d’étonnant. Il s’agissait d’un conflit gelé depuis vingt-deux ans et donc pratiquement oublié, sauf bien sûr, par les deux petits États en cause. S’il a connu une importante couverture médiatique, c’est en raison de la conjoncture internationale actuelle et de la dimension des nouveaux enjeux qu’il révèle dans la politique internationale de la Russie post-soviétique et de la recherche de sa place dans le monde.
La faiblesse apparente de la Russie
Pendant le premier mois de la guerre, et même plus, la Russie a paru hésitante et même incapable de soutenir et défendre l’Arménie qui était et demeure son alliée militaire. Elle fait effectivement partie de l’OTSC (Organisation du Traité de Sécurité Collective), l’alliance remise sur pied par Vladimir Poutine en 2002, qu’il voyait comme le noyau dur des alliés de la Russie et qui est comparée abusivement à une OTAN de l’Est. Elle compte six des anciennes républiques soviétiques et l’Arménie y abrite une base militaire russe.
On comprend pourquoi l’Azerbaïdjan n’y a jamais adhéré. Il a été partiellement démembré par l’Arménie peu après la fin de l’URSS. Démembré d’une part par la prise du Nagorno-Karabakh qui était une région autonome comprenant 80% d’Arméniens, et d’autre part par la conquête de territoires qui s’étendent très au-delà de l’enclave arménienne. L’Azerbaïdjan a ainsi perdu 14% de son territoire; le Karabakh comptant pour 9%. Dans le chaos qui régnait à Moscou en 1992, l’opinion était nettement favorable à l’Arménie. Des groupes militaires russes encore mal contrôlés par Eltsine ont prêté main forte aux combattants arméniens. En 1993 après la fin des hostilités, 800,000 Azéris avaient quitté les territoires conquis et 400,000 Arméniens avaient émigré en Arménie dans la foulée de deux pogroms qui furent assimilés au génocide arménien.
La passivité militaire de la Russie pendant la reconquête par l’Azerbaïdjan de la majeure partie des territoires perdus au début du siècle, y compris d’une partie du Karabakh, a été justifiée par Vladimir Poutine par des arguments de droit international. Il a fait valoir, comme pour se justifier, que l’indépendance auto-proclamée du Nagorno-Karabakh n’avait jamais été reconnue ni par la Russie, ni même par l’Arménie; ce qui est rigoureusement exact.
Il oublie cependant de dire que si l’Arménie ne l’a pas fait, c’est à la demande et même à l’exigence de la Russie de Boris Eltsine après le cessez-le-feu de 1994. L’histoire explique bien des choses. On était alors en pleines guerres inter-ethniques de sécession dans l’ancienne Yougoslavie avec leur cortège d’horreurs qui auraient été impensables en Europe quelques années plus tôt. Principale responsable de ces guerres, la Serbie a été mise au ban des nations. En conséquence, la révision des frontières des États post-soviétiques était un sujet tabou à Moscou pour les ultra-occidentalistes de l’entourage de Eltsine dont l’objectif premier était de voir la Russie « joindre les rangs du monde civilisé », pour utiliser leurs termes[1].
Tout récemment, après l’arrêt des hostilités en Azerbaïdjan, Vladimir Poutine a donné une très longue entrevue pour expliquer et justifier le comportement de la Russie pendant le conflit. Parlant comme s’il avait été un arbitre neutre entre les deux parties, il a cependant critiqué l’Arménie, mais pas du tout l’Azerbaïdjan[2]. Pour ce faire, il s’est référé au Groupe de Minsk qui avait été mis sur pied en 1994 et présidé conjointement par les États-Unis, la Russie et la France (dans l’esprit de la fin de la guerre froide) pour trouver une solution au conflit qui soit acceptable aux deux parties et qui n’a jamais pu réussir malgré plusieurs tentatives. Poutine a souligné qu’en 2013 il avait proposé, avec l’accord des deux autres co-présidents du Groupe, une restitution par l’Arménie de sept districts azéris pour détendre la situation et pouvoir régler plus facilement ensuite le statut du Karabakh. Erevan s’y était opposé pour garder un moyen de pression important afin d’obtenir la renonciation à ce territoire. En d’autres mots, selon lui, c’était l’intransigeance de l’Arménie qui bloquait un dégel de la situation. Poutine a aussi affirmé que quelques semaines après le début de la guerre, en octobre, le président de l’Azerbaïdjan avait accepté de conclure un cessez-le-feu à la seule condition que les anciens citoyens azéris, notamment ceux de la ville de Shusha, puissent retourner au Karabakh. Il s’est dit étonné que le président arménien ait refusé de saisir cette proposition.
Si tout au long du conflit armé la Russie est apparue comme en perte d’influence et incapable de peser sur le cours des événements, on a vu par la suite que ce fut un choix délibéré. On allait assister à un important redressement de son rôle avec la fin des hostilités.
Les succès militaires d’un Azerbaïdjan épaulé par la Turquie
Avant même la première guerre du Karabakh, les relations de l’Azerbaïdjan avec la Russie étaient déjà très mauvaises et n’ont fait que s’aggraver par la suite même si Moscou n’en était que peu responsable. L’effondrement économique, l’un des pires de l’ex-URSS, et l’absence de forces armées dignes de ce nom expliquent largement sa défaite. Le chaos politique a commencé à s’arrêter peu après le cessez-le-feu de 1994, avec l’arrivée au pouvoir d’un personnage politique de haut calibre : Heydar Aliyev. Avec Mikhaïl Gorbatchev, Aliyev avait été l’un des deux membres du Politburo du Parti communiste de l’URSS que Iouri Andropov envisageait en 1984 pour lui succéder comme Secrétaire-Général du Parti. Après son décès en 2003 il fut remplacé par son fils Ilham Alyev, toujours en place.
Dans les années qui ont suivi leur accession au pouvoir, le redressement économique de l’Azerbaïdjan a été assez spectaculaire, grâce à la réalisation de plusieurs grands projets d’exportation de pétrole vers la Turquie qui en a beaucoup bénéficié, tant comme consommateur que comme voie de transit vers l’Europe. On pense ici à l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui fait un parcours de 1,768 kilomètres pour arriver sur la Méditerranée et à celui de 1,300 kilomètres depuis Bakou vers la Russie au port de Novorossiisk pour exportation vers l’Europe. Il n’est pas nécessaire d’insister sur la très forte dépendance de la Turquie pour ses importations de gaz russe. Ces liens économiques majeurs ont forcément favorisé des liens politiques importants, mais variables entre les trois pays.
En octobre 2009, après des années et des années d’hostilité, deux protocoles d’accord ont été signés entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Le premier visait à établir des relations diplomatiques entre les deux États, à reconnaître comme définitive leur frontière commune et permettre ainsi des échanges commerciaux. Le second visait à chercher des compromis sur les enjeux qui les séparaient. À Erevan, on envisagea de diluer l’exigence de la reconnaissance du génocide de 1915 par un projet d’étude conjointe des événements survenus alors. Une autre commission devait rechercher un compromis sur l’avenir du Nagorno-Karabakh. L’événement provoqua un tollé à Bakou où on menaça de suspendre les relations avec Ankara et d’annuler des projets de nouveaux accords pétroliers. Mais, près d’un an plus tard, sous la pression de la diaspora arménienne, le Parlement d’Erevan annula les protocoles signés. L’hostilité commune de l’Azerbaïdjan et de la Turquie à l’endroit de l’Arménie en sortit nettement renforcée.
Il est assez étonnant que la nouvelle guerre pour le Nagorno-Karabakh n’ait pas été prévue longtemps avant le début des hostilités malgré une tension constante et forte. Le rapport de force autant militaire qu’économique entre les deux parties n’avait plus rien à voir avec celui de la première. Les soldats azéris sous les drapeaux étaient au nombre de 67,000 et l’Arménie en comptait 45,000. Pour ce qui est des chars d’assaut et autres véhicules armés, l’Arménie en comptait respectivement 529 et 1,000 alors que l’Azerbaïdjan en avait 665 et 1,637. L’ensemble des avions et hélicoptères de combat était de 127 du côté azéri et de 65 du côté arménien. En 2019, le budget de la défense de Erevan était de $1,8 milliard et celui de Bakou était de $645 millions.
Malgré toute cette supériorité, Ilham Aliyev a jugé prudent autant politiquement que militairement de demander une aide directe de la Turquie. Comme on le sait, c’est celle-ci qui a fourni les drones qui se sont avérés très efficaces et qui a envoyé des officiers de très haut niveau pour coordonner sinon même diriger les opérations. Il a été fait aussi état de mercenaires provenant de la minorité turque de Syrie qui avait combattu le régime Assad avant d’avoir dû se réfugier en Turquie.
Le retour décisif de la Russie
Tout au long de la guerre de quarante-quatre jours, Poutine a demandé un cessez-le-feu. Il a réussi à l’obtenir, ou plutôt à l’imposer, après que l’Azerbaïdjan eut repris presque tout le territoire entourant le Nagorno-Karabakh et une partie non négligeable de ce dernier. On ne connaît pas le contenu des nombreux entretiens qu’il a eu avec Aliyev et Erdogan. Cependant, à divers signes on peut croire qu’ils ont été très durs et orageux. Trois semaines après le début des hostilités, lors d’une rencontre à Istanbul entre le président ukrainien Zelenski et son homologue Erdogan, celui-ci lui a réaffirmé que la Turquie refusait de reconnaître l’annexion de la Crimée par la Russie. On sait qu’il soutient ouvertement les revendications de la minorité des Tatars qui comptent pour 12% de la population de la péninsule. Avec son penchant provocant, il est allé plus loin et lui a même dit, dans une déclaration commune, qu’il aiderait l’Ukraine à joindre les rangs de l’OTAN. Il sait très bien que c’est pour bloquer une telle éventualité que la Russie soutient la rébellion du Donbass qui dure depuis six ans.
Poutine a réussi à imposer le cessez-le-feu avant que l’Arménie ait totalement perdu le Karabakh. Il est certain que c’est l’Azerbaïdjan qui a choisi d’accepter le cessez-le-feu et qui a dû mettre la Turquie devant sa décision. Ce faisant, Ilham Alyiev a montré qu’il accordait une nette préférence géopolitique à la Russie. En lui demandant d’accepter de ne pas rétablir complètement l’intégrité territoriale de son pays, Poutine a voulu éviter une défaite totale et catastrophique de son alliée l’Arménie. Il en sera redevable à son homologue azéri.
Et ce n’est pas tout ce qu’il lui doit. Pour garantir le cessez-le-feu, les accords prévoient le déploiement d’un contingent militaire russe de 2,000 hommes en territoire azéri, autour de l’espace réduit du Karabakh, pour une période renouvelable de cinq ans. Pour la première fois depuis la fin de l’URSS, des forces militaires russes seront stationnées en Azerbaïdjan. Avant la publication des termes du cessez-le-feu, il fut annoncé à Istanbul que des militaires turcs se joindraient aux forces de maintien de la paix. Il n’en a rien été. Tout au plus quelques observateurs turcs pourront être accueillis dans un centre de surveillance du cessez-le-feu. Soulignons que cet accord ne dit rien du tout sur l’avenir du Karabakh. Le cessez-le-feu est renouvelable après cinq ans.
L’habileté de Poutine à faire avaliser un tel compromis est assez remarquable. L’accès de l’Arménie au Karabakh lui est maintenant garanti par les forces militaires russes. En retour, et c’est là une concession majeure de l’Arménie, celle-ci a accepté la construction sur son territoire d’une route qui permettra à l’Azerbaïdjan de rejoindre le Nakhitchevan, qui est une entité importante de son territoire enclavée entre l’Arménie et l’Iran. Jusqu’à maintenant les communications terrestres de l’Azerbaïdjan vers sa région autonome doivent nécessairement passer par l’Iran. L’Azerbaïdjan obtiendrait ainsi une sortie vers la Turquie avec laquelle elle n’a pas de frontière[3]. Ce fut certainement une concession très difficile pour Poutine à obtenir. Il reste cependant à voir quand et comment pourra se faire cette route.

Source : Carte de l’Azerbaïdjan avec le Haut-Karabakh et la zone contrôlée par l’armée arménienne jusqu’en novembre 2020. Consultez le fichier d’origine ici.
Quelques mots s’imposent sur l’attitude de l’Iran pendant le conflit. Il faut souligner d’abord qu’il y a plus de deux fois plus d’Azéris en Iran qu’en Azerbaïdjan; soit 23 millions face à 10 millions. Des deux côtés, la grande majorité de ceux-ci sont chiites, tout comme la vaste majorité de la population de l’Iran. Les relations entre les deux États ont souvent été difficiles. Notamment en raison du fait qu’Israël a compté pour 60% des achats d’armements de l’Azerbaïdjan entre 2015 et 2019 selon les chiffres du SIPRI; le reste venant de la Russie et la Turquie. C’est après bien des hésitations et en raison du poids de sa population azérie que Téhéran a appuyé l’Azerbaïdjan.
Si la guerre avait duré quelques jours de plus, l’Azerbaïdjan aurait reconquis la totalité de son territoire, à moins d’une entrée en guerre de la Russie. Poutine a-t-il dû menacer de le faire ? On le saura peut-être un jour. Quoi qu’il en soit, lors de sa très longue conférence de presse du 17 novembre, et contrairement à ses commentaires concernant l’Arménie, il a fait preuve d’une grande déférence à l’endroit d’Aliyev et même de la Turquie. En réponse aux questions des journalistes concernant l’appui majeur donné par la Turquie à l’Azerbaïdjan, il leur a répondu: « L’Azerbaïdjan est un État indépendant et souverain et il a parfaitement le droit de choisir ses alliés comme il le veut ». Il ne dirait assurément rien de tel en ce qui concerne la Géorgie et l’Ukraine… On pourrait dire que la Turquie a un statut très particulier dans ses relations avec la Russie.
Étant donné que le cessez-le-feu du 9 novembre ne prévoit strictement rien sur l’avenir du Nagorno-Karabakh, l’on risque fort de retourner au conflit gelé pendant 25 ans ; et pour combien de temps ? Si le lien routier prévu en Arménie entre les deux morceaux de l’Azerbaïdjan peut se faire, il devrait entraîner une détente entre les deux États. Le mieux à espérer dans ces conditions serait une formule de double appartenance du Karabakh à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan. Est-ce possible ? L’avenir le dira.
Les difficiles bonnes relations de la Russie et de la Turquie
Dans les termes les plus simples, ce qui explique ces bonnes relations sont leurs déceptions et leurs désillusions, plus récentes dans le cas de la Turquie, à l’égard du monde occidental. Ces déceptions et désillusions concernent davantage l’Europe dans le cas de la Turquie, et davantage les États-Unis dans le cas de la Russie. Avec l’annexion de la Crimée et surtout en raison de la guerre du Donbass et ses milliers de morts, la Russie a été mise au ban de l’ensemble du monde occidental. Pour ce qui est de la Turquie, il faut se rappeler que durant les premières années de son pouvoir à Ankara en 2003, Erdogan a fait de nombreux efforts pour répondre aux exigences de l’Union européenne afin que la Turquie puisse y adhérer, pour finalement essuyer un refus. Il a par la suite cultivé la nostalgie de l’Empire ottoman de même que l’Islam pour donner une mission internationale à la Turquie, sans bien sûr vouloir le reconstituer.
La géographie et l’histoire font donc en sorte qu’il y a là un chevauchement partiel, mais non négligeable de ce que Moscou appelle la « sphère des intérêts légitimes » des deux États; le terme de sphère d’influence étant devenu politiquement incorrect. Malgré toutes les frictions survenues entre elles, la Russie attache une grande importance à la Turquie parce qu’elle la voit comme un très important facteur de multipolarité dans la conjoncture internationale actuelle.
On touche ici à ce qui est devenu l’objectif central de la politique internationale de la Russie depuis sa prise en main en janvier 1996 par Evgueni Primakov, éminent universitaire et grand maître de la géopolitique, dans le contexte et en raison du second élargissement de l’OTAN vers l’Est. C’est avec la Chine que la Russie a fondé en 2001 l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), dont l’un des premiers objectifs était la promotion de la multipolarité dans le monde par le renforcement de leurs liens économiques, politiques et militaires. C’est dans ce cadre qu’ont eu lieu de grandes manœuvres militaires entre la Chine, la Russie et quelques-uns de ses alliés d’Asie centrale[4]. Avec des statuts variables, plusieurs autres États ont rejoint l’OCS, qui est devenue le principal foyer et promoteur de la multipolarité.
En 2012, la Turquie a demandé à devenir membre à part entière de l’OCS. Erdogan y a obtenu un statut particulier, la Turquie étant membre de l’OTAN; un cas unique. En novembre 2016, quelques jours après que le Parlement de Strasbourg eut suspendu ses négociations avec Ankara pour son accession à l’Union européenne, l’OCS lui a confié la présidence d’un groupe de consultation sur les enjeux énergétiques. Avec un fort appui de Moscou, c’était la première fois que l’OCS donnait un tel mandat à un membre à statut particulier.
L’importance géopolitique de la Turquie pour la Russie tient aussi et peut-être même davantage à son achat de missiles russes de défense anti aérienne S-400, qui comptent parmi les armements les plus sophistiqués dont dispose Moscou. C’est là un événement sans précédent dans toute l’histoire de l’OTAN. Erdogan a résisté là-dessus aux nombreuses pressions des États-Unis qui ont même appliqué quelques sanctions. Malgré cela, un second contrat d’achat a été conclu en août dernier. En raison des effets perturbateurs qui en résultent pour la cohésion de l’OTAN, la Russie ne peut que souhaiter que la Turquie y demeure.
En conclusion, il faut souligner que la Russie paie pour l’instant un prix politique assez léger au regard de ce que peut valoir la Turquie en termes de multipolarité. C’est à l’intérieur du triangle Russie-Iran-Turquie qui cherche à rétablir l’intégrité territoriale de la Syrie que la Russie prend davantage en compte les intérêts de la Turquie qui veut y établir une zone tampon sur ses frontières pour empêcher un passage possible de forces kurdes. Pour Erdogan, les revendications kurdes intérieures comme extérieures sont le principal danger qui pèse sur la Turquie.
Que peut faire le Canada d’aussi loin ?
Le 22 octobre dernier, dans le contexte des événements évoqués plus haut, mais sans rapport direct avec eux, Vladimir Poutine s’adressait à un large auditoire d’universitaires et d’éditorialistes étrangers venant entre autres des États-Unis et du Canada, dans le cadre de sa rencontre annuelle ce qui s’appelle le « Club de discussion Valdai ». Il y a tenu des propos d’une arrogance nettement plus étonnante que d’habitude :
Laissez-moi vous assurer chers amis que nous évaluons objectivement nos potentialités : notre potentiel intellectuel, territorial, économique et militaire. Je me réfère ici à nos options actuelles et à notre potentiel global. En renforçant ce pays et en regardant ce qui arrive dans le monde et dans d’autres pays, je voudrais dire à ceux qui s’attendent encore à voir la force de la Russie décliner graduellement, la seule chose qui nous inquiète est d’attraper un rhume à vos funérailles.
On voit dans ces propos un reflet compensatoire de la mise au ban de la Russie dans le monde occidental et des multiples sanctions dont elle a fait l’objet ces dernières années. Si Poutine n’a pas encore salué la victoire électorale de Joe Biden, ce n’est certainement pas par déférence envers Donald Trump. C’est qu’il s’attend à pire et qu’il cherche comme on dit parfois, « à lui tenir la dragée haute ». Le Canada a déjà pu contribuer à faciliter une atténuation notable des tensions entre les États-Unis et la Russie. Il n’est pas clair qu’il en ait encore la capacité.
[1] Soulignons pour cela qu’en 1992, Eltsine a refusé de donner suite à une résolution très majoritaire de ce qui s’appelait encore le Soviet suprême de Russie concernant la Crimée. Cette résolution exigeait sa restitution à la Russie, en faisant valoir que son transfert à l’Ukraine par Khrouchtchev en 1954 était illégal parce que la Constitution soviétique exigeait qu’un changement de frontières fasse l’accord des républiques concernées et pas seulement d’une décision du Soviet suprême de l’URSS; ce qui n’avait pas été respecté. La Crimée comptait alors plus de 70% de Russes.
[2] Le texte de ses propos mérite d’être lu en entier : cliquez ici.
[3] Voir la carte ci-haut, où on voit bien avec tout cela l’arbitraire des frontières établies par Staline.
[4] Il faut souligner les récentes et colossales manœuvres « Vostok-2018 », aussi bien terrestres que navales conduites en septembre dernier en Extrême-Orient par la Russie avec une participation très importante de la Chine. Elles auraient mobilisé plus de 300 000 personnes.
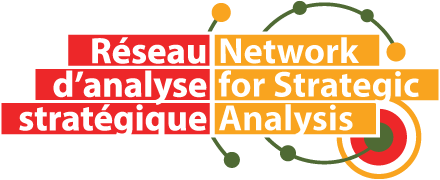
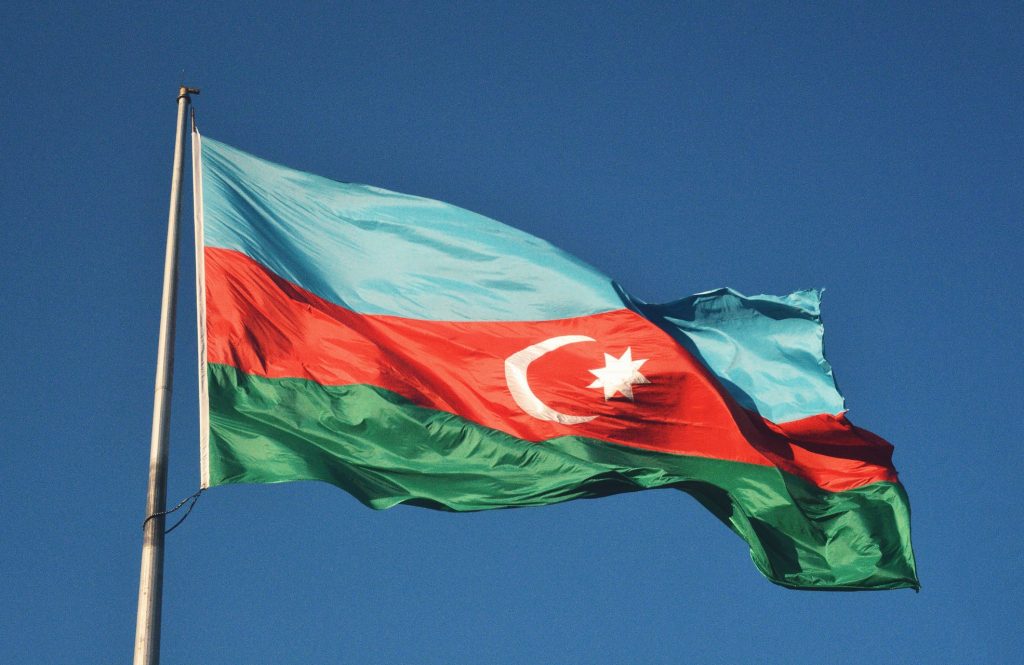




Les commentaires sont fermés.