Le droit s’avère aujourd’hui omniprésent au sein des relations internationales, agissant notamment à titre de régulateur des activités interétatiques ou encore comme vecteur de légitimation. Bien qu’il soit à vocation universelle, l’approche des États à l’égard du droit international n’est ni homogène ni systématique. À cet effet, les grandes puissances ont su démontrer à plusieurs reprises que la poursuite d’intérêts politiques suffisait pour limiter, voire ignorer, certains principes du droit international. Paradoxalement, le droit est utilisé récurremment par les États lorsque ceux-ci considèrent qu’il peut servir la poursuite de leurs objectifs stratégiques. En définitive, il est établi que la politique et le droit sont intrinsèquement liés, ce qui se révèle encore plus vrai au niveau du système international, où ce sont principalement les mêmes acteurs qui agissent comme législateurs, en l’interprétant et en veillant à son application. Conséquemment, les opportunités d’instrumentalisation du droit international dans la poursuite d’objectifs politiques se sont multipliées parallèlement au développement du réseau juridique. Enfin, la rivalité sino-américaine n’est pas étrangère à ce phénomène.
Cette note politique a pour objectif d’évaluer l’espace qu’occupe le droit international dans la dynamique de compétition entre Washington et Pékin. Elle débute par une analyse de la relation réservée au droit international par chacun des deux États. Par la suite, elle effleure le débat sémantique entourant la conceptualisation du phénomène du « lawfare », s’identifiant comme un type d’instrumentalisation et perceptible au sein de la présente dynamique. Suivant cela, des clivages comportant des implications juridiques sont abordés, nommément, le révisionnisme chinois du droit international de la mer, la légifération des armes létales autonomes et, finalement, la zone grise du cyberespace. Enfin, la note conclut en présentant des recommandations pour le gouvernement canadien.
Relation respective des États-Unis et de la Chine avec le droit international
Les États-Unis sont reconnus comme étant les instigateurs du système international. Outre le récent aléa « trumpiste », les présidences américaines ont généralement influencé positivement le déploiement et le maintien des organisations internationales, en plus d’agir comme leader au sein de celles-ci. Toutefois, le dévouement à la mise en place de ses institutions s’est révélé être prééminent au respect des règles qui en ont émergé. Théoriquement dualistes, les différentes lectures du droit international aux États-Unis convergent à divers degrés vers la notion d’exceptionnalisme, octroyant à Washington un statut particulier, lui justifiant une marge d’autonomie singulière sur la scène internationale. Quoique cette vision, lorsque jointe à leur historique d’instrumentalisation du droit international, mine la cohérence du discours américain, cela n’empêche pas les États-Unis de faire appel à l’importance de la règle de droit dans les affaires internationales de façon répétée. Cette rhétorique s’illustre à plusieurs reprises, comme ce fut le cas lors du voyage du président Barack Obama (2009-2017) en Australie en 2011 ou, plus récemment, par la déclaration du président Joe Biden sur le rôle des États-Unis dans le monde. Bien que le ressenti exceptionnaliste soit contestable sur le plan juridique, Washington cherche toujours à défendre l’ordre international libéral qu’il a activement construit et conséquemment, la règle de droit qui s’y applique.
La relation de la Chine avec le droit international ne partage pas cet historique. En effet, il est reconnu que le droit sert une fonction différente au sein de la culture chinoise. Pour plusieurs hauts fonctionnaires chinois, le système international libéral est l’objet de conflits et de compétitions inéquitables. Cette rhétorique prend racine dans ce qu’on appelle le « siècle d’humiliation ». Lors de cette époque, l’autorité chinoise dit avoir été subjuguée par les puissances occidentales. En effet, la Chine s’est fait imposer plusieurs « traités inéquitables » qui ont impacté son intégrité territoriale et sa souveraineté. En raison de cet historique, la Chine a développé un ressentiment envers l’Occident et le droit international, ce dernier s’étant identifié comme un instrument domination. De ce fait, l’empreinte du leadership chinois au sein des organisations internationales a longtemps été marginale. L’ordre international libéral ainsi que les normes et valeurs qui y ont été développées et qui y sont aujourd’hui véhiculées n’ont pas le même écho auprès de l’État asiatique. Bien que la Chine se soit développée parallèlement à cette évolution systémique, le droit international importe néanmoins au gouvernement chinois, que ce soit comme vecteur de légitimité internationale ou comme instrument stratégique. Longtemps à l’écart, le gouvernement chinois cherche aujourd’hui à jouer un rôle actif dans l’environnement juridique. Néanmoins, Pékin demeure limité par la portée de sa légitimité normative en raison de l’écart idéologique séparant son positionnement paradigmatique à celui de l’ordre international libéral. Aujourd’hui, Pékin perçoit son ascension comme un « rajeunissement », qui, interrompu par l’Occident, tend à le remettre sur le chemin de sa gloire passée. À cet effet, cette perception provient en partie de la réémergence de l’ancienne croyance chinoise du Tianxia. Cette dernière, qui troque l’égalité entre les nations du modèle onusien par une structure hiérarchique sinocentrique, se veut diamétralement opposée à l’ordre international libéral.
Au-delà de la compétition où chacun cherche à promouvoir une trame narrative et à orienter la prolifération normative, les deux États perçoivent une utilité stratégique au droit international. Toutefois, ils ne la conçoivent pas de façon identique. Tandis que Washington tarde à envisager un usage alternatif du droit international se voulant plus offensif, Pékin identifie explicitement le droit comme un instrument « militaire » pouvant servir à la défense de ses intérêts. Identifiée par l’expression « Falu zhan », et mieux traduit par le terme anglais « lawfare », cette conceptualisation du droit en tant qu’instrument de guerre s’est codifiée en 2003 par le Parti communiste chinois (PCC) au sein d’un document intitulé « Political Work Regulations of the Chinese People’s Liberation Army ». Pour Pékin, le droit est un outil lui permettant de conserver un avantage stratégique vis-à-vis de son adversaire, que ce soit avant, pendant, ou après l’apparition d’un conflit.
Complexité sémantique
Le droit et la politique ne peuvent être dissociés et interagissent sur une multitude de niveaux. Une des lectures possibles du droit est qu’il peut se définir comme un but, un moyen, ou un obstacle dans sa relation avec la politique. À cette fin, les activités d’instrumentalisation et ainsi que celle du « lawfare » sont cohérentes avec cette conception. La conceptualisation d’une opération juridique comme une opération guerrière est redevenue d’actualité suivant la guerre contre la terreur en 2001. Popularisé par le major général américain Charles J. Dunlap Jr, le terme « lawfare » renvoie initialement à une méthode de guerre où le droit est utilisé comme un moyen pour atteindre un objectif militaire. Bien que certains considèrent le terme péjoratif, Dunlap le conceptualise comme étant neutre et l’identifie comme une dimension incontournable des conflits modernes. Tout en conservant cette notion d’usage dans la poursuite d’intérêts stratégiques, le terme s’est graduellement élargi afin d’inclure des zones d’activités en dehors du champ de bataille traditionnel. Néanmoins, des limitations persistent, que ce soit en lien avec l’applicabilité du terme aux activités extérieures au carcan militaire ou encore à la dissociation du « lawfare » des pratiques légales courantes qui se veut parfois complexe. Cette ambiguïté conforte l’idée selon laquelle cette notion continuera d’évoluer et que ce ne sont pas toutes ses idéations qui feront consensus. Il est par ailleurs pertinent de soulever que cette forme d’instrumentalisation du droit international s’est développée presque conjointement au concept de guerre hybride, résultant en un renforcement mutuel des deux concepts. Bien qu’il existe un flou sémantique entourant la conceptualisation du « lawfare », tout porte à croire que les avenues d’instrumentalisation du droit international et du « lawfare » ne feront qu’augmenter. En raison de la volatilité de sa définition, cette note emploiera le « lawfare » dans son sens le plus élargi, soit comme l’usage du droit aux fins de la poursuite d’objectifs stratégiques, sans enclaver le phénomène au cadre militaire.
Le révisionnisme chinois du droit international de la mer en mer de Chine du Sud
Depuis le début du XXe siècle, la mer de Chine du Sud est le terrain de multiples revendications. La plus notoire d’entre elles renvoie au traçage de la « ligne à neuf traits » par Pékin, initialement cartographiée en 1947. Sujet controversé, c’est en 2009 que le débat juridique sur cet enjeu a pris de l’ampleur, soit suivant l’envoi d’un communiqué par Pékin soutenant sa souveraineté « indiscutable » sur les îles et les eaux adjacentes de la région. Le tracé, qui a fait l’objet d’une procédure d’arbitrage par un tribunal de la Cour permanente d’arbitrage à la suite d’une initiative des Philippines en 2013, a été déclaré sans fondement légal en vertu du droit international. Malgré une décision en faveur des Philippines, la Chine a rejeté ce dernier, arguant que le jugement n’aura aucun effet sur « la souveraineté territoriale et le droit maritime applicable » dans la région. Et elle agit toujours comme de fait. En ce sens, Pékin cherche à consolider sa réclamation territoriale extensive dans la région par le biais de facteurs politiques, économiques et militaires, et non par un affrontement direct.
À cet effet, le droit s’identifie comme étant central à la stratégie du PCC pour l’atteinte de cet objectif. À titre d’exemple, une récente loi passée par le gouvernement chinois, nommément la « China Coast Guard (CCG) Law », octroie à l’autorité chinoise un pouvoir de coercition en mer de Chine méridionale et du Sud violant systématiquement plusieurs articles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNDUM). Cette législation, qui entend réguler les activités de la Garde côtière chinoise, s’étend à l’intégralité des « eaux sous juridiction chinoise ». Les travaux préparatoires de cette loi ainsi que les récentes activités coercitives chinoises à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) des Philippines tendent à concrétiser les craintes de plusieurs voulant que Pékin cherche à étendre ses activités législatives dans la zone maritime contestée pour consolider ses requêtes de souveraineté. Soutenant avec fermeté qu’elle n’a pas tort, la Chine cherche à moduler l’acceptabilité de ses actions dans la région. Après avoir considérablement perturbé l’environnement géopolitique régional, Pékin cherche à instituer un ordre légal afin de cristalliser ses gains; elle mise sur une reconception de la perception « d’illégalité » entourant son comportement. En perpétuant des activités maritimes sur la base d’une lecture résolument erronée des provisions de la CNUDM, Pékin tente de manipuler le droit international coutumier. Par effet de répétition et d’acceptation tacite, ou dans le cas échéant, par l’existence d’une dissuasion implicite de l’opposition, la Chine cherche à remanier l’environnement juridique en mer de Chine du Sud pour y augmenter son contrôle.
Pour Washington, cette région relève d’une importance particulière. En plus de partager plusieurs intérêts avec ses alliés en périphérie de la mer de Chine du Sud, ceux-ci vouent également un appui de longue date à l’ordre international libéral instauré par les États-Unis. Néanmoins, bien que la précédente administration américaine ait fermement affirmé que les actions chinoises violaient le droit international et déclaré son appui au verdict rendu par le tribunal d’arbitrage en 2016, la portée de la rhétorique de Washington reste restreinte. D’une part, l’appel des États-Unis à respecter le droit international de la mer se voit considérablement miné par leur absence de ratification de la CNUDM. À cet effet, l’histoire des politiques américaines vis-à-vis de l’applicabilité du droit international de la mer exemplifie l’attitude ambivalente de Washington quant à l’usage de la règle de droit dans sa gestion des affaires internationales. L’incapacité américaine de ratifier le traité a également pour effet d’agrémenter l’argumentaire chinois, en plus d’élargir son éventail d’actions possibles. De surcroit, la réaffirmation du soutien des États-Unis au verdict de 2016 par le secrétaire d’État Anthony Blinken plus tôt cette année aura également un faible impact. Le traitement américain à l’égard des différentes cours internationales étant manifestement ambigu, cette posture diplomatique est facilement soulignée par Pékin à sa défense. Pour les États-Unis qui partagent des intérêts économiques et sécuritaires en plus de faire contrepoids à l’influence chinoise, les actions futures en mer de Chine du Sud revêtent une importance stratégique capitale pour Washington.
Les armes autonomes létales et le droit international
La mise au point de nouvelles technologies militaires comme celle des systèmes d’armes létales autonomes (SALA) s’accompagne d’importantes préoccupations juridiques. À cet effet, l’ambivalence américaine sur une éventuelle légifération des SALA crée une fenêtre d’opportunité pour Pékin. Bien que les États-Unis et la Chine aient pris part aux rencontres du groupe d’experts abordant le sujet entre 2014 et 2019 au regard de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques des Nations Unies, les deux rivaux adoptent un discours nuancé, mais opposé. En 2019, alors que Washington a jugé prématurée la rédaction d’un instrument juridique contraignant sur le sujet et qu’il fallait éviter de stigmatiser l’utilisation de ce type d’équipement militaire, Pékin s’est positionné en faveur d’une interdiction. En effet, la Chine a déclaré ouvertement l’importance de légiférer ces nouvelles technologies afin d’agir en complémentarité avec le droit international humanitaire existant. Toutefois, la définition proposée par son équipe diplomatique est volontairement erronée. De surcroit, l’absence de clarifications ultérieures sur sa conceptualisation d’une future législation s’avère révélatrice. Cette prise de position s’identifie comme une instrumentalisation du discours juridique sur le sujet dans l’objectif de délégitimer la position maintenue par les États-Unis.
La Chine met à profit l’ambivalence américaine pour se faire passer pour l’acteur prônant la création d’un instrument contraignant, tout en poursuivant parallèlement ses activités de recherche et de développement dans le domaine. La position américaine, qui s’appuie sur la logique d’éviter d’octroyer un avantage stratégique à un adversaire en s’en privant soi-même, si maintenue, perpétuera l’avantage stratégique du PCC. Les récents développements à ce sujet n’ont que confirmé que les Américains préfèrent l’adoption d’un code de conduite plutôt que de principes juridiques contraignants. Le maintien du double discours de Pékin doit amener à une révision stratégique à Washington. D’emblée, les États-Unis doivent cesser de faire usage d’une rhétorique visant à réduire les risques se rattachant à l’utilisation de ce type d’équipement militaire pour consolider leur position sur l’élaboration de principes non contraignants. En l’absence de tels principes, le discours maintenu par Washington nuit davantage aux intérêts stratégiques américains qu’il ne les aide, car la Chine peut conserver ce double discours sans réellement craindre de répercussions.
Le cyberespace : une zone grise
Le cyberespace relève, lui aussi, d’une importance particulière au sein de la rivalité sino-américaine. Le fait que les États ne se positionnent pas de la même manière dans le cyberespace a un impact sur leur engouement vis-à-vis du développement normatif. Dans un rapport du groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale en 2013, les États participants – dont la Chine et les États-Unis – avaient convenu de l’applicabilité de la Charte des Nations Unies dans le cyberespace. Deux ans plus tard, la Chine a rejeté le nouveau rapport d’experts où l’on reconnait l’importance des principes du droit international humanitaire au sein du cyberespace. Par contre, à l’été 2021, elle a accepté l’applicabilité du droit international humanitaire au cyberespace dans le cas de conflits armés. Pour les Américains, l’utilisation de principes déclaratoires est en adéquation avec leur stratégie cybernétique. Toutefois, celle-ci est fortement critiquée, car centrée sur la dissuasion, et elle s’est prouvée progressivement inefficace. En effet, tandis que les États-Unis entendent à respecter le droit international humanitaire sur l’intégralité du spectre de leurs activités militaires, l’engagement chinois à cet effet est davantage symbolique que sincère. Bien que la Chine ait démontré son soutien à la règle de droit sur les enjeux de sécurité globaux, son oscillation sur l’application du droit international et plus particulièrement du droit international humanitaire au cyberespace laisse planer un doute légitime quant à sa réelle intention de vouloir lier sa pratique, que ce soit par le biais conventionnel ou par le développement de droit coutumier. De surcroit, la stigmatisation du comportement chinois dans le cyberespace, qui est explicitement qualifié de malicieux par Washington et ses alliés, vient consolider ce doute.
Enfin, même si les États semblent s’entendre sur l’applicabilité du droit international dans le cyberespace, un problème persiste. Les principes élaborés par la Charte des Nations Unies, tout comme ceux émanant du droit international coutumier, sont fortement teintés de l’environnement dans lesquels ils ont évolué. Conséquemment, ces principes ont été réfléchis dans une logique où les États pouvaient modifier la stabilité internationale par la coercition ou la force brute; logique qui se révèle plus nuancée au sein du cyberespace. En amont de la création de règles contraignantes, il est utile de comparer la position des États vis-à-vis du maintien du statu quo. Pour le PCC, le cyberespace est l’intersection de trois préoccupations majeures : le maintien de la légitimité du régime, la sécurité nationale et la dépendance technologique-économique. Pour eux, les normes existantes n’ont pas pour vocation de réguler les activités dans le cyberespace et c’est pour cette raison que la Chine tente de jouer un rôle dans la prolifération normative. En ce sens, bien qu’elle ait participé aux discussions sur le sujet, la Chine peut espérer poursuivre ses activités cyber, dites offensives, celles-ci s’orchestrant sous le seuil des critères qualitatifs d’un « conflit armé ».
Quant à Washington, le maintien de sa position passive lui octroie un désavantage devant un statu quo, conséquence de l’inadéquation de sa stratégie de dissuasion. Bien que les États-Unis aient récemment appuyé la récente démarche française encourageant le dialogue sur les normes dans le cyberespace, ils s’abstiennent de mener l’effort pour aller au-delà de principes déclaratoires. Paradoxalement, l’histoire a démontré que la création d’instruments internationaux contraignants régulant les activités au sein d’un domaine enclin à une course aux armements est l’une des meilleures manières de retrouver le dialogue et diminuer les tensions. Bien que le président Biden ait rappelé l’importance des normes et des institutions au sein de sa stratégie sur le cyber, beaucoup reste à faire.
Que peut faire le Canada ?
Le Canada n’est pas entièrement étranger au phénomène d’instrumentalisation du droit international. Bien qu’il ne soit pas reconnu pour se prêter diligemment à cette activité, il a déjà recouru à cette stratégie dans le passé. Toutefois, la dynamique de compétition entre grandes puissances au sein du système international doit amener le Canada à reconsidérer l’usage stratégique du droit international. L’idée qu’un État puisse faire avancer ses intérêts stratégiques ou s’en prendre à un autre État en usant du droit international n’est aujourd’hui plus à démontrer. Bien que ce constat ne soit pas nouveau, il est nécessaire pour le Canada de réévaluer cette menace. Il faut aujourd’hui considérer le « lawfare » comme un type d’activité dont l’existence s’avère intégrée à celles des conflits hybrides. À cet effet, un État adhérant à la règle de droit comme le Canada ne peut espérer se prêter aux mêmes tactiques que les États autoritaires percevant presque exclusivement le droit international comme un outil stratégique. Néanmoins, Ottawa peut espérer jouer un rôle d’importance dans la réponse américaine aux manœuvres de Pékin. Malgré l’adoption d’un comportement empreint d’une sélectivité indiscutable, l’approche américaine à l’égard du droit international, si elle devait s’homogénéiser, pourrait considérablement nuire aux activités chinoises.
1. Le gouvernement canadien doit encourager le Congrès américain à changer son approche vis-à-vis de la CNUDM.
Membre de la CNUDM, le Canada devrait chercher à amener le Congrès américain à adhérer au traité. Comme mentionné précédemment, Washington est incontournable dans l’élaboration de nouvelles normes. Bien que le Congrès américain soit indécis quant à la portée de la ratification de la CNUDM, le Canada doit s’ingénier à recentrer la discussion américaine sur la portée symbolique de la ratification, plutôt que sur l’usage stratégique à court terme. Par la démonstration de l’inconditionnalité de son support au droit international, les États-Unis viendraient rehausser la légitimité de leur appel au respect de la règle de droit. De surcroit, le Canada devrait encourager le gouvernement américain à davantage soutenir les autres États de la région qui désirent entreprendre des initiatives juridiques à l’égard des activités chinoises en mer de Chine du Sud; en plus de lui-même, réitérer son appui à ce genre de démarches.
2. Le Canada doit miser sur l’adoption d’une définition des SALA qui est en adéquation avec ses intérêts et ceux de ses alliés.
L’absence de définition universelle pour définir ce type d’équipement pourrait se présenter comme une opportunité pour Ottawa et Washington, en même temps qu’une épine au pied pour Pékin. Sans que les États-Unis soient appelés à condamner entièrement leur orientation stratégique actuelle, une définition plus précise des SALA forcerait le leadership chinois à réévaluer son engagement envers une légifération de ce type d’arme. À la lecture de sa conceptualisation fortement anachronique des SALA, on peut parier que Pékin refuserait de reconnaître cette définition, ce qui saperait la crédibilité de sa poussée juridique. Instigateur de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, le Canada pourrait transposer cette approche qui s’est antérieurement prouvée efficace pour veiller à ce que le cadre juridique encadrant ces armes soit en concordance avec ses intérêts stratégiques et ceux de ses alliés. De surcroit, ce genre de démarche serait d’autant plus bénéfique pour Ottawa, car elle pourrait être réalisée, sans un appui direct de Washington, tout comme ce fut le cas en 1997. Ce genre d’initiative pourrait permettre de débloquer l’impasse actuelle, en plus de revitaliser l’image canadienne sur la scène internationale.
3. Le Canada doit diversifier son approche pour le développement de bonnes pratiques dans le cyberespace.
Les compétitions stratégiques dans le cyberespace sont caractérisées par l’exploitation plutôt que par la coercition. Le Canada, étant déjà relativement actif sur le sujet de la cybersécurité sur le plan national par l’adoption de sa Stratégie nationale sur la cybersécurité, ce dernier pourrait jouer le rôle de leader au sein du développement normatif en renchérissant sur sa volonté de mettre en place des normes encadrant les bonnes pratiques dans le cyberespace. Bien que le Canada ait statué en 2020 qu’il considère que le droit international et les normes développées par les précédents travaux du groupe de travail sur le sujet sont suffisants, il gagnerait à nuancer son discours. Par exemple, Ottawa pourrait s’inspirer de l’orientation stratégique américaine de l’« initiative persistence ». Cette dernière comporte une facette défensive et offensive axée sur l’exploitation de vulnérabilités et qui s’inscrit sur un continuum d’activités. Par des démarches de « tacit bargaining », le Canada pourrait espérer poursuivre ses intérêts nationaux tout en participant au développement de bonnes pratiques dans le cyberespace.
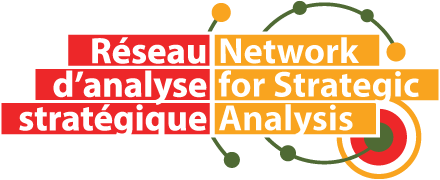

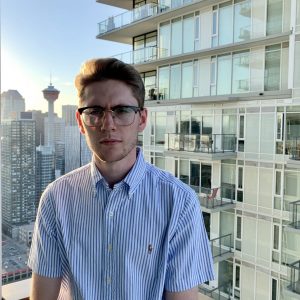


Les commentaires sont fermés.