Avril 2021. Pas moins de 150 000 soldats russes seraient déployés en exercice à la frontière ukrainienne selon les dires du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Encore ébranlé par le camouflet subit lors de sa visite à Moscou en février – où il s’est fait dire en conférence de presse que l’UE n’était pas un partenaire fiable – il exagère sans doute pour mieux tirer la sonnette d’alarme. Car la Russie elle-même ne cache pas l’ampleur du déploiement, précisant qu’il s’agit là d’une réponse à la menace posée par l’OTAN. « La Russie est dans son droit », souligne le président Poutine, en servant une mise en garde à ceux qui envisageraient de traverser la ligne rouge, qu’il trace lui-même.
Tous comprennent que cette ligne se trouve en Ukraine, mais l’idée de devoir considérer les mises en garde du Kremlin polarise les chancelleries occidentales. Certains estiment que le comportement agressif et revanchard de la Russie doit être plus durement châtié par une action concertée des alliés, sans quoi Moscou y verra le signal qu’il peut poursuivre sa stratégie d’intimidation. D’autres prennent d’abord acte des équilibres de puissance stratégique et cherchent, par le dialogue, à clarifier les règles d’une coexistence pacifique, sans quoi rien n’empêchera la spirale d’insécurité de nous engager dans une confrontation apocalyptique.
Cette double contrainte ne semble permettre aucune issue convenable pour tous. Le durcissement des sanctions économiques – ou pire, une éventuelle reprise des combats – serait beaucoup plus coûteux pour l’Europe que pour l’Amérique. Il est loin d’être acquis que l’administration Biden saura reconstruire, au sein de l’Alliance, un consensus sur la marche à suivre. Pour y arriver, il faudra faire preuve d’imagination pour recadrer différemment le problème, quitte à revoir le rôle que le pays et ses alliés de l’OTAN y jouent. Un tel recadrage conceptuel de la crise est-il possible ?
La dialectique des narratifs contradictoires
L’examen comparatif des représentations véhiculées à Moscou et à Washington semble complètement antinomique. Pour les uns, les faits marquants débutent lorsqu’une opération russe est menée contre l’administration régionale de Crimée, à Simféropol, contraignant les élus locaux à avaliser la tenue d’un référendum anticonstitutionnel sur l’autonomie, puis sur le rattachement de la péninsule à la Russie. Menée dans les règles de l’art de la dissimulation, l’opération se solde par la capture de bases ukrainiennes et l’annexion illégale de la péninsule. Elle se poursuit ensuite au Donbass, par le truchement d’un soutien actif, mais inavoué aux rebelles des républiques auto-proclamées de Lougansk et Donetsk.
Or on entend chez les autres une histoire parallèle, mais tout aussi véridique. Au tournant de l’année 2014, une mobilisation de masse est organisée avec la complicité de Washington. L’objectif est de faire tomber un gouvernement démocratiquement élu en 2010 sur une plateforme de rapprochement avec la Russie. Des milices irrégulières d’extrême-droite prennent part aux émeutes qui forcent le Président Ianoukovitch à fuir la capitale. Elles contribuent à la formation d’un pouvoir anticonstitutionnel qui jure de contraindre Moscou à renoncer à toute influence sur leur pays. Le nouveau régime souhaite même expulser la marine russe de sa base navale historique de Sébastopol, promettant de déchirer le contrat de location en vigueur. Pire encore, la population russophone qui s’oppose à ce gouvernement non-élu est bientôt victime d’opérations armées dites « anti-terroristes », encore là avec le soutien des États-Unis et certains de leurs alliés.
Ce ne sont pas les faits constitutifs de ces narratifs qui sont contradictoires – les uns n’excluant pas les autres – mais bien l’identification et la mise en accusation de celui qui est à l’origine de la guerre. La sélection des éléments du récit, qui repose sur une volonté de faire porter sur l’autre la responsabilité de la crise, accentue l’intensité de la lutte représentationnelle.
En amont, l’antagonisme porte sur les fondements normatifs de leurs actions respectives. On retrouve d’un côté cette idée messianique qu’il faut venir en aide aux forces démocratiques d’un État indépendant à qui l’on a promis à maintes reprises de garantir l’intégrité territoriale. Ce pays européen ne doit pas être abandonné au profit des velléités néo-impérialistes d’un régime de plus en plus autoritaire, qui viole les droits humains. On justifie ainsi la livraison d’armes létales, qui débutent sous l’administration Trump.
De l’autre côté, il y a cette idée anachronique que les grandes puissances disposent d’un droit d’ingérence exclusif dans leur périphérie immédiate. Puisque Washington a ouvert les hostilités en s’ingérant dans la cour arrière de la Russie, les tenants de la realpolitik comprennent qu’une riposte était inévitable. Jamais le port stratégique de Sébastopol n’aurait pu être occupé par les navires américains sans que la Russie ne livre bataille. Et bien entendu, toute tentative de reconquête du Donbass (où habitent maintenant un demi-million de personnes ayant déjà demandé et obtenu la citoyenneté russe) sera opposée par la voie des armes.
13 000 morts plus tard, les démonstrations de forces se poursuivent de part et d’autre. Tous les éléments narratifs du conflit demeurent en place. Ou presque.
La paix de Minsk
Grande oubliée de ces deux narratifs rivaux qui dominent leur espace médiatique respectif, la paix conclue à Minsk en février 2015 demeure pourtant à ce jour le seul fondement d’une résolution pacifique d’un conflit, dont les acteurs se trouvent autant sur la scène intérieure que dans l’arène internationale. Quelqu’un se souvient-il encore que les mesures prévues par ce traité parrainé par le « quatuor de Normandie » (France-Allemagne-Russie-Ukraine) et signé entre les leaders des républiques sécessionnistes et le gouvernement ukrainien ont été formellement approuvées avec la résolution 2202 par le Conseil de sécurité de l’ONU ?
Âprement négocié par les deux poids lourds de diplomatie européenne dans un contexte militaire très défavorable à l’armée ukrainienne – alors directement aux prises avec des unités de « volontaires » russes sur son territoire – cet accord est difficilement acceptable pour les partisans d’une Ukraine totalement émancipée de l’influence du Kremlin. Car les termes de l’accord sont relativement favorables à la Russie, qui conserve par sa mainmise sécuritaire sur les régions de Donetsk et de Lougansk une solide hypothèque sur l’avenir transatlantique de l’Ukraine.
En effet, le plan prévoit la tenue d’élections locales supervisées par l’OSCE, suivies d’une réintégration de ces régions dans l’État ukrainien, mais seulement après que des changements constitutionnels leur aient conféré une très large autonomie. C’est là une condition préalable au retour des forces ukrainiennes le long de frontière avec la Russie. Au demeurant, l’accord évoque le respect de l’intégrité territoriale du pays sans même évoquer l’épineuse question de la Crimée, dont il n’est aucunement fait mention dans le document.
Plus de six années se sont écoulées déjà depuis cette violente offensive sur la ville carrefour de Debaltseve, lors de laquelle les rebelles soutenus par la Russie ont infligé une cuisante défaite aux forces ukrainiennes. Pour rappel, ce n’est pas le risque de représailles armées de l’OTAN qui a alors empêché la Russie d’avancer davantage. Déjà empêtrée en Irak et en Afghanistan, l’Alliance n’est clairement pas en moyen de se mesurer directement à la Russie pour aider un aspirant-membre, comme les Géorgiens l’ont appris douloureusement à leurs frais lors de la guerre d’août 2008. Il n’y a que le coût économique des sanctions qui soit pour Moscou dissuasif. Or compte tenu de la taille de ses ressources exportables et de l’accès au marché chinois, ces sanctions ne demeurent – on l’a bien vu – que bien partiellement dissuasives.
Comme la plupart des cessez-le-feu, la paix de Minsk résulte d’un équilibre fragile des forces où la retenue du vainqueur est obtenue grâce aux concessions du vaincu. Washington s’est alors placé à l’écart du processus de négociation. Sous la pression du couple franco-allemand, Kiev a consenti à reconnaître une ligne de partage au sein du pays, garantissant l’amnistie à tous les combattants sécessionnistes. Certes, il n’est pas facile pour le gouvernement de mettre en œuvre les changements constitutionnels nécessaires à la réintégration formelle de régions largement autonomes, tant ceux-ci sont impopulaires. Or, ce que les troupes russes qui s’exercent à la frontière rappellent, c’est qu’une renonciation à cet engagement pourrait bien signifier une intensification dramatique des hostilités.
La position du Canada
La signature des accords de Minsk consécutive de la défaite militaire au Donbass est généralement indigeste pour la minorité ukraino-canadienne, le plus souvent originaire de Galicie et encore pleine de ressentiment contre l’Empire qui l’a occupé en 1939. Conscient du poids électoral de cette minorité, notamment dans les Prairies (où elle constitue plus de 10% de la population), le gouvernement canadien a toujours exprimé haut et fort son soutien pour les aspirations légitimes d’une Ukraine indépendante. La meilleure preuve tangible de cet engagement s’exprime par sa contribution à la Commission mixte multinationale sur la réforme de la défense et la coopération en matière de sécurité avec l’Ukraine, dirigée par les États-Unis et à laquelle participent cinq autres alliés (Grande-Bretagne, Suède, Danemark, Pologne et Lituanie). L’opération Unifier mise en place par les FAC en 2015 constitue une aide non létale au renforcement de forces armées ukrainiennes, une aide essentiellement offerte à travers des formations.
Alors que le gouvernement Harper s’était montré ouvertement favorable à l’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN, tenant des propos extrêmement durs à l’égard de son homologue russe, son successeur Justin Trudeau doit maintenant faire preuve de plus de réserve sur cette question qui divise déjà depuis longtemps l’Alliance. Les visées expansionnistes de l’Alliance se sont avérées déstabilisantes pour l’environnement sécuritaire, encourageant Moscou à doubler la mise pour éviter de perdre pied en Ukraine. À lui seul, le renforcement de l’arsenal nucléaire russe (et le processus concomitant du démantèlement du régime de limitation des armes qui survient sous la présidence de Donald Trump) constitue, qu’on le veuille ou non, une invitation à la prudence.
Les appels récents du Président Zelenski pour solliciter le soutien du Canada pour son admission dans les rangs de l’OTAN n’ont donné lieu à aucun commentaire du premier ministre, ni favorable ni défavorable, ce qui témoigne de l’embarras causé par ce dilemme. On comprend qu’il soit difficile pour le Canada de se désolidariser des objectifs géopolitiques de son principal partenaire commercial et des espoirs de sa diaspora ukrainienne. En même temps, faut-il le rappeler, le pays partage une longue frontière arctique avec son voisin russe, frontière qu’il n’est pas vraiment en mesure de protéger. Le gouvernement peut-il vraiment risquer de s’opposer à la recherche de termes mutuellement acceptables d’une coexistence pacifique ? En cas contraire, il lui faudrait clairement réitérer son soutien aux accords de Minsk.
Redéfinir la nature du problème
À quelques jours d’une première rencontre au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, quelques signaux positifs sont envoyés à l’effet que Washington est à la recherche d’une stratégie moins divisive au sein de l’OTAN, vraisemblablement pour mieux faire face à la Chine. Deux tournures absolument remarquables sont récemment survenues sans fanfare : 1) la menace de sanctions économiques contre les compagnies européennes engagées dans la construction du gazoduc North Stream reliant la Russie et l’Allemagne a été levée et 2) les discussions annoncées sur l’accession au plan d’adhésion de l’Ukraine ont été écartées de l’agenda du sommet de l’OTAN de Bruxelles à la mi-juin. L’Ukraine n’y a finalement pas été invitée.
Faut-il y voir là la consécration d’une défaite dans une lutte géopolitique qui oppose l’Ouest à la Russie ? Loin de là, puisque la crise s’est tout de même soldée par l’inclusion de l’Ukraine au sein du libre-échange pan-européen. De plus, l’annexion et le soutien aux rebelles ont fouetté le nationalisme antirusse, qui n’est plus du tout le phénomène minoritaire qu’il avait été avant 2014. Sans être mort, le soft power de la Russie s’en retrouve considérablement affaibli.
Du reste, il est possible d’opter pour une description de la crise qui élargit le cadre temporel de celle-ci au-delà de 2014. Il est envisageable de revenir à ce que l’Ukraine n’avait jamais cessé d’être depuis l’indépendance de 1991, soit un champ de bataille entre différentes représentations ethno-nationales, dont la composante slavo-orthodoxe liée à la Russie ne peut être soumise et détruite – pas plus d’ailleurs que l’ethno-nationalisme russophobe n’a pu l’être par 50 ans de domination soviétique. Ce conflit pourrait ainsi à nouveau être entendu pour ce qu’il était avant de dégénérer en guerre civile et en champ de bataille géopolitique, c’est-à-dire comme une profonde crise identitaire infranationale. Plutôt que de se diviser sur la manière de punir la Russie, le Canada et ses alliés pourraient envisager des moyens de soutenir cette réconciliation entre les Ukrainiens eux-mêmes.
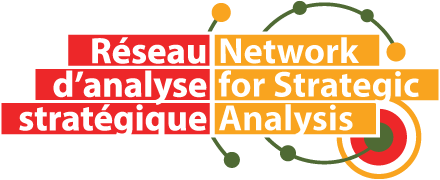




Les commentaires sont fermés.